 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});

Le nez n'est pas le seul à pouvoir sentir. D’autres organes comme le cœur et les poumons posséderaient aussi des récepteurs olfactifs. Reste à savoir à quoi ils servent.
Le sens de l’odorat renferme de nombreux secrets. Nous possédons tous le même système olfactif, mais nous ne sommes pas égaux devant un parfum : pour certains, une odeur de madeleine renvoie en enfance, pour d’autres elle ne déclenche pas d’émotion particulière. Une étude récente, présentée lors du congrès de la Société américaine de chimie, ajoute une pointe de mystère : le nez ne serait pas le seul organe à avoir de l’odorat, d’autres organes sentiraient également les odeurs !
Peter Schieberle, directeur du centre de recherche allemand pour la chimie des aliments, a en effet annoncé que d’autres endroits du corps comme le cœur, les poumons et le sang possédaient des récepteurs olfactifs. L’expérience est simple : les auteurs ont placé des cellules sanguines et un composé odorant à deux endroits opposés d’une même boîte. Ils ont alors observé un mouvement des cellules sanguines dans la direction de l’origine de l’odeur.
L’organisme fait rarement les choses pour rien, et cette capacité olfactive d’autres organes pourrait servir à quelque chose. Reste à savoir à quoi. Car si l’on comprend bien le rôle de l’odorat dans le nez, le reste est pour le moment inconnu. Les travaux sur la perception olfactive ne font que commencer, et pourraient lever un coin du voile.


Dans une initiative sans précédent, il est prévu que Amînah Wadûd - professeur d’études islamiques à l’Université de Virginie - devienne la première femme à diriger des fidèles des deux sexes dans la prière du vendredi qui se déroulera à New York le 18 mars 2005. La prière aura lieu au Sundaram Tagore Gallery à New York, où sont organisés des rencontres et des débats divers autour de la relation entre les civilisations orientale et occidentale.
Cet événement constitue un précédent historique dans la mesure où Amînah Wadûd sera la première femme à diriger les Musulmans dans une prière mixte. Amînah Wadûd revendiquera « le droit des femmes musulmanes à l’égalité avec les hommes au niveau des obligations religieuses, notamment le droit de la femme à être imam, et l’inexigibilité pour les femmes de prier dans les rangées arrière, derrière les hommes, dans la mesure où cela est le résultat de coutumes et de traditions ancestrales dépassées, n’ayant rien à voir avec la religion ». Mme Wadûd estime que le fait de ne pas accorder à la femme musulmane le droit d’être imam est quelque chose « d’enraciné dans les sociétés musulmanes, et que personne ne tente sérieusement de rectifier ».
Nous souhaitons de votre Éminence, Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî - que Dieu vous préserve -, que vous nous donniez votre avis sur cette information, dans le sillage de la tolérance à laquelle vous nous avez habitués, dans le sillage de votre méthodologie médiane, de votre objectivité et de la prise en considération de la réalité dans laquelle nous vivons, à la lumière de cette méthode d’analyse qui est la vôtre consistant à renvoyer les points secondaires à leurs principes directeurs, et à mettre les textes partiels en regard avec les finalités générales de la Législation islamique.
Nous demandons à Dieu qu’Il nous fasse profiter de votre savoir, qu’Il vous bénisse, qu’Il nous comble par votre présence, et qu’Il fasse de vous l’appui de notre Communauté et de notre religion.
On ne connaît pas dans l’histoire musulmane, longue de quatorze siècles, une seule femme ayant prononcé le sermon du vendredi ou ayant dirigé des hommes dans la prière. Même dans les époques où régnait une femme, à l’instar de Shajarat Ad-Durr [1] dans l’Égypte mamelouke, celle-ci ne prononçait pas le sermon du vendredi ni ne dirigeait les hommes dans la prière. Il s’agit là d’un consensus indubitable.
Originellement, l’imamat dans la prière est réservé aux hommes. Car l’imam doit être suivi dans ses gestes par les orants : s’il s’incline, ils doivent s’incliner derrière lui, s’il se prosterne, ils doivent se prosterner, et s’il récite le Coran, ils doivent écouter.
En Islam, la prière possède des caractéristiques et des spécificités bien déterminées. Il ne s’agit pas de simples invocations et de supplications, comme c’est le cas dans la prière chrétienne. Dans la prière musulmane, il y a des gestes, des positions debout, des positions assises, des inclinations et des prosternations. Il ne convient pas qu’une femme accomplisse ces mouvements devant des hommes, au cours d’un acte de culte où sont exigés le recueillement du cœur, la sérénité de l’âme et la concentration de l’esprit dans l’imploration du Seigneur.
La Sagesse divine a voulu que le corps de la femme soit façonné différemment du corps de l’homme. Elle y a placé des caractéristiques susceptibles d’exciter la libido de l’homme, et ce, afin de permettre le mariage qui sert de cadre pour la perpétuation de l’espèce humaine et la réalisation de la Volonté divine de civilisation de la Terre.
Afin d’écarter toute tentation, et de barrer la voie aux prétextes de la séduction, la Législation islamique a réservé aux hommes l’appel à la prière et la direction de la prière. De même, elle a décrété que les rangées des femmes doivent se situer derrière les rangées des hommes, en précisant que les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et que les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières. Le Prophète dit en effet : « Les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières et les pires sont les premières ; les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et les pires sont les dernières », et ce, afin d’écarter toute tentation potentielle.
L’homme peut ainsi concentrer tout son esprit et toute son attention sur le renforcement de son lien avec son Seigneur, sans que son imagination ne se mette à vagabonder hors du cercle de la foi, dans le cas où se mettrait en branle son incontournable instinct humain.
Ces jugements légaux sont fondés sur des hadiths authentiques et établis, reconnus par le consensus des Musulmans, toutes écoles juridiques confondues, et confirmés par leur mise en pratique durant les siècles passés. Il ne s’agit donc pas de simples coutumes et traditions comme cela a été affirmé.
L’Islam est une religion réaliste, qui ne vogue pas dans des sphères d’utopie, loin de la réalité vécue et expérimentée par les gens. Il ne traite pas les gens comme s’ils étaient des anges ailés, mais comme étant des humains mûs par des instincts et des sentiments. Il est tout à fait avisé que le Sage Législateur veuille les protéger de la tentation et de l’excitation, en empêchant, autant que faire se peut, la réalisation des causes et des motifs de cette excitation. Et cela est encore plus vrai dans les moments d’adoration, d’imploration et de supplication à Dieu.
Les quatre écoles juridiques islamiques, voire les huit écoles, se sont accordées à dire que la femme ne peut diriger un homme dans les prières prescrites, même si certains ont permis à la femme maîtrisant le Coran de diriger la prière au sein de sa famille, sachant que les hommes qui prieraient alors sous sa direction sont sesmahârim [2].
Aucun juriste musulman, qu’il appartienne ou non à l’une des écoles suivies, n’a permis à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Si nous examinons les textes, nous ne trouverons aucun texte authentique et explicite interdisant à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Tout ce qui a été relaté à ce sujet est un hadith attribué au Prophète et rapporté par Ibn Mâjah d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh : « Une femme ne doit pas diriger la prière d’un homme ; un bédouin ne doit pas diriger la prière d’un Émigré ; un débauché ne doit pas diriger la prière d’un croyant ». Les Imâms du Hadith ont cependant qualifié la chaîne de transmission de ce hadith de très faible. Il ne peut donc servir d’argument dans le problème qui nous concerne.
Un autre récit, démentant le précédent, a été relaté entre autres par Ahmad et Abû Dâwûd. Selon Umm Waraqah Bint `Abd Allâh Ibn Al-Hârith, le Prophète - paix et bénédiction sur lui - lui assigna un muezzin qui appelait à la prière pour elle, et lui demanda de diriger la prière pour les gens de sa maisonnée (comprenant des hommes et des femmes). La chaîne de transmission de ce hadith a également été jugée faible par les savants. Il demeure néanmoins qu’il concerne le cas particulier d’une femme ayant mémorisé le Coran et qui dirigerait la prière pour les gens de sa maisonnée : son époux, ses fils et ses filles, qui sont de proches parents, et dont elle n’a pas à craindre qu’ils soient séduits par elle. Ad-Dâraqutnî précise dans une variante que le Prophète lui demanda de diriger la prière des femmes de sa maisonnée.
Ibn Qudâmah écrit dans Al-Mughnî : « Cette précision [d’Ad-Dâraqutnî] doit être acceptée. Même s’il n’y avait pas cette addition, le récit devrait être interprété de cette manière. En effet, le Prophète lui permit de diriger les prières prescrites, - la preuve étant qu’il lui assigna un muezzin appelant à la prière et que l’appel à la prière ne concerne que les prières prescrites - tandis qu’il n’y a aucune divergence sur le fait qu’une femme ne peut diriger les hommes dans les prières prescrites. »
Puis, il ajoute : « À supposer que Umm Waraqah dirigeait effectivement la prière des hommes de sa famille, cela aurait constitué un cas particulier la concernant elle seule, la preuve étant qu’il n’est pas permis aux autres femmes d’appeler à la prière ou de la diriger. Son imamat fut donc un cas particulier la concernant, au même titre que le muezzin que lui assigna le Prophète. »
Ibn Qudâmah soutient son avis en faisant remarquer que la femme ne peut appeler à la prière pour des hommes, et que, de ce fait, il ne lui est pas permis de les diriger.
Je ne suis pas d’accord avec l’Imâm Ibn Qudâmah pour dire que l’autorisation prophétique concerne uniquement Umm Waraqah. Toute femme étant dans la même condition que Umm Waraqah, c’est-à-dire connaissant et maîtrisant le Coran, peut diriger les prières prescrites et surérogatoires de ses enfants et proches parents, y compris la prière des tarâwîh [3].
Les Hambalites ont un avis tout à fait respectable sur la question, autorisant la femme à diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. C’est l’avis le plus réputé chez les premiers Hambalites.
Az-Zarkashî écrit : « L’avis consigné par Ahmad [4] et choisi par la majorité de nos condisciples est que la femme peut diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. » C’est également ce que rapporte Ibn Hubayrah au sujet de Ahmad dans Al-Ifsâh `an Ma`ânî As-Sihâh (volume I, page 145).
Ceci concerne la femme maîtrisant le Coran et qui dirige la prière des gens de sa maisonnée et de ses proches. Certains ont également limité cela aux femmes âgées.
L’auteur d’Al-Insâf écrit : « Dans la mesure où nous opinons que la femme peut diriger la prière des hommes de sa famille, elle doit néanmoins se tenir derrière eux pour garantir plus de décence, et ils la suivent dans ses gestes. C’est l’avis le plus juste. »
Une entorse est faite ici à la position normale et originelle selon laquelle l’imam doit se tenir devant les orants. Cette exception vient garantir la décence et prévenir la tentation, autant que faire se peut.
L’imamat de la femme devant ses consœurs
Quant à l’imamat de la femme dans une prière exclusivement féminine, de nombreux hadiths viennent l’appuyer. On peut ainsi citer le hadith de `Â’ishah et de Umm Salamah - que Dieu les agrée -, rapporté par `Abd Ar-Razzâq, Ad-Dâraqutnî et Al-Bayhaqî d’après Abû Hâzim Maysarah Ibn Habîb, d’après Râ’itah Al-Hanafiyyah, selon qui `Â’ishah dirigea une prière prescrite dans une assemblée de femmes, tout en se tenant dans le rang. Ibn Abî Shaybah rapporte également d’après Ibn Abî Laylâ, d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude de diriger la prière des femmes, en se tenant alignée avec elles dans le rang. Al-Hâkim rapporte d’après Layth Ibn Abî Salîm d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude d’appeler à la prière, de diriger la prière des femmes et de se tenir alignée avec elles dans le rang.
Ash-Shâfi`î, Ibn Abî Shaybah et `Abd Ar-Razzâq rapportent d’après `Ammâr Ad-Duhnî, d’après une femme de sa tribu appelée Hujayrah, que Umm Salamah dirigea les femmes dans la prière, tout en se tenant parmi elles.
Selon les termes exacts de `Abd Ar-Razzâq, Hujayrah rapporte : « Umm Salamah nous a dirigées dans la prière des vespres et se tint parmi nous ».
Le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Ad-Dirâyah : « Muhammad Ibn Al-Husayn rapporte d’après Ibrâhîm An-Nakha`î que `Â’ishah dirigeait la prière des femmes durant le mois de Ramadân, tout en se tenant parmi elles. » `Abd Ar-Razzâq rapporte d’après Ibrâhîm Ibn Muhammad, d’après Dâwûd Ibn Al-Husayn, d’après `Ikrimah, qu’Ibn `Abbâs dit : « La femme dirige la prière des femmes tout en se tenant parmi elles ».
Nous souhaitons donc que nos soeurs qui s’activent à défendre les droits de la femme revivifient cet élément de la Sunnah, aujourd’hui tombé en désuétude, consistant à ce que la femme dirige la prière d’autres femmes, au lieu de se lancer dans cette innovation condamnable consistant à ce qu’une femme dirige la prière des hommes.
L’auteur d’Al-Mughnî écrit : « Il y a divergence autour de la question suivante : est-il recommandé à la femme de diriger la prière d’une assemblée de femmes ? Certains sont d’avis que cela est recommandé, c’est l’opinion de `Â’ishah, de Umm Salamah, de `Atâ’, d’Ath-Thawrî, d’Al-Awzâ`î, d’Ash-Shâ’fi`î, de Ishâq et de Abû Thawr. On rapporte également que Ahmad est d’avis qu’il s’agit là d’une chose recommandée. Les tenants de l’école interprétative ont une opinion opposée et estiment que c’est là une chose détestable ; néanmoins, si une femme dirige la prière des femmes, cette prière est valide. Ash-Sha`bî, An-Nakha`î et Qatâdah précisent que la prière en congrégation pour les femmes n’est permise que concernant les prières surérogatoires, à l’exclusion des prières prescrites. »
Ce qu’il est important de réaffirmer ici, c’est qu’originellement, vis-à-vis des œuvres cultuelles, la règle est l’interdiction et la prohibition totale sauf ce que permet la Législation à travers des textes authentiques et explicites, afin que les gens ne se mettent pas à instituer au niveau de la religion des pratiques que Dieu n’a pas permises.
Nul n’a le droit de créer une nouvelle forme de culte, d’ajouter des choses à ce qui existe déjà, de revêtir l’existant de nouvelles formes et de nouvelles modalités, pour peu que cela lui semble bon. Quiconque introduit quelque chose dans la religion ou y ajoute ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté.
C’est précisément ce dont prévient le Noble Coran lorsqu’il critique les polythéistes :« Ou bien auraient-ils des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n’a jamais permises ? » [5] C’est également ce dont prévient la Tradition prophétique lorsque le Prophète dit : « Quiconque ajoute à notre affaire - c’est-à-dire à notre religion - ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté » [6].
Le Prophète dit également : « Prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement » [7]. Les actes de culte sont en effet établis par arrêté, comme en conviennent les savants.
Les autres religions n’ont été falsifiées, et leurs cultes et leurs rites modifiés, que parce que s’y est introduite l’innovation religieuse, sans que les savants de ces religions ne condamnent ces innovations et leurs innovateurs.
A contrario, ce principe ne s’applique pas aux affaires profanes, dont le caractère originel est la permission et la licéité. La règle islamique est en effet la suivante : le suivisme dans les affaires cultuelles et l’innovation dans les affaires profanes.
Tel était l’état d’esprit des Musulmans à l’ère de la supériorité de leur civilisation : ils se sont contenté de suivre leurs prédécesseurs dans les affaires cultuelles et ont innové et créé dans les affaires profanes. Ils ont ainsi bâti une civilisation fière et altière. À l’ère de la déchéance, c’est le contraire qui a eu lieu : ils ont innové dans les affaires cultuelles et ont stagné dans les affaires profanes.
Je désire néanmoins dire un mot pour conclure. À quoi sert-il de provoquer toute cette polémique ? Est-ce cela qui préoccupe réellement la femme musulmane, de pouvoir diriger les hommes dans la prière du vendredi ? Cela a-t-il jamais constitué une revendication de la femme musulmane ?
Comme nous pouvons le constater, les autres religions réservent aux hommes de nombreuses fonctions cultuelles, sans que les femmes n’y voient le moindre inconvénient ? Pourquoi nos femmes émettent-elles alors de telles revendications outrancières, au risque de créer des divisions au sein des Musulmans ? Et ce, à l’heure où les Musulmans ont plus que jamais besoin de s’unir et de rassembler leurs rangs, pour faire face aux troubles, aux crises et aux complots majeurs qui veulent les anéantir.
Mon conseil à la sœur Amînah Wadûd est de réviser sa position, de retourner à son Seigneur et à sa religion, et d’éteindre cette polémique qu’il est inutile de provoquer.
Je recommande également à mes frères musulmans et sœurs musulmanes d’Amérique de ne pas répondre à cette provocation, et de s’unir tous ensemble contre les nuisances et les complots qui se fomentent contre eux.
Je demande à Dieu d’inspirer à nos fils, à nos filles, à nos frères et à nos sœurs, où qu’ils soient, la justesse du propos et la rectitude de l’action. Je Le prie pour qu’Il nous fasse voir à tous la Vérité et qu’Il nous accorde la grâce de la suivre, et qu’Il nous fasse voir l’Erreur et nous accorde la grâce de nous en écarter. Amen.« Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous as guidés ; et accorde-nous Ta Miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur ! » [8]
Et Dieu est le plus Savant.
[1] Shajarat Ad-Durr fut Sultane d’Égypte, après avoir été l’esclave puis l’épouse du dernier Sultan ayyûbide, Najm Ad-Dîn Ayyûb. Elle inaugura la dynastie des Mamelouks.
[2] Les mahârim, pluriel de mahram, désignent les proches parents avec lesquels le mariage est interdit à jamais.
[3] Les tarâwîh sont les prières nocturnes du Ramadân.
[4] Ahmad Ibn Hambal est le fondateur de l’école hambalite.
[5] Sourate 42, Ash-Shûrâ, La Consultation, verset 21.
[6] Hadith consensuel.
[7] Hadith authentique rapporté par Ahmad dans son Musnad.
[8] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d’Amram, verset 8.


L'idolâtrie dans l'amour, elle est en rapport avec cet état psychologique où l'être humain se laisse perdre dans la personne qu'il aime. Cet état peut se transformer en une forme d'adoration qu'on rencontre dans les poèmes d'amour de beaucoup de poètes où l'amant exprime ses sentiments envers la bien-aimée en usant du langage de l'adoration qu'on voue à Dieu.
Cet état peut ne pas être propre à ce qu'on appelle l'amour entre un homme et une femme. On peut le rencontrer au niveau des attitudes que les gens peuvent avoir envers les grands hommes, les chefs et les héros. Ceux qui aiment ce héros ou ce chef peuvent se perdre en lui au point d'oublier tout ce qui n'est pas lui. On peut même arriver à désobéir à Dieu pour lui obéir. On peut s'écarter de la voie de Dieu pour suivre sa voie. Cette attitude se rapproche de l'idolâtrie dans la mesure où l'homme donne une place, dans son intériorité et à côté de celle de Dieu, à une autre personne sacrée. Dieu (qu'Il soit exalté) exprime cette attitude dans le verset coranique suivant:
"Il y a, parmi les gens, ceux qui adorent des (prétendus) égaux à Dieu. Ils les aiment comme on aime Dieu, mais ceux qui ont cru sont plus attachés à l'amour de Dieu", Coran, la vache (al-Baqara), II 165.
Rien, pour ceux qui croient, ne peut être l'égal de Dieu. Quand ils aiment les humains, ils les aiment à travers l'amour qu'ils vouent à Dieu et sur la base du rapport que ces humains ont avec Dieu. Pour cette raison, nous essayons de poser cette question devant les jeunes hommes et les jeunes filles qui vivent les sentiments de ce stade de leur vie qu'est l'adolescence, ou qui vivent les sentiments d'amour propres à ce stade. Nous la posons aussi devant les hommes et les femmes qui vivent à l'intérieur de la relation conjugale. Nous leur disons à tous qu'ils doivent maîtriser leurs sentiments dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, que ces rapports soient du genre affectif ou du genre que l'on retrouve dans diverses situations banales de la vie quotidienne. Ils doivent ne pas les laisser aller au-delà des limites fixées par Dieu (qu'Il soit exalté et loué). Cela doit s'appliquer à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et à ce qu'ils sentent dans la mesure où ils doivent considérer les autres en tant qu'honorables serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils se sentent émus par la beauté de quelqu'un, ils doivent savoir que c'est Dieu qui lui a donné cette beauté. Et lorsqu'ils se sentent admiratifs vis-à-vis de l'héroïsme, ils doivent savoir que cet héroïsme est un don de Dieu. Lorsque nous faisons de sorte que Dieu soit présent dans notre conscience dans nos sentiments et dans nos attitudes vis-à-vis des autres, tous les autres seront plus petits devant Dieu. Dieu seul reste grand dans notre conscience et majestueux dans nos sentiments. C'est Lui que rien ne peut s'approcher de la place qu'Il prend dans nos pensées, dans nos cœurs et dans toutes nos vies. Nous devons savoir que Dieu nous a appris que son amour n'est pas seulement un sentiment dans le cœur, mais qu'il est aussi un mouvement dans la Réalité. Il est dit dans le Livre de Dieu:
"Dis: Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Alors Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés", Coran, Âl-'Imrân (la Famille d'Imran), III 31.
Ce que nous voulons affirmer se résume en ceci: si nous nous disons à nous-mêmes que nous aimons Dieu, nous devons prouver notre amour de Dieu par l'action. Lorsque nous disons que nous voulons être aimés par Dieu, nous devons le chercher en obéissant à Dieu. Mais aimer Dieu et lui désobéir, aimer Dieu et se révolter contre Sa volonté, c'est être semblable à celui dont parlent les vers suivants:
"Tu désobéis à Dieu
tout en faisant semblant de L'aimer?
Cela est, par ta vie, une action inouïe!"
"Si tu L'aimais vraiment,
tu Lui aurais obéi, car
celui qui aime obéit au bien-aimé"!.
http://francais.bayynat.org.lb/femme_en_Islam/Lamouretlaproblematique.htm

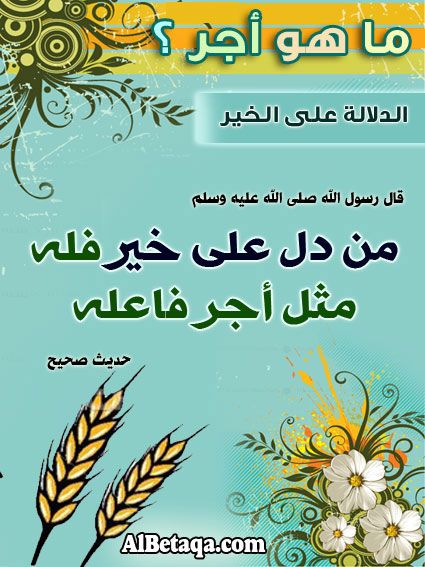
Le terme « Groupe » fait référence à la fraction parmi les imâms de la Sounnah qui nous ont précédé, de la génération de l’imâm Ahmad, de ses imâms, et de ceux venu après eux. Il a été rapporté dans les hadîths authentiques du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) l’emploi du terme « Groupe », et de cela, il a mentionné le Groupe victorieux dans le hadîth réputé des sectes, jusqu’après avoir signalé la division des fractions sectaire : « Tous iront en Enfer en dehors d’une seule, qui est le Groupe. » Et dans une autre version : « Tous iront en Enfer en dehors d’une seule. Ils dirent : Qu’est-elle Ô Envoyé d’Allâh ? Il dit : À l’exemple de ce sur quoi je suis moi ainsi que mes compagnons. » Et dans une autre version il y est ajouté « À l’exemple de ce sur quoi je suis moi aujourd’hui ainsi que mes compagnons ».
Il est fortement encouragé dans de nombreux hadîths le fait de suivre et d’adhérer au Groupe. C’est ce qui est compris dans les versets dans lesquels y figure l’interdiction de la division et l’obligation d’adhérer au Groupe. Il est rapporté dans le hadîth authentique que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Le Groupe est une miséricorde alors que la division est le châtiment. » Ainsi les textes qui font référence au Groupe, au fait d’y adhérer et de s’y accrocher fermement, de prendre garde à diverger du Groupe sont nombreux. Certes les premières générations parmi les gens de science ont divergé sur le sens à donner au Groupe et à son commentaire, cela sur plusieurs dires :
Le premier avis, est que le Groupe représente l’énorme noirceur. Cela est le commentaire du Compagnon bien connu Ibn Mass’oûd et de Abî Mass’oûd al-Ansârî al-Badrî (qu’Allâh les agrées), ce qui a été rassemblé dans l’ouvrage de al-Likâ-î : « Charh Oussoûl I’tiqâd Ahl us-Sounnah wal-Djamâ’ah » et qui dit : « Certes le Groupe est l’énorme noirceur. » Il est rapporté dans certains hadîths une version mentionnant le fait que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Soyez avec l’énorme noirceur. » ce qui a été l’interprétation que l’énorme noirceur est le Groupe, cela a une époque bien précise, au dernier temps de Ibn Mass’oûd, lorsqu’a débuté les discordes à l’égard de ‘Outhmân (radhiallâhu ‘anhu) émanent des Kharidjites et de ceux leur ressemblant. Il a été encouragez, contre cela, d’adhérer fermement à l’énorme noirceur, et qui était la noirceur que représentait la foule des Compagnons de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa salam).
Le deuxième avis, est que le Groupe représente les Gens de science, de la Sounnah et de la tradition. Que ce soit des Gens du hadîth dans l’apprentissage ou l’enseignement, ou des Gens de la jurisprudence dans l’apprentissage ou l’enseignement, de même pour les Gens de la langue arabe apprenti ou enseignent. Certes le Groupe sont les Gens de science, de la jurisprudence, du hadîth et de la tradition. Cela constitue l’ensemble des dires souvent répétés des imâms tels que : « Le Groupe et la fraction victorieuse sont les Gens du hadîth. » Comme l’a mentionné l’imâm Ahmad : « Si ce ne sont pas les Gens du hadîth, alors je ne vois pas qui peuvent-ils être. » Et a tenu des propos identique ‘Abdullâh Ibn Moubârak, Yazîd Ibn Hâroûn et un groupe parmi les Gens de science.
D’autres ont dit que ce sont les Gens de science, comme l’a mentionné al-Bukhârî. Ce dire a été résumé par le fait que le Groupe sont les Gens de science, les Gens du hadîth et les Gens de la tradition. Des paroles recensées par al-Khatîb al-Baghdâdî selon différentes variantes dans son ouvrage : « Charf As-hâb ul-Hadîth. » C’est donc sur cette base que les savants ont utilisé à nombreuse reprise, constituant un consensus, le fait que le sens du Groupe et de la fraction victorieuse sont les gens du hadîth. Ce qui veut dire, à l’époque de l’imâm Ahmad et de ceux proche de son époque. Ils sont ceux qui ont secouru la Sounnah, secouru le dogme de vérité fasse à ceux qui refusaient la religieux d’Allâh, et l’on falsifié par les détracteurs, rejetant leurs contradictions sur tout les points.
Le troisième avis, est que le Groupe sont les Compagnons de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa salam) et c’est le dire qui remonte au Calife ‘Oumar Ibn ‘Abdel-‘Azîz al-Amwî (radhiallâhu ‘anhu). Et pour cet avis, il y a des preuves claires ; le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit dans certaines versions du hadîth sur les fractions : « Il est le Groupe ». Et dans une autre version : « À l’exemple de ce sur quoi je suis moi aujourd’hui ainsi que mes compagnons ». Et le sens qui y est donné, c’est que le Groupe constitue les Compagnons.
Le quatrième avis, est un point de vue mais qui n’est pas soutenu de preuve, et qui est que le Groupe constitue la communauté musulmane dans son ensemble. Ce dire est caduc car il contredit le hadîth sur les fractions. Le hadîth des fractions éclaircit que la communauté musulman, c’est-à-dire, la communauté exaucée, se divisera en 73 fractions. Le commentaire qui dit que le Groupe est la communauté musulmane, contredit incontestablement le hadîth clair et pur.
Enfin, le dernier avis dit que le Groupe renvoie à la ligue des croyants qui sont ceux qui se réunissent autour de l’imâm de vérité, lui vouent écoute et obéissance, et lui accordant leur pacte légiféré d’allégeance. Ce point de vue est un dire de Ibn Djarîr at-Tabarî (rahimahullâh) et un grand groupe des Gens de science. Ils disent : « Certes le Groupe, avec cela, obtiendra le consensus et l’union en la présence de l’imâm de vérité. » [1]
Notes
[1] Al-Lalî ul-Bahîyyah fî Charh al-‘Aqîdat il-Lawâssitiyyah du SHeikh Sâlih Âli ash-SHeikh, 1/78-82
vhttp://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article687

*

Malheureusement, certaine personne font des fatwas en allégeance à l’autorité du pays dans lequel ils vivent et qui sont de nature à nuire à l’islam et à nuire à nos frère et à nos sœurs partout dans le monde. Ce genre de fatwa complètement en marge de l’islam et contraire à notre religion ne font que diviser notre communauté et à y créer des conflits internes.
L’émir des croyants, al imam Ali Ibn Abi Talib radiAllahou 3anhou a dit: "Parmi les conditions de l'heure, il y a la multiplication des prédicateurs (khutaba) sur les minbars et la soumission des savants aux gouvernants, si bien qu'ils déclareront interdits ce qui est licite, et déclareront licite, ce qui est interdit et leur donneront des conseils juridiques (Fatwa) conforment à leurs passions".(Rapporté par Ad-Daylami)
Lorsque Ali radi Allahou 3anhou dit « conforment à leurs passions » cela signifie, conforme aux passions des gouverneurs auquels ils se sont soumi , de tel sorte que aujourd’hui l’on a un individu qui ne doit sa réputation qu’à grand renfort de million de pétrodollars, et dont la parole devient prioritaire sur la parole de Allah et de son Prophète Mohammed 3alayhi sallat wa salam, mais aussi prioritaire sur la logique, le bon sens et l’intérêt collectif des musulmans.
On peu prendre un exemple parfait et concret de la parole de l’imam ali dans notre époque, une fatwa d’une personne au nom de B E N B A Z que Allah lui pardonne, qui fait parti du groupe wahabi que beaucoup de gens malheureusement par manque de connaissance de l’islam qualifient de savant.
L’information qui suit est vérifiable puisqu’elle vient de la bouche même de son auteur.
Alors que le roi d’Arabie saoudite se fit photographier avec une croix autour de son cou à coté de la reine d’Angleterre, I B N B A Z a été interrogé à ce sujet là, sur le fait de porter une croix autour du cou.
Il répondit : « Ce sont des choses normales ! C’est normal ! Le détenteur du pouvoir agit dans ce genre de situation par rapport à ce qui relève de l’intérêt, si le fait d’accepter ce cadeau relève de l’intérêt islamique alors cela est permis…»
Quand certaines personnes (très très étonnées) entendirent cela, ils demandèrent : « Même une croix cheikh ?! » Il répondit « Même une croix ! »
Si on exposait cette fatwa qui laisserait forcément perplexe plus d'un, aux personnes qui suivent l’obédience wahabi, sans en leur donner le nom de l’auteur, en leur demandant leur avis sur l’autorisation du port de la croix chrétienne sous prétexte que c’est dans l’intérêt de l’islam , il répondront logiquement que c’est interdit , c’est haram, c’est bid’a ... En revanche si on leur donne le nom de la personne directement qui ici est un de savant qu’ils suivent, alors ils la prendront directement au sérieux …
Le Prophète 3alayhi sallat wa sallam nous a enseigné la religion et Allah dans le coran nous dit "[...] wama atakoumou alrrasoulou fakhoudhouhou wama nahakoum ^anhou faintahou[...] (s59v7) qui signifie, « ce que le Prophète vous a apporté attachez vous y, tenez vous, et ce contre quoi il vous a mit en garde, ce contre quoi il vous en a interdit de vous en approcher mettez vous en à l ‘écart (très fermement sans aucune condition) »
Et on voit bien que par la parole de Ali radiAllahou 3anhou cité plus haut, on est en plein dedans, même le musulman qui en sait le moins sur la religion, s’il est conscient, jamais il ne va accepter de porter une croix sous prétexte que cela serait dans l’intérêt de la communauté car c’est tout simplement contradictoire avec L’islam.
Et Le Prophète 3alayhi sallat wa salam n’a été envoyé sur terre que pour prêcher le tawhid de la même manière que tous les Prophètes ne sont venu que pour cette raison, prêcher le tawhid et le port d’une croix chrétienne est le signe évident de la destruction du tawhid. Sayidina ^Issa alayhi salam lorsqu’il viendra à la fin des temps, ça sera pour détruire la croix et non pas pour la porter autour du cou.
Al Bukhari rapporte que le Prophète salla Lahou 3alayhi wa sallam ne laissait dans sa demeure aucune chose portant des croix, sans la détruire. Et aujourd’hui des soit disant savants de l’islam font des fatwas au gré de leurs passions et au gré des passions de ceux qui les dominent, qui les gouvernent, et auxquels ils sont soumis et ces gouvernants là sont eux même à la solde de certain intérêt juif et chrétien américo sioniste. La cause aujourd’hui de toutes ces destructions et ces meurtres de nos frères et sœurs est uniquement la soumission aux intérêts des juifs et des chrétiens, tout ça pour protéger ses propres biens au détriment de la communauté musulmane.
Donc, non une fatwa qui dit que c’est dans l’intérêt public de porter une croix, non ce n’est pas dans l’intérêt de l’islam, au contraire.
Les premiers musulmans de l’Islam sont morts martyrs à cause de la parole du tawhid, tous les Prophètes se sont fait persécutés à cause de la parole du tawhid et aujourd’hui on a des « oulémas » qui incitent au port de la croix chrétienne sous prétexte que celle ci serait dans l’intérêt des musulmans ce qui est très très contradictoire eux qui prétendent suivrent les pieux prédécesseurs.
Le 2ème kalif de l’islam, Omar Ibn al Khattab radiAllahou 3anhou a dit : « je ne veux pas prier dans une église (une prière musulmane dans une église) parce que je ne veux pas que les musulmans qui viendront après moi disent « oui Omar a fait une prière dans une église donc nous pouvons faire la même chose » »
On ne peut bien évidemment, ni accepter comme cadeau une croix, ni la garder comme dépôt et ce quelque soit le motif, que ce soit un collier, bracelet, boucle d’oreille, piercing, pendentif, sur les vêtements ou n'importe où, qui porte une croix. (source: dans fikh asuna pour les femmes p487-488)
Ces même gens, sont là à nous interdire de nous défendre et font répandre des fatwas qui ne font que la joie et l’intérêt des américo-sionistes et de tous les ennemis de la communauté musulmane. Ils rendent obligatoire de se taire même si pour cela il faille passer par la tromperie, par le mensonge, et toujours l’exagération.
Le Prophète 3alayhi sallat wa salam dit : "Quiconque (et non pas certain) parmi vous, voit un mal, qu'il le fasse cesser de ses mains" "Mane ra'a minkoum mounkarine fal youghayrhou bi yadihi"
Ceci constitue un ordre du Prophète, un impératif qui rend obligatoire pour quiconque à la capacité de faire cesser physiquement et sur le champ un acte ou une action blâmable, d’agir immédiatement.
Il dit ensuite "Et s'il ne le peut, alors qu'il le fasse cesser de sa langue" "Wa ine lam yastati3 fa bi lissanihi"
C’est à dire que si cette personne n’est pas capable de faire cesser le mal par sa main faute de force physique ou si la distance l’empêche d’agir alors elle a une autre alternative. C’est la 2ème solution qui s’impose c’est à dire de dénoncer le mal et l’auteur du mal publiquement et de faire savoir à tous les musulmans et à tous les gens même s’ils ne sont pas musulman qu’à tel endroit se trouve le mal et qu’il faut faire cesser ce mal là jusqu’à ce que des gens compétents arrivent jusque là bas et fasse cesser le mal en question.
Et on doit inviter les gens à dénoncer eux aussi publiquement le mal qui a lieu et aussi inviter l’auteur du mal à cesser en essayant de le joindre par tous les moyens, de faire obligatoirement une pression public pour faire cesser ce mal comme par exemple en boycottant les produits et en appelant au boycott et en mettant bien des noms sur les produits à boycotter. Cette 2ème partie du hadith est un impératif, un ordre obligatoire à appliquer, au même titre que les 5 prières par jour.
Et le Prophète 3alayhi sallat wa sallam termine le hadit en disant "Et s'il ne le peut pas, alors qu'il le fasse cesser par le cœur, et c'est là, le plus bas degré de la foi" "Wa ine lam yastati3 fa bi qalbihi wa dhalika adh3af al Imane"
Si le musulman ou la Musulmane ne peut ni faire cesser le mal physiquement ni le dénoncer car elle n’a pas de connaissance pour aller le dénoncer alors en ultime recourt il ne reste plus qu’à repousser la chose avec le cœur et ce dernier recourt, c’est le plus bas degré de la foi.
Or le musulman complet agit sur les 3 points.
1) Avec son corps : il met son corps au service de l’islam pour faire cesser physiquement le mal,
2) Avec sa langue : c’est à dire faire savoir, il utilise sa capacité de communication, son savoir dans l’art du parler, avec l’éloquence et toute la puissance verbale qu’Allah lui a donné aussi bien dans la force d’argumentation que dans l’appel au bien. Parler dans un langage adapté par rapport à la situation à l’époque dans laquelle il vit pour mieux se faire entendre et comprendre
3) Avec son cœur : c’est à dire avec son intention sincère uniquement par recherche de l’agrément d’Allah dans le but de sortir sa communauté du mal dans lequel elle se trouve.
Le musulman complet est celui qui agit sur ces 3 tableaux là, et il faut bien prendre garde au sheytan qui dit « moi je n’y vois pas d’intérêt » et généralement ça cache surtout une prise de position qui est celle qui consiste à dire « oui mais les savants de l’islam m'ont dit » et en réalité ce n’est pas "les savants de l’islam ont dit" mais plutôt, un petit groupe bien précis qui veut faire plier la communauté musulmane comme elle elle conçoit l’islam.
Il faut savoir qu’il n’y a que du bien de se retrouver tous ensemble entre musulmans pour dénoncer le mal que subisse nos frères et sœurs.
Par conséquent, il est important de bien expliquer avec douceur et sagesse à nos frères et sœurs qui n’ont pas une grande connaissance de l’islam (et on demande à Allah de nous faire comprendre l'islam) et qui pensent bien faire en suivant ces pseudos savants qui sont en réalité plus connu par l’intermédiaire des millions de pétrodollars mis au service du régime wahabi, que à cause de leur intégrité et leur réponse juste aux questions qui leur sont posé. Il est important de leur expliquer que le fait de manifester relève du droit et du devoir du musulman avec le bon comportement que cela implique et auquel le musulman ne doit pas déroger.
Un des prétexte pour interdire de défendre nos frères et sœurs en manifestant, est la question de la mixité, ils ne conçoivent pas que hommes et femmes soient mélangé.
Puisque cette obédience wahabi se cache derrière le fait de suivre les pieux prédécesseurs ce qui est totalement faux, ils doivent réapprendre à aimer Allah avec un cœur sincère, on ne parle pas de nos frères et sœurs qui se font détourner par ces gens là car eux sont sincères sauf que malheureusement ils sont tombé sur cette mouvance du premier coup et il est impératif de les informer de leur dangerosité.
Pendant les guerres qui opposaient les musulmans aux chrétiens, les épouses des compagnons étaient sur le champ de bataille et étaient mélangé hommes et femmes. Et là il n’y avait aucune sécurité pour ces femmes, elles étaient sur le terrain directement, en contact physique avec l’ennemi, entre les musulmans et les non musulmans.
Si cela avait été haram (comme le prétende les wahabi), est ce que les femmes des compagnons l’auraient fait ? Est ce nous qui allons enseigner au Prophète comment pratiquer l’islam, comment défendre l’islam ? Est ce nous qui allons montrer au Prophète et aux compagnons ce qu’est la mixité ?
Mais malheureusement ces gens endoctrinés suivent de manière aveugle et sans réflexion poussée ces soit disant savants à tel point qu’ils rejetteront tout cela d’un bloc et préfèreront croire ces "savants" plus que Allah et son Prophète.
Le Prophète lui même a envoyé des femmes sur le champ de bataille pour soigner les blessures des musulmans de leur propre main, pour réconforter et soigner les maux des souhaba qui étaient à terre.
La question qui se pose est : était-ce une faute du Prophète ou un ordre du Prophète ? La réponse est claire et évidente. Le pseudo argument de la mixité ne concerne pas notre religion.
Une fois qu’on a résolu ce point là il reste encore le pseudo argument des cris pendant les manifestations.
On a vu que Les épouses des compagnons étaient présente sur le champ de bataille et bien évidement, elles criaient dans les combats, pendant les batailles dans lesquelles elles étaient retranché dans un fort, elles se sont fait attaqué par des armées juives à l’époque, elles sont sortis combattre physiquement et il y a même une des épouses des compagnons qui a tué un ennemi ce qui implique qu'elles étaient en contact direct avec l'ennemi et criait pendant le combat afin de défendre l'Islam.
Ces gens là qui osent faire des fatwas pour interdire aux musulmans de se défendre, de sortir dans la rue, de manifester et crier pour dénoncer le blâmable, puisque soit disant eux dans leur pratique de la religion qui n’est pas la notre, interdisent de dénoncer le mal, toutes ces armées du golf et surtout l’Arabie saoudite qui on le rappel lorsque les états unis ont été frappé par le cyclone catherina qui a fait des dégâts de la taille de la moitié de la France en environ 2 heure, le lendemain les wahabi qui se font appelé http://http://http://salafi.xooit.com/index.php.xooit.com/index.php.xooit.fr/index.php en Europe, et qui prétendent suivre les pieux prédécésseur mais qui ne suivent en réalité que le royaume wahabi, et bien le lendemain ils ont donné 300 000 000 de dollar us aux américains gratuitement et sans aucune contrepartie et ce uniquement pour plaire convenablement et bien faire montrer leur soumission parfaite aux américo-sionistes, et ces même gens, qu’est ce qu’il on donné aux palestiniens ?
Il ont été jusqu’à mettre un grand nombre de savant de l’islam en prison, en particulier le Sheikh Mohammad Souleymane al Mouhisini qui avait fait une invocation de protection à la Mecque à la fin de tarawih pendant ramadhan, il avait demandé à Allah de protéger les musulmans contre le mal des américains et des sionistes, contre le mal que subisse nos frères palestiniens et nos sœurs palestiniennes et pour protéger tous les musulmans dans le monde et la récompense du gouvernement wahabi est qu’ils l’ont jeté en prison comme un malfrat pour montrer leur allégeance parfaite et bien soumise au gouvernement américo-sioniste.
Il l’on jeté en prison juste par le simple fait qu’il a levé les mains pour invoquer Allah, et on rappelle aussi que chez cette mouvance, le fait de lever les mains après salat pour invoquer Dieu c’est interdit (il pratique l’inverse de l’islam).
Ce pays qui a une croyance dévié en elle même achète et accumule des dizaines, des centaines d’avions de combat, des Falcon et de tous ce qu’une armée peu rêver d’avoir, une flotte naval extraordinaire, des tanks, des bases militaires alors puisqu’ils interdisent de manifester dans la rue, eux qui prétendent suivre la souna du Prophète, leur armée à quoi sert-elle ? Des milliards de barils de pétrodollar dans l’armement militaire c’est pour frapper les mécréants ou les musulmans qui sont autour?
En 1991, ces même wahabi qui nous interdisent de protéger nos frères et nos sœurs en manifestant notre mécontentement dehors, ont réussit à faire une fatwa qui légalise et qui autorise en la personne de B E N B A Z à attaquer l’Irak, ils se sont allié au koufar au détriment de leurs frères et sœurs et ils ont autorisé le bombardement de l’Irak. Entre janvier et février il on fait installé sur le sol saoudien , le sol où la meilleur des créatures a mis ses pieds, le Prophète Mohammed 3alayhi sallat wa afdal salam, ils ont fait installé 53 bases militaires américaines avec la prostitution et l’alcool qui coulait à flot pour faire massacrer , torturer, mutiler, voler, spolier et violer des musulmans et musulmanes.
Ceci est le vrai visage de l'obédience wahabi et après ils viennent nous dire de revenir au tawhid, ils donnent des leçons de croyance alors qu’il n’y a pas plus perdu et plus dangereux pour notre communauté qu’eux.
Avec tout le pétrole que Allah leur a donné où est donc passé l’argent pour défendre nos frères et sœurs qui sont en train de baigner dans leur sang?
On a jamais vu d’eux une seule fois une mise en garde contre les personnes qui font du mal aux musulmans, non ils préfèrent faire des mises en garde que contre les musulmans, et il est impératif de dénoncer tous ceux qui font du mal à notre communauté.
Un extrait de la rissala, qui résume bien la réponse à la question:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Rissala/video/x7ogsb_le-message-rissala-part311-vostfr-h_webcam
Manifester n’est pas interdit, au contraire c’est un devoir et une obligation afin de condamner ce qui est blâmable.
http://islam-manifik-soleil.over-blog.com/article-26815526.html

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité