 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});




Avec la mort de Mohammed, la communauté musulmane dut régler le problème de sa succession. Qui deviendrait son prochain leader? Quatre personnes venaient immédiatement à l’esprit : Abou Bakr al-Siddiq, qui non seulement avait émigré avec le Prophète dix ans auparavant, mais avait également été désigné pour mener la prière en congrégation, à la place du Prophète, quelques jours avant le décès de ce dernier; ‘Omar ibn al-Khattab, un homme compétent qui avait été un très fidèle compagnon de Mohammed; Outhman ibn ‘Affan, un des tous premiers convertis, très respecté; et ‘Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre de Mohammed. Leur piété et leur capacité à gouverner les affaires de la nation musulmane faisaient l’unanimité. Lors d’une réunion organisée en vue de choisir un nouveau leader, ‘Omar saisit la main d’Abou Bakr et lui prêta serment d’allégeance, signe traditionnel soulignant la reconnaissance d’un nouveau leader. Dès la tombée du jour, tout le monde avait donné son accord et Abou Bakr devint le premier calife (« successeur ») de Mohammed, ce qui signifiait qu’il allait dès lors gouverner conformément à la loi du Coran et à l’héritage laissé par le Prophète.
Le califat d’Abou Bakr fut bref, mais eut un impact important. Leader exemplaire, il vécut très simplement, remplit ses obligations religieuses avec assiduité, fut accessible en tout temps et très sympathique avec les gens. Mais il sut aussi se montrer très ferme quand certaines tribus, qui n’avaient accepté l’islam que pour la forme, s’en détournèrent après la mort du Prophète. Il réussit à les discipliner promptement. Plus tard, il réussit à obtenir le soutien des tribus de la Péninsule arabe et à canaliser leur énergie contre les puissants empires d’Orient : les Sassaniens en Perse et les Byzantins en Syrie, en Palestine et en Égypte. Bref, il parvint à faire la démonstration de la viabilité de l’État musulman.
Le second calife, ‘Omar – nommé par Abou Bakr – continua de démontrer cette viabilité. Adoptant le surnom d’Amir al-Mou’minine – ou commandant des croyants – ‘Omar étendit l’autorité temporelle de l’islam jusqu’en Syrie, en Égypte, en Irak et en Perse où il connut, d’un point de vue purement militaire, de surprenantes victoires. Dans les quatre années qui suivirent le décès du Prophète, l’État musulman étendit son influence sur toute la Syrie et arriva même, au cours d’une bataille menée lors d’une tempête de sable près de la rivière Yarmouk, à affaiblir la puissance des Byzantins, dont le dirigeant, Héraclius, avait peu de temps auparavant refusé une invitation à embrasser l’islam.
Encore plus surprenant fut le fait que l’État musulman administra les territoires conquis avec une tolérance jamais vue à cette époque. À Damas, par exemple, le leader musulman, Khalid ibn al-Walid, signa un traité qui se lisait comme suit :
Voici ce que Khalid ibn al-Walid accordera aux habitants de Damas s’il y est admis : il leur promet que leur vie, leurs biens et leurs églises seront en sécurité. Leurs cités ne seront pas détruites et aucun musulman ne sera logé dans leurs maisons. Nous venons vers eux avec le pacte de Dieu et la protection de Son prophète, des califes et des croyants. Tant qu’ils paieront leurs impôts locaux, il ne peut leur arriver que du bien.
Cette tolérance était typique de l’islam. Un an après la bataille menée près de la rivière Yarmouk, ‘Omar, qui était au camp militaire d’al-Jabiyah, sur le plateau du Golan, apprit que les Byzantins étaient prêts à rendre Jérusalem. Il s’y rendit donc pour accepter la reddition en personne. Selon ce qu’en a rapporté une source, il entra dans la ville seul, vêtu d’une simple cape, à la stupéfaction d’une population habituée aux costumes somptueux et aux cérémonies des Byzantins et des Persans. Il les étonna encore plus en apaisant leurs craintes par la négociation d’un traité généreux dans lequel il écrivit, entre autres : « Au nom de Dieu... Vous jouissez d’une totale sécurité en ce qui concerne vos églises, qui ne seront point occupées par des musulmans ni détruites. »
Cette politique connut un réel succès partout où elle fut appliquée. En Syrie, par exemple, de nombreux chrétiens qui avaient été impliqués dans de vives disputes théologiques avec les autorités byzantines (et qui avaient même été persécutés par elles), virent en l’établissement de l’islam sur leur territoire la fin de la tyrannie. Et en Égypte, pays qu’Amr ibn al-‘As ravit aux Byzantins après une marche audacieuse à travers le Sinaï, non seulement les chrétiens coptes accueillirent-ils les Arabes à bras ouverts, mais ils les assistèrent avec enthousiasme.
Les mêmes réactions se produisirent à travers l’empire byzantin. Les conflits chez les Grecs orthodoxes et chez les chrétiens syriens monophysites, coptes et nestoriens avaient contribué à l’incapacité des Byzantins – toujours perçus comme des intrus – à obtenir le soutien populaire, tandis que la tolérance que les musulmans démontrèrent envers les chrétiens et les juifs fit en sorte que ces derniers ne s’opposèrent pas à eux.
‘Omar adopta la même attitude dans les affaires administratives. Même s’il désignait un gouverneur musulman à chaque nouvelle province, les administrations byzantines et persanes déjà en place étaient maintenues chaque fois que c’était possible. Il est à souligner, aussi, que durant cinquante ans, le grec demeura la langue de chancellerie de pays comme la Syrie, l’Égypte et la Palestine, tandis que le pehlevi, langue de chancellerie des Sassaniens, continua d’être utilisée en Mésopotamie et en Perse.
‘Omar, qui fut calife pendant dix ans, termina son règne avec une importante victoire sur l’empire persan. La lutte contre le royaume sassanide avait débuté en 687 à al-Qadisiyah, près de Ctesiphon, en Irak, où la cavalerie musulmane avait réussi à mettre en déroute des éléphants que les Persans utilisaient pour l’assaut. Puis, avec la bataille de Nahavand, appelée la « conquête des conquêtes », ‘Omar scella le sort de la Perse : elle allait devenir l’une des plus importantes provinces de l’Empire musulman.
Le califat de ‘Omar fut un point marquant des débuts de l’islam. Il fut remarqué pour son sens de la justice, ses idéaux sociaux, son administration et ses qualités de leader et d’homme d’État. Par ses initiatives, il laissa un héritage durable sur le bien-être de son peuple, sur son système d’impôts et sur la structure financière et administrative de l’empire musulman grandissant.

_-_The_Caliphate_of_Uthman_ibn_Affan_001.jpg) ‘Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l’islam, fut poignardé par un esclave persan zoroastre, Abou Lou’lou’ah, alors qu’il menait la prière du fajr. Tandis qu’il gisait sur son lit de mort, à l’agonie, ceux qui l’entouraient lui demandèrent de nommer un successeur. ‘Omar nomma plutôt six personnes et leur demanda de se consulter entre elles afin de choisir l’une d’elles comme prochain calife.
‘Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l’islam, fut poignardé par un esclave persan zoroastre, Abou Lou’lou’ah, alors qu’il menait la prière du fajr. Tandis qu’il gisait sur son lit de mort, à l’agonie, ceux qui l’entouraient lui demandèrent de nommer un successeur. ‘Omar nomma plutôt six personnes et leur demanda de se consulter entre elles afin de choisir l’une d’elles comme prochain calife.
Ce comité était composé d’Ali ibn Abi Talib, Outhman ibn Affan, Abderrahman ibn Awf, Sad ibn Abi Waqqas, Az-Zoubayr ibn al-Awam et Talhah ibn Oubayd Allah, qui étaient parmi les plus éminents compagnons du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et qui avaient reçu, de leur vivant, l’assurance qu’ils entreraient au Paradis.
‘Omar demanda à ce que le comité choisisse un successeur en moins de trois jours et que ce dernier entre en fonction dès le quatrième jour. Mais après deux jours, aucune décision n’avait encore été prise et les membres du comité s’inquiétaient de voir le temps passer sans qu’ils aient pu parvenir à un consensus. Abderrahman ibn Awf offrit alors de renoncer à sa candidature si tous les autres se conformaient à sa décision. Ils acceptèrent tous sa proposition et le laissèrent choisir seul le nouveau calife. Abderrahman fit passer un entretien à chaque candidat et alla par les rues de Médine consulter le peuple sur leur préférence. Il finit par choisir Outhman, que la majorité des gens avait dit préférer.
Même après sa nomination comme calife, Outhman continua de mener une vie simple. Il aurait pourtant été facile à cet homme d’affaires prospère de mener une vie luxueuse, mais cela ne lui disait rien. Son unique but était de goûter aux plaisirs de l’au-delà, car il savait très bien que ce monde-ci n’est que temporaire et constitue une épreuve pour les hommes. Après sa nomination, il demeura donc aussi généreux qu’il l’avait toujours été.
Les califes étaient normalement payés à partir du trésor public, mais Outhman ne prit jamais aucun salaire pour son travail. De plus, il prit l’habitude de libérer des esclaves chaque vendredi, de voir aux besoins des veuves et des orphelins et de donner en charité sans compter. Sa patience et son endurance firent de lui un leader très apprécié.
Outhman accomplit beaucoup de choses durant son règne. Il encouragea la pacification de la Perse, continua de défendre l’État musulman contre les Byzantins, conquit la Lybie et l’annexa à l’empire musulman et subjugua la quasi totalité de l’Arménie. Par ailleurs, avec l’aide de son cousin Mou’awiyah ibn Abi Soufyan, qui était gouverneur de Syrie, il mit sur pied une armée navale qui réussit à obtenir plusieurs engagements importants de la part des Byzantins.
Mais le geste pour lequel il est le plus connu et qui eut la plus grande importance pour l’islam est sans contredit sa fameuse compilation des textes composant le Coran. Réalisant que le message divin original risquait, par inadvertance, d’être altéré par diverses variantes textuelles, il forma un comité qu’il chargea de colliger les versets originaux et de détruire tout texte comportant une variante. Le livre qui en résulta est celui qui est accepté aujourd’hui encore à travers tout le monde musulman.
Au cours de son califat, Outhman eut à composer avec l’opposition des nouveaux musulmans de nom seulement qui se trouvaient dans les nouvelles terres conquises et qui l’accusaient de ne pas suivre l’exemple du Prophète et des califes précédents dans sa façon de gouverner. Mais les compagnons du Prophète prirent chaque fois sa défense et ces accusations ne le poussèrent pas à modifier sa façon de faire; au contraire, il persista à gouverner avec miséricorde et compassion envers les gens. Même lorsque ses ennemis l’attaquèrent, il n’utilisa pas les fonds publics pour se protéger ou protéger sa maison. Tel que prédit par le prophète Mohammed, les ennemis d’Outhman firent tout en leur pouvoir pour lui rendre la tâche difficile en s’opposant constamment à lui et en l’accusant de tous les maux. Ils complotèrent même contre lui, entourèrent sa maison et s’encouragèrent les uns les autres à aller le tuer.
Plusieurs de ses conseillers lui recommandèrent de faire arrêter ses assaillants, mais il n’en fit rien. Il finit par être assassiné pendant qu’il récitait le Coran, exactement comme l’avait prédit le Prophète. Il mourut en martyr.
Anas ibn Malik a rapporté ce qui suit :
« Un jour, le Prophète grimpa sur le mont Ouhoud avec Abou Bakr, ‘Omar et Outhman. Le mont trembla. Le Prophète dit alors (à la montagne) : « Calme-toi, Ouhoud! Il n’y a sur toi qu’un prophète, un fidèle compagnon et deux martyrs. » (sahih al-Boukhari)


 "En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu." (Sourate ali-Imrân, verset 191)
"En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu." (Sourate ali-Imrân, verset 191)
La pluie est l'un des plus importants facteurs de vie sur terre. Elle est préalable à la présence de vie dans une région. La pluie, bénéfique et indispensable à tout vivant est mentionnée dans de divers versets du Coran où une information substantielle est fournie au sujet de la formation de la pluie, de sa proportion et de ses effets. L'impossibilité qu'une de ces informations soit connue au moment de la révélation du Coran nous prouve que le Coran est la parole d'Allah. Maintenant, examinons l'information fournie par le Coran au sujet de la pluie.
LA PROPORTION DE PLUIE
Dans le onzième verset de la sourate az-Zoukhrouf, la pluie est définie comme l'eau envoyée vers le bas dans une mesure définie:
"Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle Nous ranimons une cité morte [aride]. Ainsi vous serez ressuscités;" (La sourate az-Zoukhrouf, verset 11)
Cette "mesure" mentionnée dans le verset fait appel à certaines caractéristiques de la pluie. Tout d'abord, la quantité de pluie qui tombe sur terre est toujours identique. On estime que dans une seconde, 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la terre. Ce nombre est égal à la quantité d'eau qui tombe sur la terre dans une seconde. Conclusion: L'eau circule sans interruption dans un cycle équilibré selon une "mesure".
D'autres mesures reliées à la pluie concernent sa vitesse en chute. L'altitude minimum des nuages de pluie est de 1200 mètres. Une fois lâché de cette hauteur, un objet ayant les mêmes poids et taille qu'une goutte de pluie, accélère sans cesse et tombe sur la Terre avec une vitesse de 558 km/h.
Certainement, n'importe quel objet qui frappe la Terre avec cette vitesse serait gravement endommagé. Si la pluie tombait justement de la même manière, toutes les terres moissonnées seraient détruites, des zones résidentielles, des maisons et des voitures seraient endommagées, les gens ne pourraient pas marcher dans les rues sans prendre des précautions supplémentaires. En plus, ces calculs sont faits seulement pour des nuages de 1200 mètres de haut, alors qu'il y a également des nuages de pluie à une altitude de 10 000 mètres.
Une goutte de pluie tombant d'une telle hauteur aurait pu normalement atteindre une vitesse très destructive. Mais le scénario de pluie prend un nouveau cours: Quelle que soit la hauteur dont les gouttes tombent, la vitesse moyenne des gouttes de pluie n'est que de 8-10 km/h quand elles atteignent la terre et ce grâce à la forme spéciale qu'elles prennent. Cette forme spéciale augmente l'effet du frottement de l'atmosphère et empêche l'accélération quand les gouttes de pluie atteignent une certaine vitesse "limite". (De nos jours, les parachutes sont conçus en utilisant cette technique.)
Ce n'est pas tout au sujet des "mesures" de la pluie. Par exemple, dans les couches atmosphériques où se forme la pluie, la température peut baisser jusqu'à -400º C. En dépit de ceci, les gouttes de pluie ne se transforment jamais en particules de glace. (Cela signifierait certainement une menace mortelle pour les créatures vivantes sur Terre). C'est parce que l'eau de l'atmosphère est de l'eau pure. L'eau pure gèle même dans des températures très basses.
LA FORMATION DE LA PLUIE
Pendant longtemps, la formation de pluie constituait un grand mystère pour les hommes. Seulement après l'invention des radars d'air, il a pu être possible d'apprendre le mécanisme de la formation des pluies. Celle-ci a lieu en trois étapes: D'abord, "la matière première" de la pluie monte dans le ciel. Plus tard, des nuages se forment et finalement, les gouttes de pluie apparaissent. Ces étapes sont clairement définies dans le Coran, présent déjà depuis des siècles;
"Allah, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, lorsqu'Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent" (La sourate ar-Roum, verset 48)
La première étape: "Allah, c'est Lui qui envoie les vents..." Les bulles d'air innombrables formées par les écumes des océans éclatent et causent l'éjection des particules d'eau vers le ciel. Ces particules qui sont riches en sel sont alors emportées par des vents et se déplacent vers le haut dans l'atmosphère. Ces particules qui s'appellent aérosols forment des nuages en rassemblant autour d'elles-mêmes la vapeur d'eau émanant à son tour des mers, sous forme de gouttelettes infimes, par un mécanisme appelé "le piège d'eau".
La deuxième étape: "...qui soulèvent des nuages; puis Il les étend dans le Ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux." Les nuages sont formés donc de la vapeur d'eau qui se condense autour des cristaux de sel ou des particules de poussière dans le ciel. Puisque les gouttes d'eau qui se trouvent dans ces derniers sont très petites (avec un diamètre entre 0,01 et 0,02 millimètres), les nuages sont suspendus dans l'air et ils s'étendent dans le ciel. Le ciel est ainsi couvert de nuages.
La troisième étape: "Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs." Les particules d'eau qui entourent les cristaux de sel et les particules de poussière prennent du volume petit à petit. Ainsi, les gouttes se forment-elles et, devenant plus lourdes que l'air, quittent les nuages et commencent à tomber sur la terre sous forme de pluie.
Une conclusion s'impose: Chaque étape de la formation de la pluie est annoncée dans les versets du Coran. En outre, ces étapes sont expliquées dans l'ordre où elles ont lieu... Juste comme beaucoup d'autres phénomènes naturels, c'est encore le Coran qui en fournit la description la plus judicieuse et qui, en plus, l'avait fait des siècles auparavant, avant le moindre épanouissement de la science humaine.
La vie donnée à une terre morte dans le Coran: Plusieurs versets attirent notre attention sur une fonction particulière de la pluie: Allah "fait revivre par elle une contrée morte". On rencontre ce même sens dans le verset: "Et c'est Lui qui envoya les vents comme une annonce précédant Sa miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que Nous avons créé.." (La sourate al-Fourqâne, versets 48-49)
Outre que de pourvoir la terre en eau, la pluie a également un effet de fertilisation. Les gouttes de pluie qui atteignent les nuages après s'être évaporées des mers, contiennent certaines substances "qui donneront la vie" à une terre morte, ce sont "les gouttes de tension de surface". Elles se forment au niveau supérieur de la surface de mer qui est appelée "la couche micro" par les biologistes. Dans cette couche, qui est plus mince qu'un dixième d'un millimètre, il y a plusieurs restes organiques causés par la pollution des algues et des zooplanctons microscopiques. Certains de ces restes choisissent et captent quelques éléments qui sont très rares dans l'eau de mer tels que le phosphore, le magnésium, le potassium et certains métaux lourds comme le cuivre, le zinc, le cobalt et le plomb. Ces gouttes chargées d'"engrais" sont élevées vers les couches supérieures de l'atmosphère par les vents et après un moment, elles sont accueillies au sein de la terre avec les gouttes de pluie. Les graines et les plantes terrestres trouvent dans cette manne céleste de divers sels et éléments minéraux nécessaires à leur croissance... On lit toujours à ce sujet dans le Coran:
"Et Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle Nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne" (La sourate Qâf, verset 9)
Les sels qui tombent avec la pluie sont représentatifs de certains engrais (calcium, magnésium, potassium etc.) utilisés pour augmenter la fertilité. Les métaux lourds trouvés dans ces types d'aérosols, d'autre part, sont d'autres éléments qui augmentent la fertilité du sol et assurent un meilleur développement et de meilleurs fruits aux plantes. Les forêts également se développent et sont alimentées à l'aide de ces aérosols d'origine marine. De cette façon, 150 millions de tonnes d'engrais tombent sur la surface totale des terres chaque année. A défaut d'une telle fertilisation naturelle, il y aurait très peu de végétation sur la terre, et l'équilibre écologique serait endommagé. Ce qui est plus intéressant est que cette vérité, apprise par la science moderne seule a été annoncée par Allah dans le Coran il y a plusieurs siècles.
Par Dr. Yahya Harun

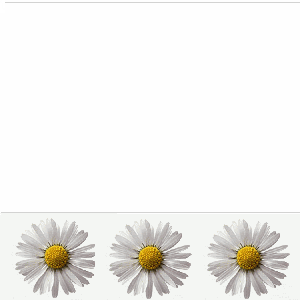
L’époque médiévale
L’histoire s’écrit parfois davantage en filigranes qu’en traits pleins. C‘est le cas lorsqu’il s’agit des rapports entre des voies spirituelles ou ésotériques issues de religions différentes. Si l’influence de la civilisation islamique sur l’Europe est avérée dans les domaines des sciences et de la philosophie, nous sommes par contre réduits à des « conjectures » en ce qui concerne la discipline du soufisme (tasawwuf) . A l’époque médiévale, les docteurs chrétiens d’Europe focalisent clairement leur intérêt pour les auteurs musulmans sur la pensée aristotélicienne. De Ghazâlî (« Algazel », m. 1111), ils traduisent les textes philosophiques mais non les écrits mystiques, pourtant bien diffusés en terre d’islam, et ils prennent d’Ibn Sab‘în le logicien et le philosophe, non le métaphysicien extatique de « l’Unicité absolue ». Que le maître andalou Ibn ‘Arabî (m. 1240) n’ait pas été connu en Europe avant l’époque moderne – son influence sur Dante, à ce jour, reste plus qu’hypothétique – n’est guère étonnant pour deux raisons au moins : en pays musulman même, son œuvre a circulé longtemps dans des milieux restreints, et les latins n’avaient pas les clés pour déchiffrer son langage le plus souvent hermétique. Mais que les manuels de soufisme rédigés aux Xe et XIe siècles n’aient reçu aucun écho en Europe ne cesse de surprendre. Le Catalan Ramon Lulle (m. 1315) a certainement eu accès à la littérature mystique de l’islam et côtoyé des milieux soufis, à Majorque et au Maghreb, mais sans réellement s’en pénétrer . Quoi qu’il en soit, il ne relève pas du monde français qui nous retient ici. La mystique juive médiévale, en revanche, témoigne d’une imprégnation profonde – et avouée – par le tasawwuf, au Moyen Orient, en Espagne musulmane, et jusqu’en Catalogne et en Provence. L’influence supputée du soufisme sur Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix aurait cheminé via les mystiques juifs espagnols. Par ailleurs, les sciences occultes telles que l’alchimie, l’astrologie ou l’arithmologie doivent beaucoup au monde de l’islam, mais elles ne sauraient être identifiées à la discipline du tasawwuf.
Dans les milieux spiritualistes contemporains, d’obédience musulmane ou chrétienne, on affirme que les voies soufies, et les groupes ésotériques d’Orient en général, auraient alimenté sur le plan initiatique des organisations correspondantes d’Europe. Si certains historiens conviennent que l’art héraldique de la chevalerie européenne a une dette à l’égard du monde musulman , il faut être plus prudent quant à l’origine islamique de la chevalerie elle-même. La futuwwa, qui jouait au Moyen Orient le rôle à la fois d’une chevalerie spirituelle et d’une initiation aux métiers, a-t-elle eu une part quelconque dans la formation de la chevalerie européenne ? Henry Corbin note d’abord que la futuwwa est œcuménique en soi car son fondateur symbolique en serait Abraham, père des trois monothéismes. Il souligne maintes fois les analogies et les concomitances existant entre cette futuwwa et la chevalerie européenne telle que celle du Temple . Plus rarement, il évoque une influence directe de l’ésotérisme islamique – soufi ou ismaélien – sur les Templiers , mais il ne fournit aucun élément historique objectif. La légende du Graal, il est vrai, telle qu’elle apparaît dans le Parzival de Wolfram von Eschenbach, écrit à l’époque de la quatrième croisade, véhicule des données provenant de plusieurs traditions ésotériques orientales . La version ‘française’ de la légende par Chrétien de Troyes, un peu antérieure à celle de Wolfram, en est, elle, cependant, totalement dépourvue. René Guénon lui aussi affirme que les Templiers auraient été en contact effectif avec les milieux initiatiques du Proche Orient et que, après leur élimination par le roi Philippe le Bel (1314), les initiés chrétiens se seraient réorganisés en accord avec les initiés musulmans . Il n’apporte, lui non plus, aucun justificatif concret. Certes, les Templiers se sont montrés plus tolérants que les autres Francs. Ainsi, un chroniqueur musulman témoigne que des Templiers sont intervenus à plusieurs reprises, à Jérusalem, pour chasser un Franc qui voulait l’empêcher de prier . On peut même admettre que l’Ordre, de militaire, soit devenu de plus en plus mystique, mais cela ne signifie pas qu’il ait été perméable à l’islam ou à son ésotérisme. Les sources arabes s’en seraient fait l’écho et, au demeurant, elles montrent que les soufis considéraient tous les Francs comme des envahisseurs et des ennemis, et qu’ils les combattaient. Les chiites ismaéliens pratiquaient entre eux la discipline de l’arcane, et on les voit mal initier des guerriers francs. Des échanges en matière de spiritualité ont sans doute eu lieu, mais les visées politiques devaient prédominer.
Guénon va plus loin concernant les Rose Croix – dont les modernes Rosicruciens se prétendent les héritiers – puisqu’il y aurait eu, selon lui, une sorte d’osmose initiatique entre ceux-ci et les soufis . Les premiers se seraient retirés en « Orient » au XVIIe siècle, lorsque toute possibilité de véritable initiation aurait disparu en Occident . Ailleurs, il affirme que les Rose Croix, qu’il se voit fondé à appeler « ‘‘soufis’’ européens », établissaient un contact permanent avec les soufis . Ces données relèvent plus de la métahistoire que de la discipline historique critique, mais c’est, pour notre domaine, une dimension que l’on ne peut écarter. L’intérêt de ces assertions provient aussi du fait qu’elles proviennent de René Guénon. Des affinités entre Saint François d’Assise et le soufisme, concernant notamment la doctrine de la « pauvreté spirituelle », ont été notées, d’autant plus que François s’est rendu en Egypte où il a pu échanger avec le sultan et des oulémas, mais il est italien… Des Franciscains français contemporains ont cependant écrit sur ce sujet.
Une des seules traces tangibles de la présence du soufisme en France à l’époque médiévale provient d’un proche du roi Saint Louis, son chroniqueur et ami Joinville (m. 1317). Celui-ci cite le Dominicain Yves Le Breton, arabisant, qui avait rencontré à Acre au XIIIe siècle une femme tenant le même langage sur l’amour divin que Râbi‘a ‘Adawiyya (m. 801), la sainte musulmane la plus renommée en terre d’islam. Cette sainte irakienne n’est pas identifiée par Joinville, mais sa figure mythifiée va nourrir le débat théologique sur l’amour de Dieu qui agite la France… au XVIIe siècle, et elle suscite l’admiration des partisans du Pur Amour : il faut aimer Dieu ni par désir de Son paradis ni par crainte de Son enfer . Pour autant, cette légende transmuée de Râbi‘a ne prouve en rien une réception positive du soufisme en France.
D’évidence, la présence franque au Proche Orient a permis des contacts entre chrétiens et musulmans, au gré, notamment, des alliances entre les princes des deux camps. Dans le cadre général de l’affrontement entre croisés et musulmans, cependant, le commerce des esprits ne pouvait s’effectuer que de manière discrète et orale, ce qui explique la trace infime qu’il a laissée. La guerre elle-même a été une occasion de connaissance mutuelle, et parfois de ‘‘transfert’’ religieux : un des Francs qui attaquaient Damiette en 1249 (avec St Louis : septième croisade) serait entré en islam après avoir tué un saint musulman qui lui aurait miraculeusement répondu après sa mort . Pour autant, à lire les sources arabes, de tels cas sont très exceptionnels.
L’époque moderne
Hormis quelques relations de voyageurs français ayant décrit, entre les XVIe et XVIIIe siècles, avec force partialité, les milieux des « derviches » en Orient (de Nicolay, Chardin…), ou encore la traduction française des Mille et Une Nuits par Galland, à la fin du XVIIIe siècle, où figurent les exploits des Kalandars, il faut attendre le XIXe siècle pour que le public français ait accès à une connaissance plus objective du soufisme. Le Voyage en Orient de Gérard de Nerval (1843) représente à cet égard une rupture décisive, par le témoignage empathique qu’il livre, voire la profonde fascination qu’exercent sur l’auteur les derviches du Caire et d’Istanbul.
Le terme occidental « soufisme » apparaît, sous la forme latine de Ssufismus, dans un ouvrage publié à Berlin en 1821. La première moitié du XIXe siècle voit se développer l’orientalisme académique, dans lequel la France occupe une place prépondérante. Le soufisme suscite dès lors un nombre croissant d’études et de traductions, centrées d’abord sur le monde persan. D’évidence, cette érudition un peu sèche n’est pas animée par une quête intérieure, comme c’était le cas chez les auteurs médiévaux , et de plus elle charrie implicitement l’idéologie de la suprématie européenne ; elle fournit pourtant une matière objective qui va nourrir les générations postérieures. Parallèlement, des officiers français des « affaires indigènes », motivés, certes, par le contrôle des populations locales, vont rédiger des rapports et des ouvrages très documentés sur les confréries maghrébines.
Au XXe siècle, l’orientalisme français joue un rôle de plus en plus déterminant dans la connaissance ‘‘gustative’’ du soufisme, du fait sans doute que ses plus éminents spécialistes sont eux-mêmes engagés dans une quête spirituelle. Dans leur démarche respective de chrétiens, Louis Massignon et Henry Corbin se sont alimentés à la mystique musulmane et, à leur tour, ont alimenté un public se situant à la limite entre académisme et recherche intérieure. Si leur enjeu personnel affleure souvent dans leur travail et s’il infléchit parfois leur objectivité, leur riche personnalité a contribué à diffuser la culture soufie en France. Les ‘‘soufis’’ contemporains reconnaissent également une dette à l’égard de religieux chrétiens qui ont présenté des pans majeurs du patrimoine soufi : Louis Gardet, Laugier de Beaurecueil, Paul Nwyia… Certains chercheurs ont conjoint domaine d’étude et orientation spirituelle en pratiquant l’islam soufi, tel Eva de Vitray-Meyerovitch (m. 1998) et Michel Chodkiewicz.
La première présence effective en France d’un soufi ou d’un groupe soufi remonte à nul autre que l’émir Abd El-Kader, qui a été retenu dans notre pays durant cinq années (1847-1852). Tous les Français qui l’ont alors approché ont été séduits par son charisme, et des documents inédits nous montrent des sœurs chrétiennes désirant le suivre jusque dans son exil spirituel en Orient.
Le paradoxe du colonialisme français, à la fin du XIXe siècle, est qu’il permet à quelques nationaux issus de la métropole d’échapper à la civilisation d’ores et déjà désenchantée de l’Occident, et de se ressourcer dans le « désert », ou en « Orient », comme on voudra. Ces premiers soufis français – ou de culture française – sont souvent des artistes-peintres (Etienne Dinet, Yvan Agueli) ou des écrivains (Isabelle Eberhardt). Ils souscrivent au ‘‘mythe’’ de l’Orient spirituel et l’incarnent dans leur vie et leur œuvre. Ils se rattachent à des confréries régulières, et ceux qui vivent en Algérie sont rejetés par des colons français. L’importance d’Agueli réside dans le fait qu’il a planté le premier arbre initiatique en France et qu’il a affilié Guénon à la Shâdhiliyya, en 1912, à Paris même. Le parcours – bref, puisqu’elle est morte à vingt-sept ans – d’Isabelle Eberhardt (m. 1904) est plus fantasque. Ses origines sont troubles, puisque certains attribuent sa paternité à Arthur Rimbaud. Devenue française en épousant un soufi algérien, elle pratique dûment le soufisme dans la confrérie Rahmâniyya . Même lorsqu’elle ne possède pas cette texture légendaire, la vie de ces pionniers devient par la suite un roman. Ainsi d’Aurélie Picard (m. 1933), héroïne de Djebel Amour (Frison Roche), Lorraine qui épouse en 1872 un cheikh tijâni du Sud algérien et développe la grande zâwiya après la mort de celui-ci. Autre figure féminine atypique de cette période, la comtesse Valentine de Saint Point (m. 1953), arrière petite-nièce de Lamartine qui, après avoir mené une vie excentrique en Occident, entre en islam et s’établit au Caire, où elle est proche de Guénon. René Guénon est le principal artisan de la pénétration du soufisme en France au XXe siècle. Sa pratique islamique et son appartenance soufie ont pourtant été marquées du sceau de la discrétion, mais son œuvre ainsi que la correspondance qu’il a entretenue avec beaucoup de ‘‘chercheurs de vérité’’, a déterminé l’entrée dans la Voie de nombreux Français ; ceux-ci seront souvent affiliés à la même voie-mère que Guénon, la Shâdhiliyya, qui a généralement incarné un soufisme sobre et lettré. Son œuvre formule à l’intention du public européen la doctrine de la « Tradition primordiale », d’où émanent toutes les religions historiques, et la dégénérescence de la modernité occidentale. Le « cheikh ‘Abd al-Wâhid Yahia », tel qu’il est connu en milieu musulman, établi au Caire en 1930 et décédé en 1951, continue d’exercer une influence singulière en Occident et dans quelques cercles en terre d’islam. De Guénon est issu le courant ‘‘traditionnaliste’’ du soufisme occidental, dont la figure majeure est Frithjof Schuon (m. 1998). Artiste et poète, celui-ci rédige une œuvre doctrinale puissante ; depuis la Suisse où il réside jusqu’en 1981, date de son installation aux USA, il touche surtout des intellectuels occidentaux. Son représentant initial à Paris, le Roumain Michel Vâlsan (m. 1974), lui reproche en 1950 de s’affranchir de plus en plus de la norme islamique et de verser dans le syncrétisme. A l’instigation de Guénon, Vâlsan, éditeur des Editions traditionnelles à Paris, fonde sa propre voie, centrée sur l’enseignement d’Ibn ‘Arabî. Plusieurs de ses disciples français, universitaires ou autodidactes, proposent au public des études et des traductions de textes majeurs du patrimoine soufi.
L’époque contemporaine
a) Le paysage confrérique
Implantée en France depuis les années 1920, la tarîqa ‘Alâwiyya, toutes branches confondues, est la voie qui a le plus marqué le soufisme français au XXe siècle. Initiée par un saint au charisme incontesté, le cheikh algérien Ahmad al-‘Alâwî (m. 1934), elle a été orientée dès ses débuts vers une ouverture au monde chrétien d’Europe, et a compté rapidement dans ses rangs des disciples français. Le cheikh ‘Adda Bentounès, successeur du cheikh ‘Alâwî, a ainsi créé l’association « Les Amis de l’Islam » en 1949 à Paris, dans le but de mieux faire connaître l’islam spirituel en Europe.
À partir des années 1970, on assiste à un développement très rapide de la présence du soufisme en Europe, et notamment en France. Plusieurs groupes soufis émanant des grandes voies - Shâdhiliyya, Naqshbandiyya, Qâdiriyya, Tijâniyya…- voient alors le jour. Cette expansion n’est pas une simple conséquence de l’émigration, car les cheikhs ‘‘orientaux’’ considèrent depuis longtemps l’Occident comme une terre providentielle. Constatant que la pression socio-politique qui pèse dans leurs pays peut entraver le développement individuel, ils voient dans l’Occident un espace de liberté et constatent une réelle attente dans le domaine spirituel. Des musulmans de souche, étudiants ou travailleurs, découvrent ainsi en Occident un soufisme dans lequel ils ne voyaient que superstition ou routine. Quelques maîtres ‘‘orientaux’’ s’y établissent bientôt, tandis qu’un petit nombre d’Occidentaux formés opèrent comme représentants d’un maître étranger, ou accèdent au statut de cheikh. Ainsi, le cheikh Khaled Bentounès, maître actuel de la ‘Alâwiyya, vit en France, où il s’efforce de porter le message universaliste du soufisme. La zâwiya-mère, cependant, reste à Mostaganem, dans l’Ouest algérien. F. Schuon était issu de la ‘Alâwiyya, et l’on retrouve chez lui, exprimé différemment, cet universalisme, ainsi qu’un fort impact en milieu chrétien. Il a d’ailleurs nommé sa voie « la voie de Marie », al-Maryamiyya.
Le monde confrérique français est très fluide, à l’image de ce qu’il est ou était en pays musulman. La Shâdhiliyya par exemple, fondée au XIIIe siècle en Egypte, est représentée par la ‘Alâwiyya et ses ramifications (dont la Madaniyya tunisienne), par plusieurs groupes provenant de la Darqâwiyya (Maroc – XVIIIe siècle), ou encore se rattachant à l’héritage de Michel Vâlsan, etc. Une voie-mère peut donner naissance à des groupes très différents quant aux options et aux modalités choisies, comme cela apparaît dans la Naqshbandiyya. Certains groupes sont volontairement discrets, tandis que d’autres affichent leur prosélytisme. La Butchîchiyya marocaine, qui se rattache à la voie-mère Qâdiriyya, consacre beaucoup d’énergie à médiatiser le message de cheikh Hamza, par le biais de sites Internet, séminaires, concerts, mais aussi des conférences assurées par Faouzi Skali, représentant de la voie connu en France. Puisque désormais « c’est le maître qui cherche le disciple », il faut toucher un public large, même non musulman.
Ce monde confrérique est également fluide en raison de ses origines géographiques diverses, et l’on peut dire que l’Europe, et en particulier la France, sont en train de devenir une terre de rencontre entre les différentes traditions du soufisme existant dans le monde musulman. Si l’Iran est quelque peu présent grâce aux Ni‘matullahis et aux Uvaysis, de la Turquie viennent plusieurs groupes naqshbandis, du Soudan les Burhânis, du Maghreb – hormis la grande famille shâdhilie – les Tijânis, et d’Afrique sub-saharienne les Tijânis et les Mourides. Ceux-ci ont des relais communautaires importants en France, car liés à un système complexe d’immigration du Sénégal vers la France.
Toute cette mouvance se prévaut d’un soufisme orthodoxe, car les affiliés restent fidèles aux prescriptions de l’islam et sont parfois versés dans les sciences islamiques. La plupart des membres gardent un lien avec l’un ou l’autre pays musulman, et effectuent des visites régulières à leur zâwiya-mère respective. La question de l’adaptation au contexte occidental n’est pas résolue dans tous les cas : parmi ceux qui ont été initiés et formés en Orient, certains ont tendance à importer des coutumes arabes, africaines ou autres.
D’autres groupes se sont en revanche détachés de la forme islamique pour mieux dégager, à leurs yeux, l’universalisme de la sagesse soufie. Ouvrant la porte du syncrétisme, ces groupes appellent de leurs voeux une sorte de "mondialisation" de l’Esprit. Ils participent de ce que certains appellent le « néo-soufisme », qui désigne un courant purement occidental professant un soufisme radicalement différent de celui pratiqué en pays musulman . Ses représentants sont souvent des ‘‘orientaux’’ tels qu’Idries Shah, en Angleterre, et Pir Vilayat Khan, aux USA et en France. Les adeptes du soufisme ‘‘islamique’’ les tiennent pour des charlatans, et rappellent qu’il n’y a d’initiation qu’à l’intérieur d’une forme religieuse définie. Pour eux, l’universalisme ne nécessite nul syncrétisme, car il s’énonce dans l’exploration de la révélation islamique.
D’une façon générale, le soufisme de France professe l’orthodoxie pour plusieurs raisons : - la religion musulmane est de plus en plus prégnante en France, et elle modèle aussi les comportements des soufis, - le soufisme de France est encore imprégné du fidéisme qui prévaut en pays musulman, - l’influence de Guénon, qui porte à l’intériorisation, reste très présente et censure des comportements de type New Age, que l’on trouve plus facilement en climat anglo-saxon.
b) Aspects sociaux et culturels
Les confréries soufies répondent à une double logique :
elles constituent souvent le point d’aboutissement d’une recherche individuelle, qu’il s’agisse de ‘‘convertis’’ ou de musulmans natifs découvrant le soufisme, ou redécouvrant l’islam par le soufisme. « La conversion individualise les expériences, la confrérie les rassemble ».
elles assurent le cadre protecteur de ces démarches individuelles, en prônant un esprit de groupe plus ou moins prononcé. Les voies où la méthode est sobre ou intellectualisée jouent moins sur ce sentiment d’appartenance confrérique.
Le profil social des affilés au soufisme est plus varié que celui des musulmans en général, car on y rencontre davantage de personnes atypiques, pluriculturelles par exemple, ou ayant un parcours complexe. Le nombre des ‘‘convertis’’ y est nettement supérieur : sauf dans des groupes d’immigrés repliés sur eux-mêmes, il oscille entre un quart des adeptes à …la quasi-totalité ; c’est le cas dans la Idrîsiyya du cheikh italien Abd al-Wahid Pallavicini, dont le représentant le plus connu en France est Abd al-Haqq Guiderdoni. Les ‘‘convertis’’ se situent généralement à un niveau social et intellectuel supérieur à celui des immigrés ou descendants des immigrés, mais il faudrait observer des nuances. Un petit nombre d’entre eux a donc un rôle naturel de médiation entre islam et christianisme, cultures ‘‘orientales’’ et culture française. Les disparités peuvent être gênantes au sein même d’une confrérie ; c’est pourquoi la Butchîchiyya a opté pour la séparation entre disciples d’origine marocaine et disciples de souche européenne. Les clivages peuvent être aussi générationnels, et dus à des questions linguistiques : les anciens connaissent l’arabe mais parlent mal le français, et les jeunes l’inverse.
Une confrérie un peu élargie a en son sein des adeptes aux profils très variés, car le charisme du cheikh, ou de son représentant, est supposé estomper ces différences. Dans l’histoire des pays d’islam, les confréries traversaient le plus souvent toutes les classes sociales. Le groupe ou la zâwiya propose d’évidence un espace de sociabilité, un réseau de solidarité, tantôt réconfortant, tantôt stimulant, et qui est assez souple pour accepter ou intégrer des êtres en recherche ou fragilisés par leurs expériences antérieures. Quoi qu’il en soit, les cheikhs demandent à leurs disciples de poursuivre leurs études, d’acquérir des qualifications et donc une reconnaissance sociale. Ils refusent que se reproduise en France le schéma d’un confrérisme populaire qui, attaqué par les salafis et les réformistes, n’a que trop nui à l’image du soufisme en pays musulman.
A l’échelle individuelle ou collective, les soufis se disent apolitiques, et se montrent méfiants à l’égard des idéologies. Certains se refusent à tout engagement dans la cité, considérant que leur rôle est ailleurs, mais d’autres pensent que les spirituels musulmans doivent s’investir dans la vie publique, pour susciter une alternative à l’islamisme, ou à l’islam-affairisme, et aussi pour proposer à la société moderne des remèdes aux maux dont elle souffre. Cet engagement peut bien sûr, en parallèle, servir les intérêts de la confrérie et contribuer à sa promotion. Pour l’instant, l’implication strictement politique se réduit, pour les soufis, à participer, à un niveau ou à un autre, au Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), non sans difficulté d’ailleurs .
Le terrain de prédilection des soufis français reste la culture. Beaucoup de groupes, déclarés en associations de type loi 1901, organisent séminaires de formation sur l’islam ou sur le soufisme, colloques, conférences et expositions, parfois à un haut niveau (Unesco, Sénat, Conseil de l’Europe, dans le cas de la ‘Alâwiyya). La dimension interreligieuse y est souvent présente . L’organe de la Idrîsiyya franco-italienne est l’Institut des Hautes Etudes Islamiques d’Embrun, qui édite des Cahiers thématiques et organise des colloques ; la ‘Alâwiyya intervient dans le cadre de Terres d’Europe, qui a remplacé Les Amis de l’Islam, et constitue un projet de fondation ; la Butchîchiyya publie la revue Soufisme d’Orient et d’Occident ; Muhammad Vâlsan, fils du cheikh Vâlsan, édite une « revue d’études traditionnelles », Science sacrée, dans un esprit très guénonien, etc. Les publications individuelles, provenant de divers courants du soufisme français, gardent un rythme conséquent, ainsi que les traductions de textes soufis, dont la qualité est toutefois inégale. L’émission télévisée islamique du dimanche matin avait précédemment comme animateur Abd al-Haqq Guiderdoni, déjà cité, et elle continue à s’intéresser au soufisme. Au XIIe siècle, les soufis du Proche Orient ont été en grande partie à l’origine de la célébration du Mawlid, fête anniversaire de la naissance du Prophète, et de la même façon Terres d’Europe a institué cette célébration sous forme publique, à Paris. Le soufisme de France, encore jeune, bénéficie d’une faculté d’adaptation susceptible de créer des formes inédites , et d’une liberté doctrinale qui fait défaut dans certains pays musulmans : les travaux fondamentaux accomplis sur la métaphysique d’Ibn ‘Arabî, en France notamment, n’auraient pu y voir le jour. L’Occident est aussi un terrain privilégié de rencontre entre les spiritualités, pas uniquement ‘‘monothéistes’’ .
L’attraction que le soufisme exerce actuellement en France, palpable chez le public féminin en particulier, dépasse le phénomène de mode. Elle correspond à un besoin réel de spiritualité et de sagesse dans ce monde en perte de valeurs et de repères intérieurs, besoin qui s’exprime également dans d’autres spiritualités représentées sur notre territoire. En France, le soufisme peut apporter une réponse aux jeunes ‘‘issus de l’immigration’’ qui revendiquent une spiritualité universaliste puisque, à l’instar des autres membres de la société, ils sont pris dans la spirale de la mondialisation. Par sa verticalité, le soufisme peut les aider à s’ancrer dans une tradition islamique millénaire, par le biais du rattachement à l’une des grandes voies, mais aussi à se libérer des réflexes identitaires, des carcans ethniques ou familiaux.
Au-delà d’un apport proprement initiatique qui ne peut concerner qu’un nombre restreint de personnes, la culture soufie contribue à restaurer la primordialité spirituelle du message islamique, trop souvent étouffée par le juridisme, et à briser les facteurs d’instrumentalisation de la religion. S’il offre une voie spirituelle à certains Européens, le soufisme sert plus largement de médiateur entre l’islam et l’Occident.

|
|

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité