 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});



"La disparition du racisme, comme c'est le cas chez les Musulmans, est une des réussites les plus marquantes de l'Islam et il y a dans le monde contemporain, une urgente nécessité à propager cette vertu islamique..."
A.J. Toynbee "Civilization on Trial", New York, 1948, p. 205.

Avec 9 kcal/g, les lipides sont les macronutriments les plus énergétiques de l’alimentation. Ils sont indispensables pour nos activités quotidiennes et lorsque l’on en consomme plus que nécessaire, ils sont mis en réserve et stockés dans les cellules graisseuses. Mais leur rôle n’est pas seulement énergétique. Les lipides sont très importants pour la santé parce qu’ils constituent la structure des membranes de nos cellules et par là conditionnent leur bon fonctionnement et donc celui des organes auxquels elles appartiennent.
Le DHA (acide docosahexaénoique) est un acide gras de la famille des Oméga 3. On le trouve surtout dans les poissons gras, comme le saumon, le thon, le hareng, la sardine, le maquereau...
En plus de ses effets bénéfiques sur la prévention des risques de maladies cardiovasculaires, le DHA joue un rôle très important sur la vision, le système nerveux, le cerveau...à tous les âges de la vie ! Preuve de son importance, dans la nouvelle version des Apports Nutritionnels Conseillés, revus en 2010, pour le DHA, l'apport a été augmenté pour les adultes à 250mg (contre 100 mg auparavant).
Place du DHA dans le système nerveux
Le DHA est un constituant essentiel des membranes des cellules, et en particulier des neurones. Il joue également un rôle fondamental au niveau de la rétine et améliore ainsi la vision. Notre cerveau et nos neurones ont quotidiennement besoin de DHA !
DHA et développement du cerveau chez l'enfant
Les Oméga 3, et notamment le DHA, sont indispensables à la croissance et au développement du cerveau pendant la période foetale et la petite enfance. C'est pour cette raison que l'on conseille aux jeunes mamans de pratiquer l'allaitement (le lait maternel étant très riche en Oméga 3 et Oméga 6) ou d'avoir recours à des laits enrichis. Des études scientifiques mettent en évidence l'effet du DHA sur le développement de la vision, de l'apprentissage, du QI...
DHA chez la femme enceinte et allaitante
La composition en acides gras du liquide amniotique et du lait maternel est très dépendante de l'alimentation de la femme enceinte puis allaitante. Une femme enceinte dispose de ses propres réserves en Oméga 3 mais celles-ci ne sont pas forcément suffisantes pour satisfaire ses besoins et ceux du foetus. Il est donc essentiel pour toute femme en âge de procréer de veiller à son alimentation en Oméga 3 et en particulier en DHA, car ceux-ci sont essentiels pour assurer un bon développement cérébral à son bébé.
Le DHA et la lutte contre les déficiences intellectuelles chez les personnes agées
Le cerveau adulte évolue en permanence et avec l'âge, certaines des ses fonctions peuvent être affectées. Plusieurs études montrent que la consommation régulière d'Oméga 3, notamment de DHA, permettrait de ralentir le vieillissement cérébral et de diminuer les risques d'apparition de démence, de maladies d'Alzheimer...
Les sources de DHA
Penser huiles… et escargots !
Chez les végétaux, on trouvera donc surtout un type d’Oméga 3 : l’acide alpha linolénique (ALA). Seul souci : celui-ci a une biodisponibilité assez faible dans l’organisme. D’abord, une grande partie va entrer dans d’autres réactions chimiques que celles qui permettent de fabriquer les EPA et DHA. Il est donc essentiel d’en consommer beaucoup pour parvenir à des taux intéressants en Oméga 3.
Il faut donc favoriser la consommation de végétaux qui en contiennent beaucoup, sous forme d’huiles végétales notamment, pour qu’ils soient concentrés : huiles de colza, de soja, de noix. A noter : l’huile de lin est également une source intéressante, mais elle est interdite en France. Certaines personnes ayant été intoxiquées en consommant de l’huile de lin destinées à la peinture…
Les autres végétaux intéressant sont le pourpier, la mâche, la salade, les épinards… Certes, leurs apports restent assez faibles en quantité, mais leur consommation régulière participe aux apports. Si les sources d’acide alpha linolénique (ALA) sont principalement végétales, pour faire le plein, il faut consommer… la viande des herbivores ! A condition toutefois qu’il ne s’agisse pas de ruminants, leur estomac détruisant partiellement ces Oméga 3. Ainsi, les animaux les plus intéressants sont le lapin, l’oie, le cheval, le gibier sauvage ou les escargots !
Incontournable poisson…
Notre organisme synthétisant faiblement les acides gras EPA et DHA à partir des Oméga 3 des végétaux, il faut impérativement que l’alimentation apporte également ces deux acides gras "terminaux". Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées ou les diabétiques. Et là, pas de mystère, les poissons gras sont incontournables, notamment le saumon, les maquereaux ou les harengs. Ces poissons contiennent des Oméga 3 parce qu’ils ont consommé directement ou indirectement du phytoplancton, riche en ALA, qu’ils ont transformé en EPA et DHA. Mais il existe des différences de teneur en Oméga 3 selon la période de l’année et la provenance (élevage ou sauvage). Schématiquement, on trouve un peu plus d’Oméga 3 dans les poissons d’élevage toute l’année, et dans les poissons sauvages l’été.
A noter : certaines algues produisent également des dérivés des Oméga 3, mais leur consommation reste réservée aux amateurs des légumes de la mer…
Des sources triples !
Mais il existe aujourd’hui des filières qui proposent d’enrichir « naturellement » les animaux d’élevages en Oméga 3, pour augmenter leur valeur nutritionnelle. C’est le cas, lorsqu’on ajoute des graines de lin dans l’alimentation des poules ou des vaches, pour obtenir du lait ou des oeufs enrichis. Ces aliments présentent alors un triple avantage : ils contiennent à la fois de l’ALA, de l’EPA et du DHA !
Une autre source qui va combiner tous les types d’Oméga 3 : le surimi ! Car dans sa composition, on trouve des filets de poisson associés à de l’huile de colza (avec aussi de l’amidon et des oeufs). Deux sources qui vont apporter des Oméga 3 animaux et végétaux.
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/dossiers/omega-3/9075-omega3-sources.htm
http://www.lesieur.fr/Nutrition/La-matiere-grasse/Omega-3/Le-DHA-l-allie-de-notre-cerveau


Un moyen simple de renforcer votre système immunitaire est d'être généreux avec les herbes, les épices et condiments dans votre cuisine.
Afrique, Caraïbes, Amérique, Chine, Thaïlande, Inde, pays arabes, Europe de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, où que vous alliez, les civilisations du monde entier ont toujours fait un usage intensif des épices, et ce pour de bonnes raisons.
Les herbes et épices sont un moyen simple et accessible à toutes les bourses de donner bon goût à la nourriture tout en augmentant les qualités nutritionnelles et thérapeutiques des aliments.
L'ail, en particulier, est apprécié dans la plupart des civilisations pour ses vertus curatives, notamment contre les maladies infectieuses telles que le rhume et la grippe.
Cela est probablement dû à ses effets stimulants du système immunitaire. L'ail frais est un puissant agent antibactérien, antiviral, et antifongique.
La pénicilline russe
Connu sous le nom scientifique de Allium sativa, l'ail est connu historiquement pour ses capacités à combattre les virus et les bactéries. Les anciens Egyptiens recommandaient l'ail pour 22 maladies. Selon un papyrus datant de 1500 avant JC, les ouvriers construisant les pyramides en mangeaient pour augmenter leur endurance et rester en bonne santé.
A partir du Moyen-Âge, l'ail fut utilisé pour soigner les blessures. Il était broyé ou découpé en tranches, puis appliqué directement sur les plaies pour empêcher que l'infection ne s'étende.
Louis Pasteur remarqua en 1858 qu'asperger les bactéries avec du jus d'ail les faisait mourir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes faisaient un usage intensif d'une préparation à base d'ail sur les champs de bataille, à tel point que les Alliés la baptisèrent « pénicilline russe ».
Pour fabriquer de la pénicilline russe, prenez deux pamplemousses, six citrons, deux oignons et sept gousses d'ail.
Pelez l'oignon et l'ail, et coupez-les en petits morceaux. Lavez les pamplemousses et les citrons sans les peler. Mettez le tout dans une casserole en acier inoxydable avec deux litres d'eau distillée. Portez à ébullition. Réduisez immédiatement le feu et laissez mijoter pendant 10 minutes. Ajoutez 1/2 cuillère à café de poivre de Cayenne au cours des 3 dernières minutes de cuisson. Filtrez puis buvez un verre de cette préparation, 3 à 4 fois par jour ou au besoin. A utiliser pour les rhumes, les allergies, les infections des sinus ou des infections mineures. La préparation peut être conservée 3 semaines au réfrigérateur dans un récipient fermé.
L'ail : à la veille de la saison du rhume et de la grippe
Les encyclopédies de médecine naturelle attribuent à l'ail un nombre impressionnant de vertus thérapeutiques. (1) J'en ai relevé plus de 150 ! A les croire, la consommation régulière d'ail pourrait :
être efficace contre les bactéries résistantes aux antibiotiques ;
réduire le risque de maladie cardiaque, dont l'infarctus et l'AVC ;
normaliser la pression sanguine et le taux de cholestérol ;
protéger contre plusieurs formes de cancer, dont le cancer du cerveau, du poumon et de la prostate ;
réduire le risque d'ostéoarthrite.
On pense qu'une grande partie de l'effet thérapeutique de l'ail vient de ses composés soufrés, (2) tels que l'allicine, qui lui donne son odeur caractéristique. Mais l'ail contient aussi des oligosaccharides, des protéines riches en arginine, du sélénium et des flavonoïdes.
En juin 2011, des chercheurs en nutrition de l'Université de Floride ont constaté que manger de l'ail pouvait augmenter le nombre de lymphocytes T dans le sang, d'importantes cellules immunitaires qui jouent un rôle essentiel pour combattre les virus.
Les pharmacologues de l'Université de Californie ont confirmé que l'allicine – l'ingrédient actif de l'ail qui contribue à la mauvaise haleine – avait des effets anti-infectieux.
Une étude australienne portant sur 80 patients, publiée en janvier 2013 dans la revue médicale European Journal of Clinical Nutrition, a rapporté qu'une alimentation riche en ail peut réduire la pression artérielle.
Les recherches ont montré enfin que, lorsque l'allicine est digéré dans votre corps, il produit de l'acide sulfénique, un composé qui réagit avec les radicaux libres dangereux. C'est donc un très bon aliment anti-âge. (la suite ci-dessous)
Préférez l'ail frais
La gousse fraîche doit être écrasée ou coupée finement pour libérer un maximum d'alliinase. Il s'agit d'une enzyme qui catalyse la formation d'allicine. L'allicine, à son tour, formera différents composés organosulfurés. Pour « activer » les propriétés médicinales de l'ail, il faut donc écraser la gousse avant de l'avaler, à moins que vous n'ayez un extracteur de jus, pour en ajouter à votre jus de légumes frais.
Une ou deux gousses d'ail de taille moyenne suffisent habituellement, et sont tolérées par la plupart des gens. L'allicine est détruite au bout d'une heure après avoir été libérée, donc les pilules d'ail ainsi que l'ail séché et en poudre sont beaucoup moins intéressants.
Alors pour renforcer votre système immunitaire à la veille de la saison de la grippe et du rhume, voici une bonne recette à cuisiner :
La recette de la soupe à l'ail contre les virus
Pour quatre personnes :
26 gousses d'ails non épluchées et 26 gousses épluchées
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
deux grosses noix de beurre
une demi-cuillère à café de piment de cayenne en poudre
70 grammes de gingembre frais
thym frais
300 grammes d'oignons
100 mL de lait de coco
1 litre de bouillon de légumes
4 quartiers de citron
Préchauffer le four à 175°. Placer les 26 gousses d'ail non épluchées dans un petit plat en verre. Ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, saupoudrer de fleur de sel et mélanger pour bien enrober. Couvrir le plat de cuisson hermétiquement avec du papier sulfurisé, et faire cuire jusqu'à ce que l'ail soit doré et tendre, environ 45 minutes. Laisser refroidir. Presser l'ail entre les doigts pour libérer les gousses et les mettre dans un petit bol.
Faire fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen-vif. Ajouter les oignons, le thym, le gingembre, le poivre de Cayenne en poudre et laisser cuire jusqu'à ce que les oignons soient translucides, environ 6 minutes. Ajouter l'ail rôti et 26 gousses d'ail cru et cuire 3 minutes. Ajouter le bouillon de légumes, couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que l'ail soit tendre, environ 20 minutes. Mixer la soupe jusqu'à consistance lisse. Remettre la soupe dans la casserole, ajouter le lait de coco et faire mijoter. Assaisonner avec du sel de mer et poivre pour le goût.
Presser le jus de 1 quartier de citron dans chaque bol et servir.
Peut être préparé un jour à l'avance. Couvrir et réfrigérer. Réchauffer à feu moyen, en remuant de temps en temps.
Quand faut-il appeler le médecin ?
Généralement, si vous avez un rhume, aucun médicament n'est nécessaire. Reposez-vous, restez au chaud, dormez, évitez le sucre, buvez du bouillon et un bol de soupe à l'ail, prenez de la vitamine D (5000 UI par jour) pour regonfler votre système immunitaire. Vous guérirez en quelques jours et réduirez de façon significative votre risque de tomber à nouveau malade.
Toutefois, ne confondez pas le rhume et la grippe.
Le rhume se traduit par un mal de gorge, une toux légère avec quelques expectorations (crachats), le nez pris, une certaine mauvaise humeur du malade...
Mais la grippe, la vraie, c'est autre chose ! Vous vous sentez tellement mal que vous ne pouvez même plus imaginer qu'un jour la vie reprendra comme avant. Enfoncé dans votre lit, avec une fièvre de cheval (39-40 °C), une toux sèche et caverneuse, courbatures, fatigue extrême, vous désespérez de l'existence et vous avez malheureusement parfois raison d'être inquiet car la grippe menace la vie des personnes à risque : les personnes âgées, les petits enfants, celles qui ont une maladie chronique ou un système immunitaire affaibli.
Pour un rhume sérieux, vous pouvez vous poser la question de prendre un jour d'arrêt-maladie. Une journée et deux nuits passées à roupiller bien au chaud sous la couette hâteront votre convalescence et vous serez d'autant plus efficace en reprenant le travail. Mais la question est totalement hors-sujet si vous avez la vraie grippe. Seuls vos collègues de bureaux les plus malveillants, ou qui n'ont jamais eu la grippe eux-mêmes, iront imaginer que vous restez alité pour le plaisir. Avec la grippe, vous n'avez pas d'autre choix que de rester couché, et malgré tous les soins, il vous faudra une semaine à quinze jours de convalescence pour retrouver votre état normal.
Alors, quand devez-vous appeler le médecin ?
Les infections des sinus, des oreilles et des poumons, comme la bronchite et la pneumonie, peuvent être d'origine bactérienne, et donc être traitées par des antibiotiques (ou leurs alternatives naturelles bien sûr). Si vous développez un des symptômes suivant pendant votre « rhume », voici les signes d'une possible infection bactérienne, qui doivent vous faire appeler le médecin :
fièvre de plus de 39°C, persistante pendant plusieurs jours ;
douleurs dans les oreilles ;
douleur autour des yeux ;
écoulement nasal vert et jaune ;
respiration difficile ;
toux persistante avec expectorations vertes et jaunes.
************************************************************
Sources :
(1) voir par exemple cette fiche de Medical News Today
(2) Appl Environ Microbiol. 2011 August; 77(15): 5257–5269.
doi: 10.1128/AEM.02845-10

Pendant la nuit, notre rythme cardiaque ralentis, l’oxygène circule plus lentement ainsi les muscles vont se rétracter. Les étirements permettent de réactiver nos muscles qui, pendant la nuit, n’ont pas été sollicités.

Le fait de s’étirer en baillant va permettre au sang de recirculer plus vite. Cela active l’oxygénation du corps, indispensable au bon fonctionnement du muscle.
Réalimenté en « carburant », le muscle est opérationnel et prêt à être sollicité toute la journée.
L’étirement est un réflexe naturel au réveil que l’on néglige le restant de la journée et pourtant…
Ce phénomène se retrouve lorsque l’on passe de longues heures sans bouger, assis ou debout.
En effet, le manque de mouvement, associé à une mauvaise oxygénation vont provoquer un engourdissement des muscles et des raideurs articulaires. Le stress nous crispe et nous fait oublier de respirer.
Nous sommes faits pour bouger si nous voulons préserver le bon fonctionnement de notre corps. Faites des pauses, bougez, étirez-vous, prenez l’air !
http://www.smscoachform.com/pourquoi-a-t-on-besoin-de-setirer-au-reveil/


Yeux fermés, grattouilles sous le menton, et c'est parti, votre chat a enclenché la machine à ronronnements . Et vous restez fascinés par sa capacité à s'abandonner totalement au bonheur. Mais le ronronnement du chat est-il réellement lié à son bien-être ? Et d'ailleurs, comment est émis ce bruit qui fascine les humains ?
Bien que très facilement observés (et entendus), les ronronnements du chat restent encore assez mystérieux, notamment sur leur fonctionnement. Dans tous les cas, il semblerait que la production d'un tel son mobilise l'ensemble de l'appareil vocal des chats et ce, dès le plus jeune âge.
En effet, dès leur naissance, les chatons ronronnent. Mais ce phénomène instinctif n'a pas été observé que chez les chats, il se produit aussi chez de nombreux autres félidés. Comment est produit le ronronnement ?
Chez le chat domestique, le ronronnement résulterait de la vibration du ligament de l'os hyoïde qui relie la clavicule de l'animal à sa gorge. Le bruit créé se fait ainsi entendre à l'inspiration comme à l'expiration. Néanmoins, certaines scientifiques affirment que le ronronnement serait plutôt dû à la contraction rapide des muscles du larynx et du diaphragme du chat. Cela alors engendrerait la vibration des cordes vocales, produisant le bruit caractéristique. Si l'on en croit cette théorie, les chats possèdent un réseau de neurones chargés de provoquer la contraction des muscles du larynx toutes les 30 secondes. Résultat, la glotte des félins se déplace légèrement et bloque le conduit vocal pendant quelques millisecondes. L'augmentation de la pression entraîne alors l'ouverture des cordes vocales, qui laissent passer l'air, provoquant le ronronnement, précise Livescience. Enfin, une autre hypothèse évoque elle la circulation sanguine des matous. Ces derniers posséderaient une veine amenant le sang vers le cœur qui se mettrait à vibrer sous l'action de certains muscles. Les bronches, la trachée et les sinus de l'animal ne feraient alors qu'amplifier cette vibration.
Un ronronnement continu ?
En clair, les chats ne cesseraient jamais de ronronner, ils contrôleraient simplement l'intensité du phénomène. Par conséquent, vous aurez toujours l'impression que votre chat ronronne par intermittence alors, qu'en réalité, il ne ferait qu'augmenter et diminuer la portée sonore de son ronronnement. La plupart du temps, l'augmentation de l'intensité du ronronnement coïnciderait avec l'arrivée d'émotions intenses chez le chat. Toutefois, "le centre du ronronnement n'a toujours pas été identifié dans le cerveau des félidés. Le ronronnement ne se fait entendre que lorsque l'état général de l'animal y est propice", explique Jean-Yves Gauchet, vétérinaire à Toulouse et expert en "ronron thérapie" en France.
Pourquoi le chat ronronne t-il?
Et si les mécanismes de fonctionnement n'ont toujours pas été identifiés, sa fonction pose également de nombreux questionnements. Le ronronnement, une fonction utile pour les félins " c'est très certainement parce-qu'il apporte à l'animal un bénéfice évolutif", rappelle Jean-Yves Gauchet. Principalement associé au bien-être, le ronronnement prend sa source pendant la tétée et permet au chaton de communiquer avec sa mère. Plus tard, le ronronnement est principalement utilisé dans les rapports sociaux avec les autres chats, mais aussi avec l'Homme. Il se déclenche notamment lorsque l'animal est en situation d'infériorité. Il ronronne alors pour indiquer au chat dominant ses intentions pacifiques. Il véhicule ainsi un signal apaisant qui prend la forme d'une sorte de drapeau blanc. En effet, bien que très indépendants, les chats entretiennent des relations sociales particulièrement riches. Selon le chercheur David W. Macdonald, directeur de l'unité de recherche pour la conservation de la vie sauvage à l'Université d'Oxford, les félidés seraient même organisés sous forme de groupes. Plus traditionnellement, le chat ronronne par plaisir, pour faire savoir qu'il est heureux ou bien qu'il a envie de câlins. Les félidés ont également tendance à se frotter aux jambes de leur maître en ronronnant pour réclamer quelque chose. A l'inverse, le ronronnement peut aussi être entendu lors d'une situation stressante ou douloureuse pour l'animal. Il entrainerait ainsi des vibrations, sollicitant les corpuscules de Pacini présents à la surface de leur peau. Ces récepteurs sensoriels déclencheraient ensuite la production d'endorphines. Plongeant le chat dans un état d'apaisement et de bien-être, cela lui permettrait d'évacuer une douleur ou de récupérer d'une maladie. Pas de ronronnement pour les panthérinés Si ce trait caractéristique est partagé par de nombreux carnivores, les grands félins comme le lion ne ronronnent pas.
Plus généralement, les félins de la famille des Pantherinae (lion, léopard, jaguar, panthère…), possèdent bien le ligament de l'os hyoïde. Celui-ci, partiellement ossifié et donc plus souple que celui de leurs cousins, leur permet de rugir mais pas de ronronner. En 1916, le zoologiste britannique Reginald Innes Pocock a ainsi pu établir un classement des félins "non ronronnant" (panthérinés) et des "ronronnants" (félinés). Parmi les félins ronronnants figurent notamment le puma, le lynx, le serval, l'ocelot… De son côté, à la différence du chat, le tigre ne ronronne que lors de l'expiration. Néanmoins, il est très difficile d'établir un classement clair. Car, certains animaux pourraient bien être capables de ronronner, mais beaucoup n'ont tout simplement jamais été entendus ! Néanmoins, d'autres carnivores ronronnants ont pu être repérés. Certains animaux de la famille des viverridés (genette tigrine et genette commune) et des procyonidés (ratons laveurs, coatis…) produisent un bruit similaire, affirme Sciences et Avenir. Enfin, les oursons brun et noir ronronnent également, tout comme les lapins, les écureuils, les tapirs, les lémuriens, les éléphants ou les ratons laveur, la plupart du temps en se nourrissant.
Quand le ronronnement fait du bien aux humains
Si le ronronnement est essentiel au bien-être du chat, il peut aussi faire beaucoup de bien à ceux qui entourent l'animal. C'est ce qu'affirment de nombreux spécialistes dont Jean-Yves Gauchet, expert en "ronron thérapie", expliquant que le ronronnement des chats "apaise" et agit comme "un médicament sans effet secondaire". "Quand l'organisme lutte contre des situations pénibles, comme le stress, le ronronnement du chat émet des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique". Le chat détiendrait ainsi un rôle de puissant anti-stress, encore accentué par la possibilité de lui faire des caresses et de jouer avec. Dans les maisons de retraire, par exemple, les félins seraient de véritables alliés pour tenir compagnie et réconforter les personnes âgées. C'est ainsi qu'est né au Japon, le concept de "bar à chats" qui rencontre un véritable succès et qui vient de venir jusque chez nous. Samedi, a en effet ouvert à Paris le premier "bar à chats" de France. Situé dans le IIIe arrondissement, le salon de thé propose de prendre un café ou un goûter entouré de chats particulièrement sociables et déambulant à leur guise. Un bon moyen pour tous les amoureux des félins de passer un moment en bonne compagnie.
http://www.maxisciences.com/ronronnement/ronronnement-du-chat-comment-et-pourquoi-les-chats-ronronnent-ils_art30849.html
Copyright © Gentside Découvertes

Vous prenez votre courage à deux mains, couteau en main, imperturbable. Vous coupez une tranche ou deux, et l'inévitable arrive soudain. Impossible de vous maîtriser, vous pleurez à chaudes larmes devant votre oignon fraîchement pelé. Quelle est la cause de ce désagréable phénomène ?

L'œil possède un système de protection qui utilise un liquide physiologique salé, leliquide lacrymal. Par les battements de paupière, un léger film de ce liquide est réparti sur la surface de l'œil. Il permet une protection contre le dessèchement etcontre les poussières. Il est ensuite évacué par le canal lacrymal qui descend vers le nez, puis évaporé sous la forme de gouttelettes pendant la respiration. Cependant, si une plus grosse poussière ou une substance urticante (qui gratte) atteint l'œil, ou encore en cas d'une grosse émotion, la sécrétion de liquide lacrymal devient trop importante pour être évacuée par évaporation. Il « déborde » alors au niveau des yeux et du nez ; c'est ce qui crée les larmes et qui fait couler le nez lorsque l'on pleure ! (voir Pourquoi pleurer peut être bon pour la santé ?)
Mais revenons à nos oignons. Lorsque l'on coupe le bulbe de l'oignon, les cellules qui le constituent se déchirent. Une enzyme nommée alliinase est libérée. Au contact de l'air, cette enzyme subit une première réaction chimique, un gaz se forme: le sulfate d'allyle (aussi appelé S-oxyde propanethial). Ce gaz est très volatil et se diffuse donc très rapidement. C'est là que se produit le drame ! Pour évacuer ce produit douloureux, l'œil sécrète une plus grande quantité de liquide lacrymal. Le malheur là dedans, c'est qu'au contact d'eau le sulfate d'allyle se transforme en acide sulfurique, encore plus irritant pour l'oeil ! Ainsi plus l'on pleure, plus l'œil s'irrite et forme des larmes, et plus il y a de larme plus l'irritation s'intensifie... Le cercle vicieux s'arrête lorsque on n'est plus en contact avec le sulfate d'allyle: si l'on quitte la pièce ou que l'on éloigne l'oignon coupé.
Plusieurs techniques sont souvent proposées avec plus ou moins de succès pour éviter de pleurer en coupant les oignons:
- les placer une dizaine de minutes au réfrigérateur avant découpe.
- couper l'oignon sous un fin filet d'eau et limiter ainsi l'évaporation du sulfate d'allyle.
- couper l'oignon sous la hotte de la cuisine ou dans une zone aérée.
Une autre solution serait de porter des lunettes de plongée ou pour les adeptes de chimie de découper leur oignon sous une hotte à flux laminaire...
En résumé...
L'oignon coupé libère une enzyme soufrée nommée alliinase. Celle-ci se transforme au contact de l'air ensulfate d'allyle, un gaz volatil et lacrymogène. Celui-ci vient irriter notre oeil qui produit des larmes pour s'en protéger. Malheureusement, au contact de cette eau, le gaz issu de l'oignon se transforme en acide sulfurique: ça pique, ça brûle et l'on pleure encore plus !
http://axiomcafe.fr/pourquoi-les-oignons-font-ils-pleurer

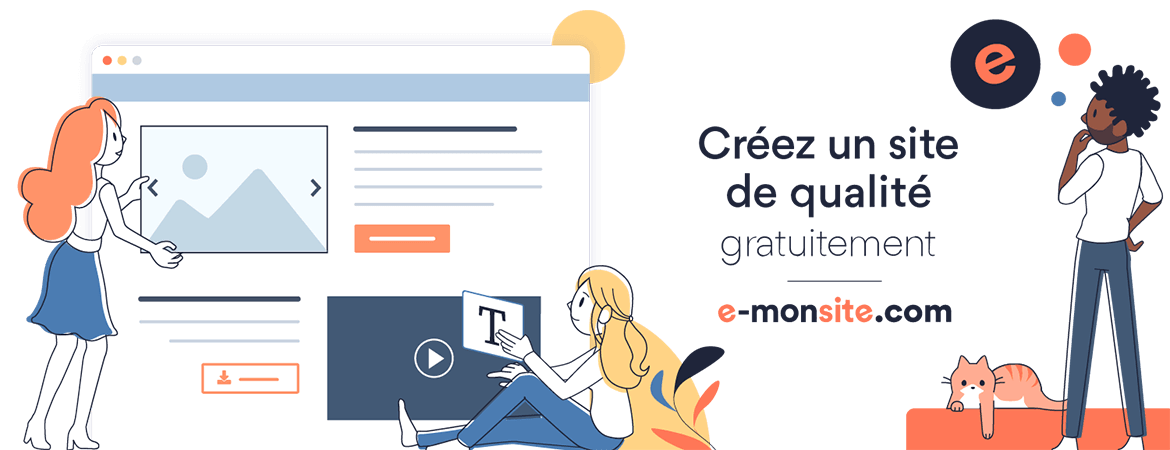


1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité