 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});



"La disparition du racisme, comme c'est le cas chez les Musulmans, est une des réussites les plus marquantes de l'Islam et il y a dans le monde contemporain, une urgente nécessité à propager cette vertu islamique..."
A.J. Toynbee "Civilization on Trial", New York, 1948, p. 205.
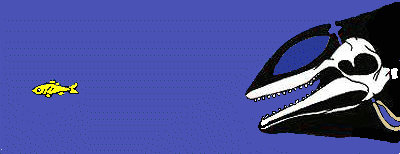
Principe de l'écholocation. © Malene Thyssen, wikipédia, cc by sa 2.5
L'écholocation est un système de repérage utilisé par certains animaux : les chauves-souris, quelques cétacés (orques, dauphins), quelques oiseaux et les musaraignes.
Chez les chauves-souris, ce système remplace une vision très faible ou inexistante, tandis que chez les dauphins, par exemple, il la complète.
Ce système repose sur les propriétés physiques des ondes sonores. L'animal envoie des ondes, via un claquement de langue ou autres. Ces ondes vont heurter tous les obstacles se trouvant dans l'environnement de l'animal émetteur (voir animation ci-dessus) puis revenir à la source (les oreilles, chez les chiroptères), donnant à l'animal une image en trois dimensions de son environnement.
Si l’espèce humaine utilise principalement sa vue pour se diriger, la nature a parfois privilégié d’autres sens. Les moustiques remontent jusqu’à nous grâce au dioxyde de carbone qu’on expire, certains mammifères comme les félins ou les rongeurs utilisent leurs vibrisses (aussi appelées moustaches) pour se repérer dans l’espace, tandis que les cétacés et les chauves-souris sont connus pour leur aptitude à se diriger grâce aux rebonds des ultrasons qu’ils envoient. C’est l’écholocation.
Dès le XVIIIe siècle, des écrits ont fait état de personnes non-voyantes capables de s’aider des bruits de leur environnement pour s’orienter. Des études plus approfondies semblent attester de cette capacité chez les aveugles, qui compenseraient ainsi leur déficit visuel. Mais peu d’études se sont intéressées à cette capacité chez les personnes voyantes.
Jusqu’alors, il a malgré tout été montré que le cerveau est sensible aux échos des sons émis tout autour de nous. Mais naturellement, il supprime le signal, ce qui nous est utile au quotidien, faute de quoi une conversation deviendrait vite incompréhensible quand ses échos viendraient s'y ajouter.

Notre cerveau pourrait réagir comme un radar : par les sons émis puis réfléchis, il serait capable de nous localiser par rapport à d'autres objets, nous rendant ainsi capables d'écholocation. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'écho d'un son externe et que celui-ci n'apporte pas d'information sur la localisation d'un objet, alors il supprime ce double inutile du signal. © Nemo, pixabay.com, DP
Avoir de bons échos
Ainsi, des chercheurs allemands de l’université Louis-et-Maximilien de Munich ont tenté d’étudier ce mécanisme de suppression de l’écho sonore et son lien possible avec la capacité à se repérer dans l’espace. Dans leur recherche, publiée dans Proceedings of the Royal Society B, des participants, tous voyants, ont d’abord a été soumis à un test d’écoute.
Dans un casque muni d’un microphone (détail important pour la deuxième partie de l’expérience), ils entendaient un bruit suivi d’un écho virtuel. Ils devaient déterminer la position du son principal et de ses deux échos.
Lors d’un second test, ces mêmes volontaires devenaient la source émettrice et étaient chargés de produire un son avec leur bouche (langue qui claque par exemple). Un ordinateur produisait alors un écho du bruit généré. Cette fois, il fallait tenter de localiser l’objet sur lequel les ondes sonores rebondissaient.
L’écholocation, un point de repère de secours
En ressortent deux résultats principaux. D’abord, les sujets ont été aussi doués pour déterminer l’origine d’un son émis que pour positionner dans l’espace un objet réflecteur, prouvant que les informations sonores peuvent être interprétées pour aider à se repérer.
Cette aptitude serait possible car le cerveau concevrait différemment les deux situations. Dans la première expérience, les auteurs ont remarqué que la présence du son principal altérait la perception de ses échos, mettant en évidence la mise en place du mécanisme qui supprime les traces des sons auxiliaires. En revanche, dans l’expérience d’écholocation, le son réfléchi par l’objet était interprété à un même niveau que celui qui avait été émis. Ces résultats suggèrent que le cerveau ferait la part des choses et prendrait en compte les informations de localisation contenues dans les échos sonores lorsqu’ils sont la seule source sensorielle.
De prochaines recherches tenteront de déterminer si les aveugles sont plus précis que les voyants dans ce genre d’expérience, pour vérifier par exemple s’ils allouent à l’écholocation des ressources cérébrales normalement allouées à la vision.


Travail en horaires décalés, voyages lointains, troubles saisonniers ou dépression hivernale... Certains syndromes sont liés à la perturbation des rythmes biologiques internes. L'ensemble de nos activités quotidiennes est rythmé non seulement par l'alternance jour/nuit mais aussi par la fréquence et l'heure des repas ainsi que par l'activité sociale. Des chercheurs de l'INRA de Nantes ont mis en évidence l'existence d'une horloge circadienne, c'est-à-dire rythmée sur 24 heures environ, dans la cellule de l'épithélium intestinal de l'Homme.
Des travaux récents avaient montré l'existence d'horloges biologiques pour les cellules du foie, des reins et des poumons, mais il n'y avait pas d'évidence au niveau de l'intestin. Pourtant, on observe une rythmicité pour le renouvellement des cellules intestinales, leur migration et leur différenciation. Les chercheurs de l'INRA ont apporté les premières preuves de l'existence d'une horloge biologique au niveau de l'intestin. Pendant trois ans, ils ont collecté des biopsies d'épithélium intestinal au Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Nantes. Ils ont montré que les cellules intestinales expriment les protéines des gènes dits « gènes horloges » identifiés actuellement.
Alimentation et horloge intestinale
Les chercheurs de l'INRA s'intéressent également aux nutriments capables d'influer sur cette horloge. En modifiant la composition des milieux de culture, ils ont réussi à rétablir une rythmicité dans l'expression des gènes horloges de cellules intestinales cancéreuses, rythmicité qu'elles avaient perdue. Ils montrent ainsi l'importance de certains constituants nutritifs. La connaissance de l'impact des apports en nutriments (aspects quantitatifs, qualitatifs et cinétiques) sur l'horloge biologique intestinale devrait permettre de prévenir les désordres digestifs chez les personnes travaillant en horaires décalés et celles subissant de fréquents décalages horaires, ce qui concerne actuellement près d'un actif sur cinq.
Mise en place d'une horloge intestinale chez le nouveau-né
Les travaux des chercheurs de Nantes sont aussi engagés pour comprendre l'acquisition d'une horloge circadienne intestinale chez le nouveau-né. Assurer une bonne mise en place des rythmes circadiens chez le nourrisson prématuré ou à terme est une préoccupation importante chez les pédiatres car l'organisation d'un sommeil rythmée par l'alternance jour/nuit et la diminution progressive du nombre des biberons sont des indices de bonne santé et un facteur de confort pour les parents.

Plus équilibré que la viande ou le poisson, il est un aliment miracle, facile à cuisiner, même au lave-vaisselle ! Ne vous en privez pas !
L'oeuf, au petit déjeuner, a un effet satiétogène plus important que les produits à base de céréales.
L'oeuf apporte moins de 100 kilocalories pour 60 grammes, dont 75 % d'eau, 13 % de protéines et 10,5 % de lipides (pour la partie comestible). "Son intérêt nutritionnel réside dans le subtil équilibre et la diversité de ses constituants : des protéines parmi les meilleures pour l'homme, des lipides de très bonne qualité, nombre de vitamines et de minéraux", précise le document. Et après une période de désaffection liée à sa teneur en cholestérol (susceptible d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires), l'oeuf a fait un retour en force sous le regard bienveillant des nutritionnistes, des cardiologues et des autres professionnels de santé.
Deux oeufs apportent autant de protéines que 100 g de viande ou de poisson
Les protéines sont indispensables à notre organisme pour le fonctionnement des muscles, l'apport en énergie, la stimulation du système immunitaire, le maintien des cheveux, des ongles ou encore pour le système cardiovasculaire et hormonal, rappellent les chercheurs de l'Inra. Dans l'oeuf, elles sont réparties de manière équitable dans le blanc et le jaune. Ainsi, deux oeufs apportent autant de protéines que 100 g de viande ou de poisson. Ces protéines sont riches en acides aminés essentiels (que notre corps n'est pas capable de synthétiser) dans des proportions équilibrées par rapport à nos besoins.
Il faut néanmoins savoir que, à l'état cru, ces protéines ne sont digérées qu'à moitié, tandis qu'après la cuisson leur digestion est quasi totale et facile. Inversement, si le jaune est trop cuit, les protéines sont moins bien digérées. Plutôt que dur, l'idéal est donc de consommer l'oeuf poché ou mollet. Par ailleurs, la réfrigération et la congélation ne modifient pas la digestibilité des protéines de l'oeuf, ni leur valeur nutritionnelle.
Enfin, pour toutes celles (et ceux) qui désirent perdre du poids, notamment avant l'arrivée des beaux jours, il faut savoir que l'oeuf au petit déjeuner a un effet satiétogène plus important que les produits à base de céréales (pain, croissant, céréales). L'une des expériences du projet Ovonutrial (qui vise à évaluer l'impact de quelques procédés industriels majeurs - pasteurisation, séchage, étuvage de poudres - sur la valeur nutritionnelle et le caractère allergique des protéines d'oeuf) a permis de montrer qu'une omelette, prise en en-cas, apaisait aussi bien la faim que du fromage blanc, mais plus durablement.
Concernant la cuisson, elle se fait classiquement dans une casserole. Au bout de trois minutes, le blanc "coagule", mais le jaune reste liquide. Après 10 minutes : blanc et jaune sont coagulés... Ensuite, le blanc devient caoutchouteux, le jaune sableux, une couleur verte et une odeur désagréable apparaissent (celle du sulfure d'hydrogène). Mais le plus étonnant concerne la cuisson "écologique" : il suffit de mettre un oeuf entier (dans une poche plastique pour l'isoler des détergents) dans le lave-vaisselle avec un programme de lavage classique pour le récupérer correctement cuit en fin de programme. Et sans casserole à laver

Un peu de botanique
À l'origine, l'artichaut était un chardon sauvage qui, sous l'influence de croisements, est devenu la plante vivace, herbacée à tige rigide et cannelée pouvant atteindre 1,50 m de hauteur que nous connaissons aujourd'hui. Ses feuilles en rosette sont très divisées et très grandes. Les fleurs, de couleur bleue violacée, sont groupées en un gros capitule à bractées ovales charnues à la base. Les fruits sont des akènes surmontés d'une aigrette blanche.
Les feuilles en rosette de la première année sont les parties de la plante utilisées en thérapeutique et non les bractées.
Principales propriétés pharmacologiques
Ces feuilles contiennent différents composés chimiques (acides phénols, acides alcools, lactones, flavonoïdes ...) qui expliquent ses propriétés pharmacologiques. D'abord, elles facilitent et régulent l'évacuation de la bile, ce qui est bien démontré chez le rat de laboratoire.
La feuille a également un effet protecteur vis-à-vis du foie et elle inhibe la synthèse de cholestérol dans cet organe, d'où un effet hypolipémiant (réduction du taux de graisse dans le sang).
Usages les plus fréquents
L'emploi de feuilles d'artichaut contribue à améliorer les symptômes gastro-intestinaux. En effet, des études cliniques mettent en évidence une diminution de la dyspepsie (digestion difficile) et des manifestations du syndrome de l'intestin irritable (ballonnements, douleurs abdominales, constipation...) au bout de deux mois de traitement.
Ce légume est le plus riche de France en acide chlorogénique, aux propriétés antioxydantes, d'où son rôle possible dans la prévention du diabète de type 2.
Le mélange artichaut/curcuma/radis noir est particulièrement indiqué à la suite d'excès alimentaires ou pour le "nettoyage" de printemps (saison du foie en médecine chinoise). Cette formule (associant un produit qui régule le flux biliaire, un anti-inflammatoire et un détoxiquant hépatique), protège le foie des patients sous chimiothérapie, pilule, paracétamol, ou atteints de certaines maladies hépatiques.
Le desmodium (protecteur du foie) et le chardon-marie (hépatoprotecteur) sont également efficaces.
En plus de leur action sur le foie, l'artichaut, la bardane (anti-infectieuse cutanée et anti-inflammatoire) et le pissenlit (diurétique) stimulent l'élimination rénale, tandis que la réglisse (anti-inflammatoire) est active sur l'intestin et sur son écosystème, essentiel pour un bon équilibre immunitaire.
Précautions d'emploi
L'artichaut n'est pas toxique. Néanmoins, il n'est pas recommandé si l'échographie révèle la présence de petits calculs dans la vésicule (en raison d'un risque de coliques hépatiques dues à leur migration dans les voies biliaires) et il est à éviter en cas d'allaitement.
Les personnes sensibles à cette plante peuvent voir apparaître des nausées, des diarrhées et des urines abondantes.
À savoir
On trouve sur les marchés des artichauts blancs ou violets, les plus gros pesant jusqu'à 500 grammes pièce, les plus petits moins de 100 grammes.
Ce légume est pauvre en lipide et cholestérol, mais il apporte de bonnes quantités de vitamine B3 et C, de magnésium, de phosphore, de potassium, de cuivre, ainsi que des fibres.


D’après une étude, le bonheur serait bon pour les gènes... à condition d'être heureux pour les autres. © Stuck in Customs, Flickr, cc by nc sa 2.0
Comment peut-on être heureux ? Selon l’auteure française Louise de Vilmorin, le bonheur serait avant tout une disposition de l'esprit. Certaines personnes sont en effet épanouies grâce aux petits plaisirs simples de la vie, alors que d’autres sont éternellement insatisfaites.
Deux voies principales permettraient de développer le bien-être. La première, l’hédonisme, consiste à cultiver les émotions et les attitudes positives afin de se sentir bien dans sa peau. La seconde, l’eudémonisme, est pour sa part plutôt fondée sur la recherche du bonheur chez l’autre, comme c’est le cas pour les personnes qui effectuent du bénévolat ou des missions humanitaires. Dans les deux situations, les individus développent un sentiment de satisfaction qui participe à leur épanouissement personnel.
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». Cette citation de François-Marie Arouet, dit Voltaire, est aujourd’hui appuyée par la science.
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». Cette citation de François-Marie Arouet, dit Voltaire, est aujourd’hui appuyée par la science. © Wikimedia Commons, DP
Le bonheur est une émotion qui va pourtant bien plus loin que le simple aspect psychologique. Au XVIIIe siècle, Voltaire avait affirmé qu’être heureux était bon pour la santé. Plusieurs études ont depuis montré qu’il avait vu juste, et que le bonheur influence différents paramètres physiologiques comme l’activité cardiaque, la durée de la vie et la défense face aux infections. Cependant, les mécanismes impliqués dans cette connexion restent pour le moment obscurs. Une équipe de l’université de Californie à Los Angeles vient éclaircir une part de ce mystère. Leurs résultats, publiés dans la revue Pnas, montrent que le fait et la manière d’être heureux conditionnent l’expression des gènes et le fonctionnement des cellules.
Le bonheur est bénéfique pour l'organisme… à condition d’être généreux
Des travaux précédents ont montré que les sentiments négatifs comme la peur ou le désarroi modifiaient l’expression des gènes dans les cellules immunitaires. Le profil génétique qui en résulte, appelé « profil transcriptionnel face à l’adversité » (conserved transcriptional response to adversity, CTRA), est caractérisé par une augmentation de l’expression des gènes impliqués dans la réponse inflammatoire et une diminution pour ceux jouant un rôle dans la réponse antivirale.
Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont pris un angle différent et ont analysé l’effet d’émotions positives sur le profil CTRA. Pour cela, ils ont recruté 80 adultes, considérés comme heureux eudémoniques « altruistes » ou hédonismes « égoïstes », et ont analysé l’expression génomique de leurs cellules immunitaires. Leurs résultats sont assez surprenants, puisque les narcissiques et les généreux ont des profils CTRA opposés. En effet, contrairement aux émotions négatives, le bonheur charitable induit une baisse de l’expression des gènes de l’inflammation et une hausse de celle des gènes antiviraux. En revanche, les heureux centrés sur eux-mêmes présentent un profil CTRA similaire à celui provoqué par des sentiments noirs.
« Les deux types de personnes sont sur le même plan émotionnel, mais leurs profils d’expression génétique sont différents, explique Steven Cole, le directeur de l’équipe de recherche. Le génome humain serait donc plus sensible à la manière dont nous atteignons le bonheur que notre cerveau lui-même. »

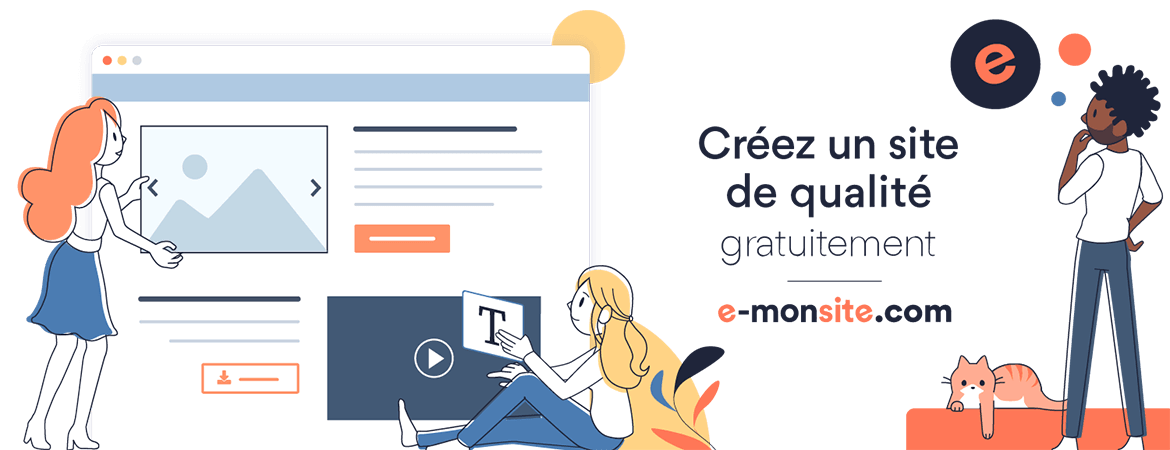




1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité