
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur. Pour un objet qui peut être déplacé, la réception est réalisée lorsque l’objet est déplacé vers un endroit qui n'est pas spécifique au vendeur. Pour quelque chose qui peut être portée à la main, comme un vêtement, il faut que l'acheteur le prenne dans la main pour qu'il y ait réception.
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au HadIth :
« نـهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان »
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-laHmi bil-HayawAn)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».
Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu'un qui vend à 3Amr la créance qu'il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du HadIth :
« نـهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ »
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-kAli’i bil-kAli’)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a interdit la vente d'une créance contre une dette », [rapporté par Al-HAkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu'eux].
Cependant après l'arrivée de l'échéance il est permis de vendre contre un payement immédiat la créance à autre que celui qui la doit, mais avant l'échéance ceci est interdit.
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n'a pas eu d'autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. Par contre, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d'autrui, comme le tuteur d'un orphelin ou quelqu'un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
Il est interdit de vendre une chose sans quelle soit vue par les deux contractants ou par l'un des deux. Ceci est selon l'école de Ach-ChAfi3iyy. La majorité des Imams considère permise cette vente à condition que l’acheteur ait le choix lorsqu'il verra l'objet vendu. Ach-ChAfi3iyy a un avis selon lequel il est valable de procéder à une telle vente lorsque l'objet vendu est décrit de façon qu'il ne soit plus totalement inconnu.
La vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre de son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam AHmad et d'autres savants.
La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus, tel que le fou. De même, n’est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint, comme cela est compris du HadIth du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
« إنّ الله تـجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »
( ‘inna l-LAha tajAwaza lI 3an ‘oummati l-khaTa’a wa n-nisyAna wa ma stoukrihOu 3alayh )
ce qui signifie : « Certes AllAh n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par (…) contrainte » [rapporté par At-TirmIdhiyy].
Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam.
Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« إنّما البيع عن تراضٍ »
(‘innama l-bay3ou 3an tarADin)
ce qui signifie : « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou HibbAn et Ibnou MAjah].
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l'acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n'est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s'est égaré pour celui qui n'est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.
Ainsi il est interdit de vendre :
- La portée des animaux qui est encore dans leurs ventres
- Le lait qui est encore dans la mamelle des animaux
- Le beurre qui est encore dans le lait et le jus de ce raisin qui n'a pas encore été pressé et l'huile de ces olives qui n'ont pas encore été pressées
- Les poissons qui sont encore dans l'eau
- L'oiseau qui est dans le ciel
Il n'est pas permis d'acheter ce qui n'a pas d'utilité valable selon la Loi de l'Islam, comme du pain brûlé, qu'on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur.
Parmi ce qui n'a pas d'utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. Par contre, ce n'est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé Dabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu'on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang. Il n'est pas permis de vendre les fauves qui n'ont pas d'utilité notable selon la Loi, comme le lion, le loup et le tigre, contrairement à ceux qui sont utiles, comme l'hyène car on peut la consommer selon Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, ou le léopard utile pour la chasse et l'éléphant pour le combat.
Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l'école de Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l’agrée, il y a la formule de vente c'est-à-dire la formule de part et d'autre. Certains compagnons de Ach-ChAfi3iyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu'il s'agit d'une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l'acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l'école de MAlik.
Il est interdit de vendre ce qui n'est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n'a pas de propriétaire (mawAt ) c'est-à-dire qui n'a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n'a pas de propriétaire n'entre dans la propriété de la personne qu'en la mettant en valeur pour l’utiliser c'est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l'exploitation, que ce soit pour l'agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
Parmi les conditions de la vente, c'est que le produit contracté et la contrepartie soient déterminés. Il est donc interdit et il n'est pas valable de vendre ce qui est inconnu car ceci fait partie des ventes interdites, comme en disant : (Je te vends l'un de ces deux habits) sans préciser lequel des deux, l'autre repartant avec l'un des deux.
Il est interdit de vendre toute substance impure selon la Loi (najAçah), comme le sang qui, selon l'accord des savants est considéré najis et interdit à la consommation. Cependant, le sang des poissons est considéré pur selon certains savants. Ce qui est visé par najAçah ici, c'est quelque chose dont la substance est najis en soi. D’autre part, le jugement de ce qui est rendu najis et que l'on ne peut pas rendre pur avec de l'eau est le même que ce qui est najis en soi.
Il est interdit de vendre ce qui enivre, c'est-à-dire ce qui altère la raison avec une euphorie et une joie, même si ce qui enivre provient d'autre chose que le jus de raisin, comme si cela provient du miel mélangé à de l'eau, lorsqu'il est arrivé au pétillement après avoir reposé. 3Abdou l-LAh Ibnou 3Oumar, que AllAh les agrée tous les deux, a dit : « Évite toute chose qui pétille » [rapporté par An-NaçA'iyy]. An-nachIch, le pétillement ici, c'est le son que font les petites bulles de la boisson qui est devenue enivrante. Il constitue la limite qui sépare la boisson qui est licite de celle qui est interdite. Ainsi la boisson qui est fabriquée à partir du miel, des dattes, du blé ou de l'orge et ce qui est du même ordre n'est pas interdite avant de parvenir à cet état de pétillement. Cela ne s'appelle khamr qu'après ce pétillement. Ce qui est visé ici par pétillement, ce n'est pas l’ébullition qui se produit lorsqu'on met un liquide sur le feu mais il s'agit de l’émission de bulles qui se manifeste dans un jus qui est resté dans un récipient couvert. La fermentation provoque un son et le niveau s'élève, puis le niveau redescend et on ne trouve plus de bulles. C'est ce que les buveurs d'alcool prennent plaisir à boire. Cette boisson reste interdite jusqu'à devenir vinaigre en changeant vers l'acidité, même si c'est d’une acidité légère, cela devient alors un vinaigre pur et licite.
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme le TounbOur qui est un instrument ressemblant au luth ou à la mandoline, et de même la flûte ou encore le kOubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
Il est interdit de vendre ce qui est licite et pur à celui dont on a eu connaissance qu'il veut commettre un péché avec, comme de vendre du raisin, du raisin sec ou ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va le presser pour obtenir du vin, ainsi que le bois et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va fabriquer des instruments de distractions interdits ou des statues, ou encore de vendre une arme à celui dont on sait qu'il va l'utiliser pour un combat interdit selon la Loi de AllAh ou la drogue et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va l'utiliser dans la désobéissance. À ce titre également, il est interdit de vendre les coqs à quelqu’un qui va les utiliser pour le combat de coqs et les taureaux à quelqu’un dont on sait qu'il va les utiliser pour le combat de taureaux.
Il est interdit de vendre des substances enivrantes.
Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le HadIth qui a été rapporté pour l'interdiction de la vente de l'alcool est celui qu'ont rapporté Al-BoukhAriyy et Mouslim, de la parole de Jabir Ibnou 3Abdi l-LAh Al-'AnSAriyy, que AllAh l'agrée, qui a dit : Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام »
( ‘inna l-LAha wa raçOulahou Harrama bay3a l-khamri wa l-maytati wa laHma l-khinzIri wa l-‘aSnAm )
ce qui signifie : « AllAh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors : « Ô Messager de AllAh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit :
« لا هو حرام »
(lA houwa HarAm)
ce qui signifie : « Non, c'est interdit ». Ce HadIth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit :
« يا صاحب الطعام ما هذا »
(yA SAHiba T-Ta3Ami mA hAdhA)
ce qui signifie : « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit : « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit :
« هلا جعلته ظاهراً حتّى يراه الناس ، من غشّنا فليس منّا »
(hallA ja3altahou dhahiran HattA yarAhou n-nAçou, man ghach-chanA falayça minnA )
ce qui signifie : « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
Information utile : Il n'est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu'il avait, que ce soient des dettes à l'égard des gens ou à l'égard de AllAh comme la zakAt qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c'est-à-dire ce qu'il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d'un pèlerinage et d'une 3oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu'il devait encore les accomplir. Il n'est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l'héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s'il s'agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l'acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu'il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu'il voulait à un prix moins élevé ou s'il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu'il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s'il va voir celui qui l'a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu'ils se sont mis d'accord sur le prix comme lorsque l'acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
Si la démotivation qui a été citée a lieu après l'exécution du contrat et avant que le contrat ne soit définitif, durant la période de choix c'est-à-dire la période de choix de l'assemblée (avant qu'ils ne se séparent) ou la période de choix posée par condition (qui peut être posée soit pour le vendeur soit pour l'acheteur ou bien pour tous les deux, elle peut durer un, deux ou trois jours selon l'accord qui a été fait. Si elle est donnée au vendeur seul, il peut annuler la vente ou l'entériner.), cette démotivation est plus grave que si elle avait eu lieu avant le contrat et après l'accord, car la nuisance ici est plus forte.
Il est interdit d'acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s'appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu'il n'a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s'il s'agissait de quelque chose qu'une personne avait acheté en période normale, ou encore s'il s'agit de quelque chose que quelqu'un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du QADI Houçayn qu'il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n'en a pas besoin soi-même.
Il est interdit de surenchérir pour une marchandise afin de tromper les autres. C'est ce qui est appelé an-najach, la surenchère. Son interdiction a été confirmée dans le SaHIH. C’est ce qui a été confirmé de sa parole Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
« ولا تناجشوا »
(wa lA tanAjachOu)
ce qui signifie : « Ne surenchérissez pas sur une marchandise afin de tromper les autres » [rapporté par al-BoukhAriyy et Mouslim].
Semblable à la surenchère, il y a vanter une marchandise pour inciter les autres à l'acheter avec des paroles mensongères.
Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. AllAh ta3AlA dit :
﴿ وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَلُوا عَلى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلاَ يَظُنُّ أُولـئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾
( wayloun li l-mouTaffifIna l-ladhIna ‘idhA ktAlOU 3ala n-nAçi yastawfOUn wa ‘idhA kAlOUhoum ‘aw wazanOUhoum youkhsirOUn ‘ala yaDHounnou ‘oulA’ika ‘annahoum mab3outhOUna liyawmin 3aDHIm yawma yaqOumou n-nAçou li rabbi l-3AlamIn )
ce qui signifie : « Al-Wayl pour les MouTaffifIn, ceux qui, lorsqu'ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».
Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, et qui sont pour la plupart d’entre elles en-dehors des règles de la Loi de l'Islam.
Tout ce qui va dans le même sens que ce qui a été cité est interdit car cela ne sera pas exempt des choses comportant une interdiction selon la Loi.
Celui qui cherche l'agrément de AllAh soubHAnah ainsi que la sauvegarde dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, qu'il apprenne ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d'un savant scrupuleusement pieux, qui le conseille et qui veille à sa bonne pratique religieuse. La recherche du licite est en effet une obligation qui incombe à tout musulman.
Ainsi, il est un devoir d'apprendre la science de la religion par laquelle on reconnait le licite et l'illicite, en faisant l’apprentissage par transmission orale de la part des gens de la connaissance et dignes de confiance. Il n'est donc pas permis de demander un avis de jurisprudence à quelqu’un qui n'a pas la science suffisante de la religion, ni même de demander un avis à un savant grand pécheur. L'Imam moujtahid qui fait partie des successeurs des compagnons, l'honorable MouHammad Ibnou SIrIn, que AllAh l'agrée, a dit :
إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
(‘inna hAdha l-3ilma dIn fa-nDHourOu 3amman ta’khoudhOuna dInakoum)
ce qui signifie : « Cette science concerne la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous recevez cette science » [rapporté par Mouslim dans l'introduction de son SaHIH]
Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d'assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l'assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu'ils appellent encore « l'assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s'est retrouvé dans un tel contrat d'en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu'en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu'il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu'il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu'il lui avait donnée.
La signification de la parole : « la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman », c’est qu'il n'est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d'une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit à toute personne de rester sans travailler. At-Tirmidhiyy a rapporté, avec une chaine de transmission sûre qu'un homme est venu se plaindre auprès du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam au sujet de son frère parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Le Prophète lui a dit :
« لعلّك تُزرَقُ به »
(la3allaka tourzaqou bihi )
ce qui signifie : « Il se peut que AllAh t'accorde ta subsistance par sa cause [du fait qu'il fait les actes d'adorations] ».
Le point d'argumentation de ce HadIth, c'est que le Messager n'a pas renié au frère de ne pas travailler avec son frère. Quant au HadIth :
« طلب الحلال فريضة بعد الفريضة »
(Talaba l-HalAli faridatoun ba3da l-faridah)
ce qui signifie : « Rechercher le licite est une obligation après l'obligation », il est rapporté par Al-Bayhaqiyy et d'autres avec une chaîne de transmission faible.
http://www.islam-religion.info/index.php?page=les-ventes-interdites

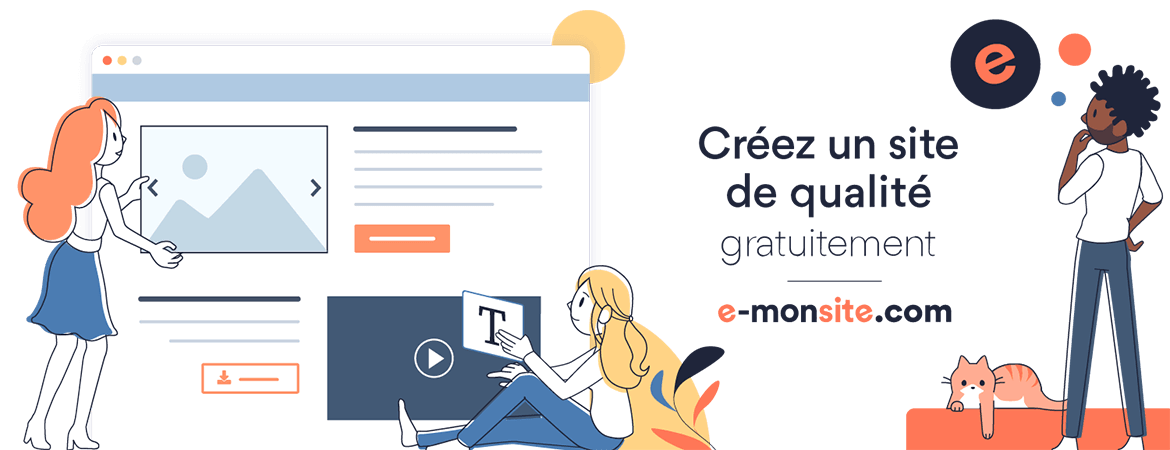









































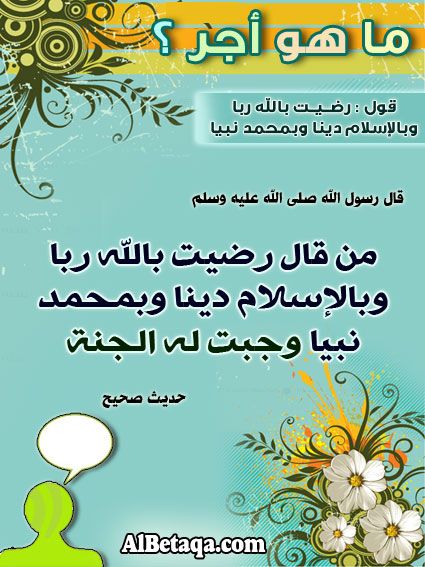

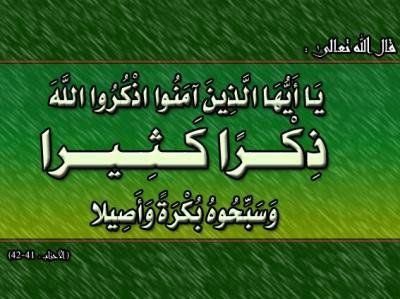

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité