couple est possible même à long terme, il suffit de se poser les bonnes questions avant l’événement, de voir les horizons de chacun, a savoir s’ils sont de même direction et d’y mettre patience, compassion et beaucoup d’amour
9 ERREURS DE NOUVEAUX MARIES
Les cinq à sept premières années sont les plus exigeantes pour tout mariage. C’est une période que les conjoints passent à faire connaissance et à s’habituer à la personnalité de l’autre. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des problèmes que les couples affrontent dans leurs jeunes années, ainsi que leurs solutions.
1. Manque d’informations valables avant le mariage. Quantité de problèmes sont causés simplement par le fait que les conjoints et leurs familles n’ont pas abordé les questions cruciales. Par exemple : Est ce que l’épouse travaillera hors du foyer ? Est ce que le couple attendra avant d’avoir des enfants ? Quelle ville et pays le couple habitera après le mariage ? Vivront-ils chez les parents du mari ou bien dans leur propre appartement ?
Ces points et d’autres encore doivent être discutés et tranchés dès le début du processus du mariage.
2. Direction floue. Un des problèmes majeurs reste la guerre interne pour le contrôle du foyer. Cela a conduit à bien des impasses, se soldant par les polémiques et les sentiments amers. Combien de couples refusent de nos jours la modération et le compromis, et ce, pour n’importe quel différend. Même si d’un point de vue islamique, le mari se charge du rôle de dirigeant de famille, il n’est pas pour autant un dictateur. Soulignons ici que le dirigeant en islam est celui qui sert, gère,entretient et soutient. Et le dirigeant doit aussi garder humilité et modestie.Un mari exerce donc une direction éclairée en écoutant et consultant (Choura) son épouse. Tout ceci doit se baser sur l’attachement aux règles du Coran et de la Sounna. Ainsi, les divergences d’opinions seront renvoyées à ces règles, au lieu de devenir une source de tension et de problèmes.
3. Divorce Instantané. Il fut un temps où le mot ‘divorce’ était sciemment évité dans toutes conversations. Aujourd’hui, les couples musulmans d’Occident l’utilisent comme une des premières solutions aux conflits matrimoniaux. Rappelons que de tout ce que Dieu nous a rendu licite (Halal), le divorce est celle qu’Il déteste le plus. Avant d’en arriver à l’option radicale, le couple doit explorer d’autres pistes. Il devrait en particulier recourir à l’aide d’aînés sages et expérimentés, qui essaieront de dénouer les choses, avant que le divorce n’arrive.
4. Sexe : ici et maintenant. Il est irréaliste de croire que la question sexuelle disparaîtra dès la fin de la cérémonie du mariage. Dans une société occidentale saturée de références sexuelles, les couples tendent à exiger plus de leur partenaire dans ce domaine. Ils croient aussi obtenir des résultats instantanés. En réalité, cela demande du temps, de l’engagement, de l’expérience et de l’investissement pour établir une relation intime qui corresponde à chaque partenaire. Il est important pour chaque musulman et musulmane d’aborder la sexualité du mariage en connaissant l’étiquette de l’Islam. Les conjoints doivent savoir ce qui est illicite (Haram). Ainsi, il est interdit aux époux d’aborder publiquement leur relations intimes avec d’autres, sauf dans le cas d’une question ou d’une aide de la part d’une autorité. Dans le même registre, les conjoints devraient essayer d’être physiquement attirants. Trop de couples prennent le mariage en prétexte pour se laisser aller. Ils prennent du poids, ne s’émeuvent plus de leur hygiène, de leur apparence générale.
5. Vous avez dit Belle-famille ? Les premières années de mariage ne sont pas seulement une période d’accommodation à l’intérieur du couple. Elles permettent aussi au conjoint de connaître la belle famille, et vice versa. Maris, épouses et beaux parents doivent appliquer les règles de l’islam en matières de relations sociales. C’est-à-dire : éviter les sarcasmes, la médisance, les mauvais surnoms, et surtout agir dans le respect mutuel de chaque membre de la famille. En particulier, les comparaisons sont à proscrire, car chaque individu et chaque couple est unique. Ne pas comparer les épouses aux soeurs ou à sa mère, et inversement, ne pas comparer son mari au père ou aux frères. Enfin, ne pas comparer sa belle famille à sa propre famille.
6. Rêver… puis se réveiller. Un garçon et une fille. Ils tombent amoureux. Ils vivent heureux pour toujours. C’est le scénario de base de moult films hollywoodiens, où tout-le-monde-il-est-beau. La réalité est toute autre. Beaucoup entament leur mariage en planant sur leur nuage romantique, dans l’attente d’un conjoint idéal. Mais tous les humains ont du bien et du mauvais. Epoux et épouses doivent accepter l’autre, et se corriger ensemble.
7. Perdre ma liberté. Les jeunes hommes de l’occident peuvent trouver dans le mariage une imposante restriction. Après tout, ils pouvaient, quand ils étaient célibataires, bavarder avec leurs amis jusqu’à tard dans la nuit, sans que personne n’y trouve à redire. Une fois mariés, les voici à la maison dès 19 heures, voire plus tôt encore. Alors que le mariage demande un emploi du temps plus serré et certaines responsabilités, les avantages sont réels (i.e vie partagée, enfants, etc.),même si cela prend du temps à s’en rendre compte.
8. Garder un secret : mission impossible. Bon nombre de jeunes couples mariés sont connus pour ne pas garder leurs secrets pour eux, surtout les secrets d’ordre sexuels, dont ils font la publicité. Ceci est non seulement répréhensible, c’est illicite (haram). Les époux doivent absolument couvrir leurs défauts. S’ils ont un problème intime, qu’ils prennent un ‘conseiller matrimonial’ en la personne d’un ancien, d’un sage, loyal, qui œuvrera pour l’intérêt des deux parties en toute bonne foi.
9. Confondre aimer et phagocyter. Quantité de couples pensent que les mariés doivent rester collés l’un à l’autre.
D’une part, certaines épouses peuvent prendre l’initiative de toutes les tâches ménagères, sans même laisser au mari le soin de ses propres affaires (comme le repassage de ses habits). Celles-ci regretteront autant de charges et de corvées avec le temps, et s’apercevront que leurs maris sont devenus dépendants d’elles pour les moindres choses. D’un autre côté, les maris peuvent penser qu’ils doivent rester tout le temps avec leur épouse. Cette erreur les rendront au fur et à mesure irritable et hypersensible. La solution est de faire attention aux douces attentions, aux gestes de bonté et à l’espace vital indispensable. Ce faisant, la relation s’équilibre aussi physiquement que sentimentalement.
Source : Adapté de ‘The First Two Years a Mariage survivalGuide’, de soundvision.com








































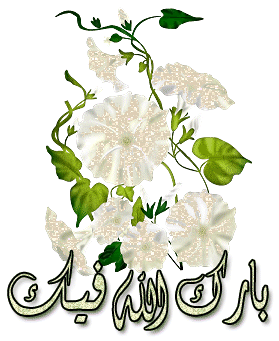




1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité