 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});




Les banques délivrent à leurs clients des cartes dites Visa. Grâce à ces cartes, les clients peuvent retirer des sommes à la banque, même si leurs comptes n’étaient pas suffisamment approvisionnés au moment du retrait. Mais le client doit rembourser la banque au bout d’une période déterminée. A défaut d’un règlement dans les délais requis, la banque peut exiger un surplus qui dépasse le montant retiré par le client. Pourtant celui-ci verse à la banque une somme annuelle en échange de l’usage de ladite carte…
Cette opération est interdite puisque le client s’engage à payer des intérêts au cas où il ne réglerait pas ses créances dans les délais requis. Ce qui est un engagement invalide, même si le client croit fortement qu’il pourra régler avant l’expiration du délai, puisqu’il peut arriver une situation qui le rende incapable de le faire. Il s’agit d’une affaire qui concerne le futur et personne ne sait ce qui va lui arriver dans le futur. Conclure une opération de cette manière est interdit. Allah le sait mieux.
http://islamqa.info/fr/11179


Passer d'une religion à une autre peut se faire pour diverses raisons. Ca peut être une raison scientifique c'est à dire que la personne n'est pas convaincue des croyances de la religion qu'il a à cause de considérations scientifiques logiques. La raison du changement peut avoir comme motif, de façon inconsciente, la matière, quelque que soit sa forme, que ce soit des relations d'amitié sentimentale, des relations conjugales ou même un motif directement matériel comme la fonction, l'argent ou la distinction (célébrité). Ces motifs d'ordre matériel se retrouvent en grand nombre dans les sociétés multiconfessionnelles.
C'est pour cela qu'afin de sauver une personne sur le point de se christianiser, il faut nécessairement examiner ce qui l'incite à changer de religion, que ce soit des causes directes ou indirectes, ces dernières étant les plus importantes à causes de leur caractère caché, parce qu'elles se dissimulent sous d'autres apparences qui la rendent difficiles à déceler et donc à mettre en lumière. Si la cause est d'ordre scientifique, la position à adopter à son encontre est d'expliquer, de clarifier, de dévoiler et d'éclaircir, [actions] menées par quelqu'un de compétent qu'il soit savant ou intéressé par ce genre de sujets, étudier parallèlement la nouvelle religion, celle à laquelle la personne en question veut se convertir, puis démontrer son incohérence, sa contradiction en usant d'une méthode scientifique convaincante.
Si les motifs sont d'ordre matériel, il faut essayer de le pourvoir en choses matérielles tout en usant de moyens de persuasion afin que la religion soit sauve. [A cela il faut ajouter le fait de prendre] le soin de rechercher les origines de l'idée de changer de religion, que l'idée soit venue par la voie des médias comme les programmes [radiophoniques ou télévisés], les revues (magazines), les livres ou par la voie sociale comme les aumônes et les relations sociales, que ce soit par l'intermédiaire de l'école, de l'université ou du lieu de travail, puis tenter de faire cesser cela par des moyens sains qui ne mènent pas à la répulsion et la rupture [des relations] et sans négliger l'aspect de la compagnie et de l'amitié qui a un grand effet dans un domaine comme celui-ci. Je conseille , surtout à ceux qui sont en France, pays qui diffère du point de vue culturel et social des pays musulmans et où l'on considère que la religion fait partie de la liberté individuelle, de tirer profit des centres islamiques en France pour l'orienter concernant un tel sujet car il se peut qu'il y ait des situations similaires, en plus du fait que les frères en France connaissent peut-être l'état social là-bas plus que d'autres et il se peut aussi qu'ils disposent de moyens qui s'adaptent mieux à la réalité sociale et organisationnelle dont d'autres ne disposent pas, en vertu de quoi leur avis est prépondérant sans que cela ne signifie nullement l'absence d'apport utile de la part des autres dans ce domaine. [A quoi il faut ajouter] l'insistance dans l'invocation d'Allah [du`â'] pour qu'il perpétue sa bonne direction [hidâya], qu'il raffermisse les curs dans la religion de vérité comme était [le Prophète] sur lui la Paix et la Bénédiction qui répétait abondamment la parole: "ô Toi qui change les curs, raffermis mon cur dans ta religion" Allah est plus savant.
http://fr.islamtoday.net/node/1586

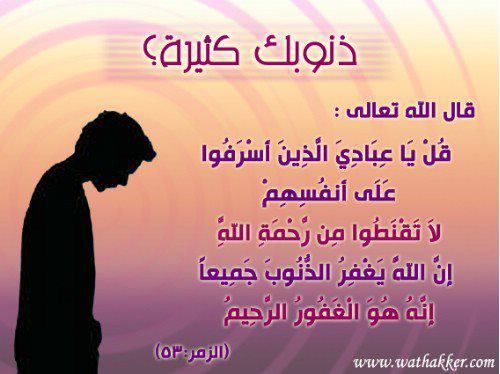
Dans le Coran, Dieu — Exalté soit-Il — dit : « Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allâh vous en demandera compte. » [1] D’un autre coté, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Allâh a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées, tant que ces pensées ne sont pas mises à exécution ni commises. » Ce récit est rapporté par Al-Bukhârî etMuslim. Ce verset est il abrogé ? Finalement, dans quelles circonstances avons-nous à rendre des comptes pour nos pensées ?
Si nous prêtons attention à la réaction des compagnons du Prophète — que Dieu les agrée — quand le verset en question fut révélé, nous réaliserons à quel point Dieu — Exalté soit-Il — est Miséricordieux envers Ses serviteurs.
Selon l’Imâm Ahmad, Abû Hurayrah — que Dieu l’agrée — rapporta que lorsque le verset fut révélé, les Compagnons du Prophète — paix et bénédictions sur lui — furent extrêmement tristes et craignirent d’avoir à rendre compte à Dieu — Exalté soit-Il — de tout ce qui leur traverserait l’esprit. Ils allèrent voir le Prophète — paix et bénédictions sur lui —, s’agenouillèrent et lui dirent : « Ô Messager de Dieu ! Dieu — Exalté soit-Il — nous a jusqu’à présent prescrit des choses dont nous étions capables, comme la prière, le jeûne, et l’aumône. Mais concernant ce verset, nous craignons de ne pas être capables d’appliquer l’enseignement qu’il exprime. » Le prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « Voulez-vous marcher sur les pas des Gens du Livre qui vous ont précédé, quand ils dirent (à leurs prophètes) : “Nous avons entendu mais nous n’en ferons rien.” ? Vous devriez dire plutôt : “Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous, Seigneur, car c’est vers Toi que sera le retour !” »
Sur ce, les Compagnons se soumirent humblement à l’ordre de Dieu transmis dans ce verset. Puis, Dieu — Exalté soit-Il — révéla le verset : « Le Messager croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Allâh, à Ses anges, à Ses Écritures et à Ses Messagers, (en disant :) “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers” et ils dirent : “Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c’est vers toi que tout doit faire retour !” » [2]
Puis, Dieu — Exalté soit-Il — abrogea le verset en question en révélant : « Allâh n’impose point à nulle âme que ce dont elle est capable. Tout bien qu’elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu’elle aura commis jouera contre elle. « Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions ni de nos erreurs ! Seigneur ! Épargne-nous les terribles épreuves que Tu as fait subir à nos prédécesseurs ! Seigneur ! Ne nous impose pas d’obligations qui soient au-dessus de nos forces ! Accorde-nous Ton pardon, fais-nous remise de nos péchés et fais-nous miséricorde ! Tu es notre Seigneur ! Accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles ! » [3]
Selon les deux Sommes Authentiques d’Al-Bukhârî et Muslim, Abû Hurayrah — que Dieu l’agrée — rapporta :
Le Messager de Dieu — paix et bénédictions sur lui — dit, « Allâh — Exalté soit-Il — dit (dans un hadith transcendant) : “Chaque fois que Mon serviteur a l’intention de faire une mauvaise action alors, vous les Anges, n’inscrivez rien à moins qu’il mette son intention à exécution ; s’il l’exécute, alors inscrivez lui une mauvaise action. Mais, s’il a l’intention de faire une bonne action et qu’il ne l’a met pas à exécution, alors inscrivez lui une bonne action (dans son registre), et s’il l’exécute, alors inscrivez lui dix bonnes actions.” »
Muslim rapporta également, d’après Abû Hurayrah, que le Messager de Dieu — paix et bénédictions sur lui — dit : « Allah — Exalté soit-Il — dit (dans un hadith transcendant), « Chaque fois que Mon serviteur a l’intention d’accomplir une bonne action mais ne met pas sa pensée à exécution, elle lui est inscrite comme une bonne action, mais s’il la met à exécution, elle lui est inscrite entre dix et soixante dix bonnes actions. Lorsqu’il a l’intention de commettre une mauvaise action mais ne l’a finalement pas exécutée, rien n’est inscrit dans son registre. Mais s’il la commet, on lui inscrit une mauvaise action. »
De nombreux hadiths furent rapportés à ce sujet. Ceci indique que Dieu — Exalté soit-Il — révéla le verset en question en guise d’épreuve pour tester la confiance et la soumission des Compagnons du Prophète — que Dieu les agrée —, et ils ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur de la confiance de Dieu — Exalté soit-Il —. En conséquence, Le Tout-Puissant, de par Sa Miséricorde et Sa Clémence, dissipa leurs inquiétudes et décréta qu’ils n’auront pas à rendre compte de leurs pensées intimes.
Ainsi il n’y a pas de contradiction entre le verset et le hadith en question. Car le verset a été abrogé par le verset qui le suit et dont le contenu est en adéquation avec le sens du hadith.
Réponse de Sheikh Ahmad Kutty
De plus, Sheikh Ahmad Kutty, un maître de conférence et un savant musulman à l’institut islamique de Toronto, Ontario, Canada, développe davantage la notion de la responsabilité de l’individu vis-à-vis de ses pensées disant :
« Nos pensées peuvent être divisées en différentes catégories :
Le dialogue interne incessant et les pensées futiles qui accablent nos esprits et sur lesquelles nous n’avons aucune emprise,
les pensées que nous nourrissons,
les intentions que nous formulons à partir de ces pensées.
Nous ne sommes pas responsables pour la première catégorie, c’est-à-dire les pensées spontanées, car nous n’avons aucune emprise sur elles, à moins que nous ressassions ces pensées et les entretenions dans nos têtes. Nous sommes responsables si nous les ressassons. De même, nous sommes responsables des intentions découlant de nos pensées et que nous formulons délibérément. »
Réponse de Sheikh 'Atiyyah Saqr
Par ailleurs, Sheikh 'Atiyyah Saqr, l’ancien président de la Comission de Fatwâ d’Al-Azhar dit :
« Dieu — Exalté soit-Il — ne demande pas de compte à une personne pour ses pensées sauf dans deux cas :
Premièrement, si une personne est déterminée fermement à mettre en pratique ses pensées. Ceci est clairement explicité dans le hadith du Prophète : « Si deux musulmans croisent leurs épées l’un contre l’autre, alors tous les deux, à savoir le tueur et le tué, iront en enfer. » Je (le narrateur) dis : « Ô Messager d’Allâh, Cela se comprend pour le tueur, mais pourquoi est-ce le cas pour celui qui est tué ? » Il dit : « Celui qui est tué avait le désir de tuer son adversaire. » [4]
Deuxièmement, lorsque l’individu met ses pensées à exécution. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « Allâh a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées, tant que ces pensées ne sont pas mises à exécution ni commises. » [5]
L’individu est tenu responsable de son intention de commettre une mauvaise action si ce qui l’en empêche c’est son incapacité à l’exécuter ou la crainte des autorités. Mais si ce qui l’en empêche c’est la piété et la crainte de Dieu, alors Dieu ne lui en demandera pas de compte. Au contraire, il gagnera une rétribution pour avoir lutté contre ses mauvais penchants. Ceci dissipe tout semblant de contradiction entre les textes. »
Et Dieu est le plus savant.
P.-S.
Traduit de l’anglais du site islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 284.
[2] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 285.
[3] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 286.
[4] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
[5] Hadîth rapporté dans les six recueils authentiques de Hadiths, et expliqué par l’Imâm Ibn Kathîr.
http://www.islamophile.org/spip/Sommes-nous-tenus-responsables-de.html

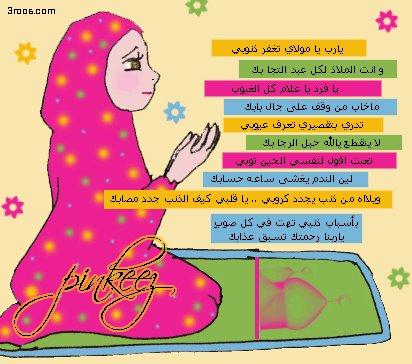
Concernant le droit donné à la femme de demander le khul' comme solution égale à ce que l’homme peut faire par le biais du talâq, je me réfère à la preuve suivante. Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq, dit : "Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsqu’il n’aime pas sa femme, la législation islamique (sharî'ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme."
Au contraire, il se peut même que le mari soit contraint au paiement d’un arriéré de dot lorsque la femme a de bonnes raisons d’avoir recours au khul', par exemple, dans le cas d’abus corporel ou psychologique ou de tout abus ou négligence dans l’accomplissement des obligations que le mari a envers sa femme. Il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit de son mari. Elle dit qu’elle n’avait aucun grief en particulier contre lui mais qu’elle ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre ce qu’elle avait reçu comme dot. C’était un verger. Elle répondit qu’elle le lui rendrait. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khul'.
La majorité des écoles juridiques approuvent le khul'. Cependant, l’école hanafite précise que le juge doit approuver les raisons avancées par la femme. Certaines écoles disent que si les deux époux sont d’accord pour effectuer ce khul', ils n’ont besoin d’aucun juge ni d’aucun tribunal pour le valider. Bien sûr, le khul' est un contrat alors que le talâq n’en est pas un.
Si la femme veut avoir recours au khul' et qu’après environ un mois elle insiste toujours sur cette demande, alors je ne vois aucune justification raisonnable pour que le mari le lui refuse. Son refus serait alors assimilé à un abus et à du harcèlement. Le mariage a pour but d’aider les époux à pratiquer l’Islam, particulièrement dans leur vie matrimoniale. Si l’un des deux époux est dans l’incapacité de pratiquer une bonne vie matrimoniale, alors le Coran dit dans le verset 229 de la sourate 2 : « Si vous craignez qu’ils ne soient pas capables d’observer les limites de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation. »
Pour certaines écoles, ce khul' équivaut au talâq et la femme doit donc observer une période de viduité ('iddah). Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, dans son Zâd Al-Ma'âd a affirmé, à propos du khul', que la période de viduité n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation pour être sûre de ne pas être enceinte.
P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
http://www.islamophile.org/spip/Le-droit-de-divorce-pour-la-femme.html

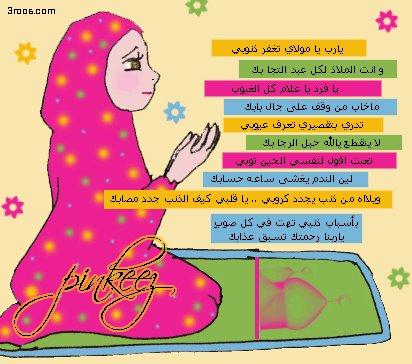
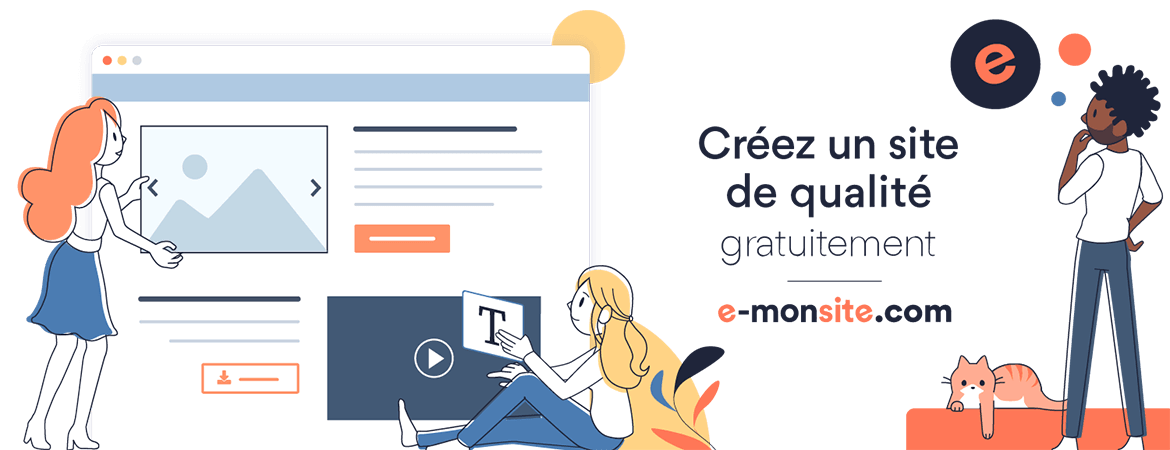

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité