 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});




S'occuper d'un enfant, ce n'est pas seulement lui prodiguer une éducation religieuse et spirituelle. Toute mère ressent cette force en elle, cet instinct maternel qui l'unit à son enfant, ce même amour donné par Allah entre elle et son épouse.
Ainsi, Allah, Exalté soit-Il, dit dans le Saint Coran (sens du verset): « Et parmi Ses signes (d'Allah), Il a créé de vous, pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Coran : 30/21)
Aimer, c'est un cadeau d'Allah, alors, pourquoi s'en priver si c'est un grand bien et qu'il sera largement récompensé le Jour de Résurrection ? N'est-ce pas même un devoir envers Allah Exalté soit-Il ?
Notons ainsi ces Hadiths de notre bien-aimé Prophète ():
Aïcha (Radhia Allahou Anha) a dit: « Des bédouins vinrent trouver le Prophète () et demandèrent: « Embrassez-vous vos enfants? » - « Oui » répondit le Prophète (). – Ils dirent : « Mais nous n'embrassons pas les nôtres. » - Alors; reprit le Prophète () : « Et que pourrais-je faire si Allah a enlevée la miséricorde de vos cœurs ? » (Sahih Muslim)
«Celui qui n’est pas bienveillant envers nos enfants, qui ne respecte pas nos personnes âgées vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres ». (Boukhari et Muslim)
De même, laisser pleurer un enfant, bien que ce soit conseillé par certains soit disant médecins pour que l'enfant soit plus « indépendant » (Je serais tenter de dire « plutôt désespéré ! »), l'Islam semble clair à ce sujet ! En effet, même dans la prière, le parent peut prendre son enfant et le consoler afin de ne pas le laisser seul :
Abou Qatada (Radhia Allahou Anhou) a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah () faire la prière tout en portant sa petite fille Oumama, fille que Zaïneb a eu de son époux Abou Al As Ibn Ar-Rabiâ. Quand il se prosternait, il déposait l'enfant à terre et il la reprenait en se relevant. (Hadith rapporté par Muslim)
L'enfant est très important en Islam, et ses parents par sa bonne éducation participent à la formation de l’Oumma de demain !
Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut a dit (sens du verset) : « Que la crainte saisisse ceux qui laissent après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. » (Coran : 4/9)
Le Messager d’Allah () a dit : « Chaque personne acquiert un certain nombre de péchés quand elle néglige ceux dont elle doit subvenir à leurs besoins. » (Hadith rapporté par Abou Dawoud)
Dans une autre version de ce hadith rapportée par An-Nassa’i: « Il suffit comme péché de négliger celui dont on a la charge ».
Omar Ibn Al-Khattab, Radhia Allahou Anhou, a dit: «J’ai entendu le Messager d’Allah () dire: « Vous êtes tous des bergers (garants), et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. Le chef de l’Etat est berger (responsable) de ses administrés. L’homme est berger (garant) de sa famille et responsable de l’objet de sa garde. La femme est garante dans (sa maison) et responsable de l’objet de sa garde. Le serviteur est un berger pour les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. Ainsi, vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.» (Hadith rapport par Boukhari, At-Tirmidhi et Abou Dawoud)
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=171735&fromPart=49

|
|
Noms communs : Pain de saint Jean-Baptiste, figuier d'Égypte, fève de Pythagore.
Noms botaniques : Ceratonia siliqua
Nom anglais : Carob
Partie utilisée : Le fruit, la pulpe du fruit et les graines présentes à l’intérieur du fruit.
Habitat et origine : Le caroubier est originaire des pays méditerranéens (Espagne, Italie, Maroc). Il est aussi cultivé dans d’autres régions chaudes comme la Floride ou la Californie. Le caroubier résiste très mal aux températures froides.
Posologie
Aucune étude toxicologique n’a été entreprise pour déterminer les doses maximales à utiliser. Il faut donc se fier aux doses traditionnellement utilisées, soit 20 à 30 g de caroube sous forme de poudre dissouts dans un liquide chaude comme de l’eau, du thé ou du lait, une fois par jour.
Chez les enfants (moins de 18 ans)
Son utilisation n’est pas recommandée car les doses efficaces et inoffensives de caroube n’ont pas encore été scientifiquement déterminées.
Le caroubier est un arbre de la famille des légumineuses, mesurant généralement cinq mètres de hauteur. Sa longévité peut atteindre 500 ans.
Les feuilles sont de couleur verte, alors que les fleurs, très petites et rougeâtres, sont réunies en grappes et apparaissent à la fin de l’été.
Ces grappes donnent naissance à de longues et épaisses gousses. Vertes lorsqu’elles sont immatures, ces gousses deviennent brunes et aplaties lorsqu’elles arrivent à maturité vers le mois de juillet. On retrouve dans les gousses les graines de caroube, de couleur brune et de forme ovoïde aplatie. On compte quinze à vingt graines par gousse.
Comestible, la pulpe jaune contenue dans les gousses a un goût chocolaté et peut être utilisée comme substitut du cacao, avec un apport calorique moindre. Elle est constituée de 40 % de sucres, de 35 % d'amidon, de 7 % de protéines, et, dans une moindre mesure, de tannins et sels minéraux comme le calcium et le magnésium. Les propriétés épaississantes de la pulpe sont liées à la présence d'un sucre appelé le galactomannane (= un polymère, c’est-a-dire un assemblage de sucres parfois utilisé pour remplacer l’amidon) .
Les graines de caroube grillées sont utilisées en substitution du café en confiserie après le broyage des graines, ou transformées en sirop.
Le caroubier est un arbre apprécié depuis des milliers d’années par les habitants des pays méditerranéens pour sa chair farineuse et sucrée. Il serait originaire de Syrie et a été cultivé par les Égyptiens qui utilisaient la farine de caroube pour rigidifier les bandelettes de leurs momies. Il fut également utilisé par les berbères du Maroc pour ses vertus médicinales : grâce à sa teneur élevée en fibres, son fruit (la caroube) était dissout dans un liquide chaud pour stopper les diarrhées.
La haute teneur en fibres de la caroube suggère qu'elle pourrait réduire le taux de cholestérolsanguin. En 2010, des chercheurs ont étudié les effets d'une consommation de fibres de caroube riches en polyphénols sur 88 individus souffrant d'hypercholestérolémie. Les résultats de cette étude indiquent que cette consommation diminue au bout d'un mois les niveaux de cholestérol total (-18%), de LDL cholestérol « mauvais cholestérol » (-26%) et triglycérides (-16%)1.
Ces résultats concordent avec ceux publiés en 2003 qui montraient qu'une préparation de pulpe de caroubier de 15 g par jour et riche en polyphénols diminuait au bout de 6 semaines le profil lipidique à raison de -10% de LDL cholestérol et de -11% de triglycérides, chez des individus présentant une hypercholestérolémie. Cet effet bénéfique, comparé à un placebo, était plus marqué chez les femmes2. Une autre équipe avait précédemment montré qu'un extrait de pulpe de caroubier riche en polyphénols augmentait l'oxydation des acides gras, reflétée notamment par une augmentation de la dépense énergétique et les taux de triglycérides mesurés après un repas3.
![]() Traitement de la diarrhée
Traitement de la diarrhée
Traditionnellement, la caroube est utilisée pour le traitement des affections gastro-intestinales, en particulier les diarrhées. Une étude a montré que différents types de produits à base de caroube comme le jus de caroube associé à une solution de réhydratation orale, réduit la durée des diarrhées chez 80 enfants âgés de 4 mois à 4 ans, comparés à une solution de réhydratation seule4.
La fraction insoluble de caroube provenant de la pulpe à raison de 2 g toutes les deux heures pendant 48 heures n’apporterait aucun effet bénéfique chez les voyageurs victimes de diarrhée5. Dans une autre étude réalisée chez des enfants âgés de 3 à 21 mois, un extrait de farine de caroube à raison d’1,5 g/kg/jour contenant 40% de tannins et 26% de fibres réduirait, au bout de 6 jours de traitement, la période des diarrhées. Cette préparation diminue également les vomissements et aide à retrouver le poids d’origine plus rapidement que chez ceux traités avec le placebo. La préparation était bien tolérée par les participants6.
Traitement du reflux gastro-œsophagien
La gomme de caroube est un épaississant alimentaire qui pourrait se révéler utile dans le traitement du reflux gastro-œsophagien infantile, selon une étude publiée en 2007. Au cours de cette étude, des chercheurs ont examiné l’effet d’un concentré de gomme de caroube (HL-350) sur 20 enfants de moins de 2 mois souffrant de reflux. Le nombre de régurgitations diminuait chez le groupe ayant reçu la préparation, comparé au groupe contrôle7. Cet effet bénéfique confirme les résultats précédents obtenus sur 50 enfants ayant bu une préparation contenant du Gaviscon® (un médicament anti-reflux) et de la farine de caroube8.
La gomme de caroube est à utiliser avec prudence :
La caroube est à éviter :
|
Recherche et rédaction : Stéphane Bastianetto, Ph.D., fondateur de www.neuromedia.ca |
RéférencesNote : les liens hypertextes menant vers d'autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. Bibliographie 1 Ruiz-Roso B, Quintela JC, de la Fuente E, Haya J, Pérez-Olleros L.Insoluble carob fiber rich in polyphenols lowers total and LDL cholesterol in hypercholesterolemic sujects. Plant Foods Hum Nutr. 2010 Mar;65(1):50-6. doi: 10.1007/s11130-009-0153-9. 2 Zunft HJ, Lüder W, Harde A, Haber B, Graubaum HJ, Koebnick C, Grünwald J.Carob pulp preparation rich in insoluble fibre lowers total and LDL cholesterol in hypercholesterolemic patients. Eur J Nutr. 2003 Oct;42(5):235-42. 3 Gruendel S, Garcia AL, Otto B, Mueller C, Steiniger J, Weickert MO, Speth M, Katz N, Koebnick C.Carob pulp preparation rich in insoluble dietary fiber and polyphenols enhances lipid oxidation and lowers postprandial acylated ghrelin in humans.1. J Nutr. 2006 Jun;136(6):1533-8. 4 Hostettler M, Steffen R, Tschopp A.Efficacy and tolerance of insoluble carob fraction in the treatment of travellers' diarrhoea.1. J Diarrhoeal Dis Res. 1995 Sep;13(3):155-8. 5 Loeb H, Vandenplas Y, Würsch P, Guesry P.Tannin-rich carob pod for the treatment of acute-onset diarrhea.1. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1989 May;8(4):480-5. http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=caroube
|
L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.
L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »
D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.
source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..

SANTÉ :
¯¯¯¯¯¯¯
1. Bois beaucoup d’eau .
2. Prends un déjeuner de roi , un dîner de prince et un souper de mendiant .
3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres et plantes et mange moins de nourriture manufacturée ( Industrialisée ) .
4. Vis avec les 3 E : Énergie , Enthousiasme et Empathie .
5. Trouve un peu de temps pour méditer .
6. Joue plus souvent .
7. Lis plus de livres que tu en as lus l'année dernière .
8. Assis-toi , en silence , au moins 10 minutes par jour .
9. Dors durant 7 heures au moins .
10. Prends des marches quotidiennes de 10 à 30 minutes et en marchant , souris.
PERSONNALITÉ :
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
11. Ne compare pas ta vie à celle des autres . Tu n’as aucune idée à quoi ressemble leur vie .
12. Évite les pensées négatives ou les choses dont tu ne peux contrôler . Investis plutôt ton énergie dans le moment présent .
13. N’en fais pas trop . Connais tes limites .
14. Ne te prends pas trop au sérieux , personne d’autre ne te prend au sérieux .
15. Ne perds pas ta précieuse énergie en commérage .
17. L’envie est une perte de temps . Tu as déjà tout ce dont tu as besoin .
18. Oubliez les problèmes du passé . Ne remémorez pas aux autres les erreurs passées . Ça ruine votre bonheur présent .
19. La vie est trop courte pour la gaspiller à détester .
20. Fais la paix avec ton passé afin qu’il ne ruine pas le présent .
21. Personne n’est responsable de ton bonheur sauf toi .
22. Prends conscience que la vie est une école et que tu y es là pour apprendre . Les problèmes font simplement partie de ton curriculum qui apparaît et disparaît comme la classe d’algèbre , mais les leçons que tu apprendras seront pour la vie .
23. Souris et ris le plus souvent possible .
24. Tu n’as pas à gagner chaque dispute . Accepte d’être en désaccord .
SOCIÉTÉ :
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
25. Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie-leur des courriels .
26. Chaque jour , donne quelque chose de bien à quelqu’un .
27. Pardonne autant que possible .
28. Passe du temps avec des gens plus âgés que 75 ans et plus jeunes que 6 ans .
29. Essaie de faire sourire au moins trois personnes quotidiennement .
30. Ce que les gens pensent de toi ce n’est pas de tes affaires .
31. Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu seras malade . Tes amis oui ! Garde le contact .
VIE :
¯¯¯¯
32. Agis bien !
33. Débarrasse-toi de tout ce qui n’est pas utile , garde ce qui est beau ou joyeux .
34. La nature guérit tout .
35. Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise , elle va changer …
36. Peu importe comment tu te sens , lève-toi , habille-toi et présente-toi .
37. Le meilleur est encore à venir .
38. Quand tu te réveilles le matin , remercie d’être en vie .
39. Ton for intérieur est toujours heureux . Donc , sois heureux .

Démangeaisons de la peau : mais pourquoi ça gratte ?
Les démangeaisons de la peau, médicalement dénommées « prurit », sont fréquentes et les causes très diverses. Petite revue des principales causes et quelques conseils pour obtenir un soulagement, voire la disparition de ces démangeaisons cutanées.
Démangeaisons ou prurit : des causes extrêmement diverses
Ce qui provoque les démangeaisons (prurit) est lié à des substances irritantes fabriquées par la peau et libérées dans les couches superficielles.
Cette réaction de la peau se fait en réponse à des situations très diverses, allant de la piqûre d'un insecte, en passant par des maladies comme l'eczéma ou le psoriasis.
Parmi les causes les plus fréquentes :
Les piqûres de végétaux comme les orties.
Les piqûres d'insectes et d'autres animaux : moustiques, poux, méduses...
Les allergies : urticaire, eczéma...
Des maladies de la peau comme le psoriasis.
Une peau excessivement sèche.
Des infections de la peau provoquées par des champignons comme les mycoses, par des virus comme la varicelle, par des parasites comme la gale...
Certaines maladies entraînent également des démangeaisons comme les troubles rénaux, les maladies du foie, etc.
Ce qu'il ne faut pas faire en cas de démangeaisons : se gratter !
Lorsque la peau démange, le premier réflexe est de se gratter. Or si gratter apporte un soulagement, ce n'est que pour une durée extrêmement limitée, tandis que les conséquences peuvent être sérieuses, avec notamment un risque d'aggravation du prurit, un risque d'infection, particulièrement en présence d'éruptions cutanées (vésicules) et de cicatrices définitives.
En effet, plus on gratte, plus on accentue la réaction de la peau, plus on risque de mettre la peau à nue et de l'exposer à des microbes. Mieux vaut donc s'abstenir et trouver une autre solution pour soulager le prurit. Dans tous les cas, il est préférable de masser avec la paume de la main en appliquant quelques pressions. Et par mesure de précaution, coupez vos ongles courts !
Démangeaisons cutanées : ce qu'il faut faire pour traiter et soulager
Consulter pour trouver la cause et la traiter. En cas d'allergie par exemple, l'élimination de l'allergène en cause fera disparaître le prurit. Ou encore, en cas de mycose, un traitement antifongique s'impose.
Hydrater sa peau : crème, lotion et autre pommade sont indispensables pour éviter une peau sèche, facteur favorisant les démangeaisons. Parallèlement, il faut éviter tout ce qui peut contribuer à assécher la peau : les bains, les douches prolongées notamment.
Éviter aussi tout ce qui agresse la peau : les savons très détergents, les produits parfumés...
Le médecin ou le pharmacien peut proposer des traitements pour calmer les démangeaisons, notamment des antiprurigineux locaux (antidouleurs et antiseptiques) et des antihistaminiques H1 par voie orale ou à appliquer localement (gel, pommade).
Encore une fois, ne grattez pas et n'hésitez pas à consulter.
Isabelle Eustache
http://www.lamutuellegenerale.fr/le-mag-sante/sante-au-quotidien/demangeaisons-de-la-peau-mais-pourquoi-a-gratte.html

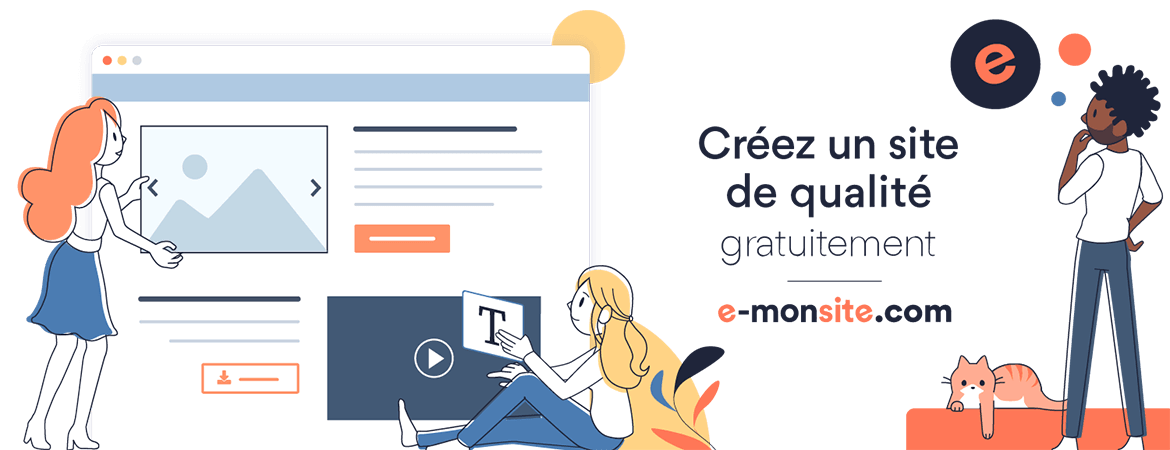


1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité