L'Islam et la vie sociale
"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Le statut de la célébration du nouvel an de l’Hégire
- Le 09/08/2021
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale

Certes, le fait de célébrer le nouvel an de l’hégire en en faisant un jour férié, d’organiser des fêtes et des festivals et d’envoyer des messages [de vœux], fait partie des innovations et des choses inventées que notre religion interdit. En effet, ce genre de festivités n’a jamais eu lieu à l’époque des meilleures générations de l’Islam et si cela contenait un quelconque bien, [les musulmans de l’époque] nous auraient précédé en cela.
Les plus célèbres à avoir instauré cette tradition innovée sont sans doute les gouverneurs de l’état des ‘Oubaydiyya en Egypte. D’ailleurs, Al-Maqrîzî dans ses Khoutat, a cité le nouvel an parmi les jours que les ‘Oubaydiyôun ont établi comme étant jours de fêtes et des occasions. De même que les califes fatimides accordaient une attention particulière à la veille du premier Mouharram de chaque année car cela représentait la première nuit de l’année et son commencement.
Aussi, il ne fait aucun doute qu’il n’y pas d’innovation qui se propage chez les musulmans sans qu’une sounna ne disparaisse en parallèle. Ainsi, tout le bien réside dans le suivi [des salafs] et tout le mal se trouve dans l’innovation.
Le Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa sallam - a dit : « Prenez garde aux choses nouvelles, toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement», rapporté par Abou Dawôud.
Il dit aussi : « Quiconque innove dans notre affaire (la religion) une chose qui n'en fait pas partie, celle-ci sera alors rejetée ».
En plus d’être une innovation, la célébration du nouvel an de l’hégire constitue une imitation des juifs et des chrétiens dans leur tradition de fêter le nouvel an chrétien. Or, il nous a été interdit par les textes du Livre et la Sounna, de suivre les passions des gens du Livre et de les imiter.
Allah dit : « Puis Nous t’avons mis sur la voie de l’Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc et ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. »
A ce propos, voir les explications d’Ibn Taymiyya concernant ce verset dans son précieux livre : Iqtidâ² As-Sirât Al Moustaqîm Moukhâlafat Ashâb Al Djahîm(Emprunter la voie de la droiture et contredire les habitants de la Géhenne).
Le Hadîth par ailleurs dit : « Celui qui imite un peuple, fait partie d’eux » et aussi : « Ne fait pas partie des nôtres celui qui imite autrui ».
Et il ne fait aucun doute que ceci constitue une menace terrible car le Prophète – salla Allahou ‘alayhi wa sallam - ne se désavoue pas [de la sorte] de celui qui commet [simplement] une chose détestable. Plutôt, il se désavoue du mécréant ou de celui qui a commis un interdit grave faisant partie des grands péchés dans le but de le menacer. Ainsi, l’imitation des mécréants dans leur koufr est une mécréance et les imiter dans ce qui est interdit est également interdit. Lorsqu’il s’agit de les imiter dans leurs traditions invalides, cela est également illicite comme l’a démontré Cheykh Al Islam, preuves à l’appui, dans son livre précité plus haut. Participer à leurs fêtes ou les suivre et les imiter en cela l’est aussi.
Il faut savoir que la célébration du nouvel an fait partie des fêtes citées par les juifs dans leur Thora falsifiée, ils appellent cela : Roch Hachana, le premier mois du nouvel an juif. Par la suite, les chrétiens suivirent et imitèrent cette tradition en célébrant le nouvel an chrétien. Plus tard, les ignorants parmi les musulmans en firent de même et transposèrent cette célébration au début de l’année hégirienne. Malgré cela, beaucoup d’autres parmi eux prirent également part à la célébration du nouvel an chrétien.
Evidemment, toutes ces choses sont des innovations et des choses blâmables auxquelles le musulman raisonnable s’abstient de participer. Il doit aussi réprouver ces agissements avec sagesse ; en prêchant la bonne parole aux gens et en enseignant aux ignorants parmi eux que les musulmans n’ont que deux fêtes : ‘Îd Al Fitr et ‘Îd Al Adhâ et qu’excepté cela, il n’est permis de célébrer aucune autre fête, qu’elle soit à connotation religieuse, nationaliste ou autre.
Et ce, en vertu du Hadîth rapporté par Anas - qu’Allah l’agrée - qui dit : « Quand le Prophète – salla Allahou ‘alayhi wa sallam - arriva à Médine, il trouva que les gens avaient l'habitude de s'amuser pendant deux jours qu'ils avaient choisis dans l'année. Il leur dit alors: " Allah vous a remplacé ces deux jours de fête par deux autres meilleurs : ce sont le jour d'Al Adha et celui d'Al Fitr " ».
Enfin, nous rappelons que les musulmans n’ont pas besoin de célébrer des fêtes et des festivals où ils imitent les mécréants afin de se rappeler la Hidjra(l’émigration) d’Al Moustafâ, salla Allahou ‘alayhi wa sallam.
Bien entendu, ils ne devraient jamais perdre de vue le véritable sens de la Hidjra, cet acte grandiose qui fut une étape déterminante et indispensable à l’établissement de l’Etat islamique. Cette émigration constitua une limite entre le Vrai et le Faux et entre les adeptes du monothéisme (tawhîd) et les adeptes de l’associationnisme (chirk).
Ainsi l’alliance et le désaveu font partie des principes les plus solides de la foi, le musulman doit réaliser ce principe et le vivre au quotidien en se séparant du chirket de ses adeptes et en s’alignant sur le tawhîd, en le secourant et en secourant ses adeptes.
Cette Hidjra doit leur rappeler la parole du Tawhid qu’ils prononcent et répètent jours et nuits en étant debout ou assis, lors de l’adhân, la salât, et durant toute leur vie. Ils devraient aspirer à réaliser toute la transcendance et la singularité que cette parole renferme, en veillant à épurer leur adoration de toute formes deChirk et à infirmer la Seigneurie à tout autre qu’Allah, ainsi qu’à exclure de leur alliance les non croyants et les adeptes de tout autre religion que l’islam, et à vouer une adoration exclusive à Allah dans le jugement et la législation.
Nous implorons Allah afin qu’Il gratifie les musulmans d’un beau retour vers leur religion.
Prières et salutations sur notre Prophète ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons.
Réponse du cheykh Abou Mohammed Al-Maqdissî
http://www.musulmans-du-monde.fr/article-le-statut-de-la-celebration-du-nouvel-an-de-l-hegire-64847921.html

Aid Al Adha:les conditions d’aptitude de la bête à sacrifier
- Le 15/07/2021
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale

Le sacrifice doit remplir six conditions :
La première est qu’il doit être une bête de cheptel comme le chameau, le bœuf, le mouton en vertu de la parole du Très Haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu' ils prononcent le nom d' Allah sur la bête de cheptel qu' Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s' humilient,» (Coran, 22 :34 ). La définition de l’expression « Bahimatoul an’am’ » donnée plus haut est celle connue chez les arabes, comme l’ont dit Hasan, Qatada et d’autres..
La deuxième, est qu’il doit atteindre l’âge légal qui est de 6 mois pour le mouton et 1 an pour les autres animaux. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « N’égorgez qu’une bête âgée d’un an ou plus. A défaut, vous pouvez égorger un mouton d’un âge inférieur » (rapporté par Mouslim).
Le terme moussinna indique une bête âgée d’un an ou plus.
Le terme djadhaa indique une bête d’un âge inférieur à un an.
Le chameau dit thany est celui âgé de cinq ans.
Le bovin dit thany est celui âgé d’un an.
Le terme djadh’a désigne une bête âgée de 6 mois.
On ne peut pas prendre pour sacrifice un chameau ou un bœuf ou un mouton qui ne soient pas thany. On ne peut non plus prendre un ovin qui ne soit pas djadha.
La troisième est que l’animal doit être exempt des quatre défauts invalidant, à savoir :
1/ L’absence d’un œil, son apparition hors de son orbite ou tellement blanc qu’on en déduit que l’animal est borgne .
2/ La maladie manifeste : celle dont les symptômes apparaissent sur l’animal comme la fièvre qui le détourne des pâturages et lui coupe l’appétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
17- La généralité du bel-agir par NiNoMoU
3/ Le défaut du pied qui empêche l’animal de marcher normalement avec les animaux sains.
4/ L’affection affaiblissante qui atteint le cerveau. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a fait un geste de la main en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour le sacrifice : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite clairement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable » (rapporté par Malick dans al-Muwatta à partir d’un hadith d’al-Baraa ibn Azib). Une autre version citée dans les Sunan et toujours attribuée à al-Baraa (P.A.a) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit devant nous : « Quatre (animaux) ne peuvent pas être retenus pour servir de sacrifice… » Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit plus haut. (déclaré authentique par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, (11148).
Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir servir de sacrifice. En plus, d’autres défauts aussi graves voire plus graves leur sont assimilés. En voici quelques uns :
1/ L’animal frappé de cécité .
2/ L’animal souffrant d’un excès d’alimentation, à moins qu’il ne soit mis à l’abri du danger (de mort) .
3/ Celui confronté à un accouchement difficile, à moins qu’il ne soit pas mis hors de danger .
4/ La victime d’un étouffement ou d’une chute, à moins de s’en être complètement remis.
5/ Celui qui a du mal à marcher à cause d’un handicap ;
6/ Celui qui a une main ou un pied coupé.
Si l’on ajoute cette série aux quatre premiers défauts, on se retrouve avec dix.
La quatrième condition est que l’animal doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement, l’auteur du sacrifice doit avoir l’autorisation du propriétaire ou une permission légale. Car est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, par un voleur ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur d’un faux procès, etc. En effet, il est inexact de se rapprocher d’Allah par un acte qui implique un péché.
Il est valable de la part du tuteur d’un orphelin de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et si l’orphelin éprouverait un regret sans un tel geste.
Un mandataire peut faire le sacrifice à la place de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition est que la bête à sacrifier ne doit pas être l’objet d’un gage.
La sixième condition est le respect du temps légalement établi pour l’immolation du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de la fête célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour du 12e mois. Les jours pendant lesquels on peut procéder à l’immolation sont au nombre de quatre : le jour de la fête et les trois jours suivants. Si quelqu’un procède à l’immolation du Sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice sera invalide. Ceci est fondé sur ce hadith rapporté par al-Boukhari d’après al-Baraa ibn Azib (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le sacrifice immolé avant la prière, est de la viande que l’on offre à sa famille et n’a aucune valeur rituelle ».
Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufyan al-Badjali (P.A.a) a dit : « J’étais présent quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque immole son sacrifice avant d’accomplir la prière, doit le remplacer par un autre sacrifice ».
D’après Noubaycha al-Houdhali (P.A.a), le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les jours de tashriq sont des jours pendant lesquels il faut manger, boire et se rappeler Allah, le Puissant et Majestueux » (rapporté par Mouslim).
Si, pour une excuse valable, l’on ne pouvait pas immoler le sacrifice au cours des jours de tashriq, si, par exemple, l’animal s’était échappé sans aucune négligence humaine et si on ne le retrouvait qu’après l’écoulement du temps (normal), il n’y aurait aucun mal à égorger l’animal. Il en serait de même si celui auquel un mandant a été donné pour égorger l’animal, oubliait de le faire pendant le temps normal. Cette excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou s’endort à l’heure fixée pour une prière. Car celui-là est autorisé à prier dès qu’il se souvient ou se réveille.
On peut procéder à l’immolation le jour comme la nuit, même si le jour reste préférable.
Le jour de la fête est préférable à condition qu’on attende la fin des deux discours (de l’imam). Le lendemain est préférable au surlendemain puisqu’il s’agit de s’empresser à faire du bien.
Ici prend fin l’extrait tiré de Ahkam al-Udhliyya wa adh-dhakat de Cheikh Muhammad ibn Outhaymine

Les fatawas inconscientes
- Le 11/07/2021
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale
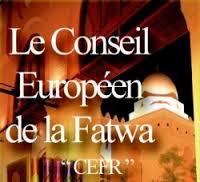
Chacun d'entre nous sait reconnaître une fatwa officielle. Elle émane d'un savant contesté par les uns, vénéré par d'autres. Mais qu'en est-il des fatawas officieuses qui circulent sans gêne au sein de la communauté ? Beaucoup croient en effet que le terme fatwa ne s'applique qu'au verdict rendu par un jurisconsulte, un mufti reconnu. Or, il importe de rappeler qu'à partir du moment où une personne se prononce sur une question de jurisprudence, plusieurs cas de figure se présentent à elle :
elle rejoint une fatwa déjà existante en la reformulant de manière fidèle et complète,
elle rejoint une fatwa déjà existante, mais oublie d'en préciser les subtilités énumérées en amont par un jurisconsulte, et ainsi, contribue à la diffusion d'une fatwa tronquée,
elle produit une fatwa à son insu, sans pour autant chercher à savoir si cela a déjà été validé par des gens de science et ajoute au patrimoine jurisprudentiel, une nouvelle posture,
elle en produit une parce qu'elle estime que dans les avis qui lui sont parvenus, la vérité n'a pas été dite et qu'elle est en train de la dévoiler,
elle préfère finalement se taire sur la question,
Pourquoi donc un non-savant peut-il techniquement produire une fatwa ? Le fait est que les discussions et débats animés entre musulmans touchent très souvent la question du halal et du haram, ce qu'on appelle communément "la jurisprudence" (al fiqh). Aussi, il arrive qu'effectivement, devant la soif de réponses, nous soyons tentés de contribuer à la discussion en reliant nos souvenirs ou nos réflexions, à nos interlocuteurs avides d'explications. Ainsi, à la question "telle chose est-elle permise ?", les "on-a-dit-que" et autre "apparamment" vont combler les tiroirs des interrogations, dans la mesure où le silence met mal à l'aise et qu'il vaut mieux se suffire d'une réponse vide de sens, que de subir la lourdeur d'une vacuité envahissante. Loin de vouloir condamner cette pratique en totalité, il faut dire que tant que ce fameux "on-a-dit-que" est suivi d'une riche argumentation, pleine de vérité(s), il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Seulement, encore faut-il préciser qui se cache derrière le "on", car effectivement, les approximations relèvent très souvent de l'automatisme dans nos discussions sur l'Islam.
Les fatawas inconscientes restent en réalité, passionnelles, plus que scientifiques. Sans oublier que les sources contemporaines se résument souvent à des rumeurs et des références grossièrement traduites sur le net et les réseaux sociaux, en passant parfois par de graves mensonges, sans oublier que beaucoup s'attachent tels des sangsues aux premières fatawas qu'ils ont découverts et que dorénavant, rien au monde ne peut les faire changer d'avis, à l'exception de ceux à qui Allah a fait Miséricorde.
Comprenons chers frères et chères soeurs, qu'il ne suffit pas de jouir d'une réputation de savant, d'avoir en face de soi un auditoire et une série de questions, pour entamer une séances de fatawas. La fatwa est techniquement et de manière générale, ce qui sort de notre bouche ou est écrit par nos mains, et qui se prononce sur la valeur juridique d'une oeuvre apparente ou cachée, le tout mesuré en principe, sur la balance de notre religion. Combien de fois avons-nous, à notre insu, pratiqué ces fatawas inconscientes, sans même être sûrs de leur justesse ? Combien de personnes ensuite, ont diffusé ces introductions pour en faire de véritables postures scientiques ? Ce faisant, nous avons alors donné à nos frères, la graine qui a fait poussé une fleur, dont le parfum se distingue potentiellement, de celui de la vérité...
C'est la raison pour laquelle Abdu'llah ibn Omar (qu'Allah agrée le père et le fils) disait :
العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنّة محكمة ولا أدري
La science se résume en trois choses : un livre parfait (le Coran), une Sunna dénuée d'ambiguïtés, et (dire) "je ne sais pas"
Le bouche à oreille est l'une des conséquences, et parfois même l'une des causes, de la propagation des fatawas inconscientes. Et là où certains jurisconsultes ont mis des semaines, voire des mois à rédiger une fatwa riche en détails et en preuves, d'autres préfèrent ponctuer en quelques secondes leurs argumentations d'un "il y a des savants qui disent que", "il y a un verset dont je ne me souviens plus qui dit que", "Ceci est halal, j'ai vu une vidéo sur Youtube", etc. Ce genre d'exemples porte la marque de la fatwa inconsciente, qui par nature est approximative et est sujette à l'erreur, puisque très souvent, les écarts de rigueur, de mémoire, de fidélité aux témoignages consultés, diffèrent d'un individu à un autre. Quoiqu'il en soit, ce procédé est scientiquement risqué pour nos interlocuteurs, et parmi eux, des personnes qui seraient prêtes à avaler n'importe quel posture, pourvu qu'elle soit à priori, tirée des sources de l'Islam.
Et ceci fait partie des prophéties annoncées par le Messager d'Allah (prière et salut sur lui) :
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا
"Allah ne retirera pas la science en l’arrachant aux serviteurs, mais Il la retirera en faisant disparaître les savants. Et lorsqu’il ne restera aucun savant, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront interrogés et donneront des fatawas sans science, et ainsi s’égareront et égareront les gens" Authentique par Al bukhari et Mouslim.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
"Dis : "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas" Sourate Al A'raf, verset 33
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
"Et ne te prononce pas sur ce dont tu n'as aucune science. Certes, l'ouïe, la vue et le coeur, sur tout ceci on sera interrogé" Sourate Al Isra, verset 36
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
"Et qui est donc plus injuste que celui qui forge le mensonge sur Allah, en égarant les gens sans aucune science. Certes Allah ne guide point les gens injustes" Sourate Al An'am, verset 144
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ
"Et ne dites pas conformément aux mensonges que vos langues ont proférés "Ceci est halal (permis), ceci est haram (interdit), en forgeant le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah, ne réussiront point" Sourate An-nahl, verset 116
http://www.sous-missions.com/rappels/les-fatawas-inconscientes/
Qui sont les personnes bénies ?
- Le 11/07/2021
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale
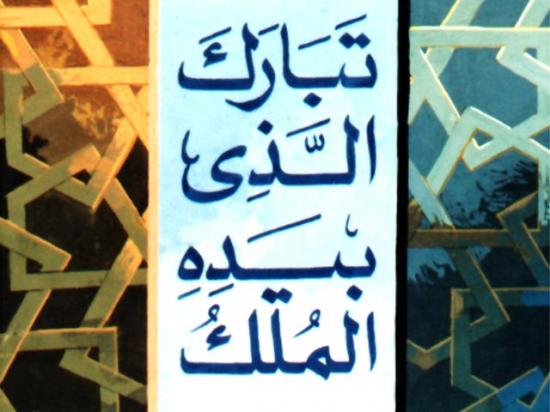
Bénédiction se dit en arabe : "بَرَكة" : "Baraka", ou : "يُمْن" : "Yumn".
A l'origine "al-Baraka" signifie l'établissement, la permanence (الثبوت و اللزوم و الاستقرار) (Jalâ' ul-afh'âm, p. 165) (voir aussi Muf'radât ur-Râghib). A partir de là, "la bénédiction (al-baraka), écrit Ibn ul-Qayyim, c'est abondance du bien et sa permanence (البَرَكة كثرة الخير و دوامه)" (Badâ'i' ul-fawâ'ïd, p. 311).
1) Le fait qu'une chose soit bénie signifie donc deux choses :
– que dans cette chose il y a du bien en quantité abondante (kathîr) ;
– et que dans cette chose ce bien est établi (thâbit) et permanent (lâzim).
An-Nawawî a de même décrit ces deux aspects de la bénédiction : "A l'origine la bénédiction signifie : l'établissement du bien, et son abondance" (Shar'h Muslim sur n° 286). Fakhr ud-dîn ar-Râzî a écrit la même chose en commentaire du verset 7/54 : "La bénédiction a été commentée de deux façons : l'un est la permanence (al-baqâ' wa-th-thabât) ; l'autre est l'abondance d'effets de bien et de résultats nobles" (Tafsîr ur-Râzî, commentaire de Coran 7/54).
Al-Qurtubî a pour sa part exposé le premier aspect : "Et la bénédiction est l'abondance du bien (Wa-l-baraka : kathrat ul-khayr)" (Tafsîr ul-Qurtubîtome 4 p. 139). Ar-Râghib al-Asfahânî a quant à lui exposé le second aspect :"Et la bénédiction est l'établissement [= la permanence], dans une chose donnée, du bien conféré par Dieu (Wa-l-baraka : thubût ul-khayr il-ilâhî fi-sh-shay')" (Mufradat ur-Râghib, B-R-K).
Quant au fait que "Yumn" et "Baraka" sont deux synonymes, c'est ce que Ibn ul-Athîr a écrit : "Mention du "يُمْن" (yumn) a été répétée dans les hadîths. Il s'agit de la "baraka". Son contraire est : "شُؤْم" (shu'm)" (An-Nihâya fî gharîb il-hadîth wa-l-athar, Y-M-N, tome 2 p. 933 dans l'édition que je possède).
2) La bénédiction (Baraka) que Dieu accorde aux créatures est de deux types principaux : d'ordre temporel (dunyawî) ; et d'ordre religieux (dînî / ukhrawî) :
A) Une action "dunyawî" est une action dont l'avantage est uniquement ou essentiellement ou immédiatement lié à la vie humaine dans ce monde ; par exemple le fait de consommer de la nourriture.
Un bienfait "dunyawî" (ni'ma dunyawiyya) est donc un bienfait lié à ce qui sert uniquement, essentiellement ou immédiatement par rapport à la vie de ce monde ; par exemple l'apaisement de la faim, l'absorption des nutriments par l'organisme ; la fertilité d'une terre ; l'intelligence qu'une personne possède.
S'il s'agit d'une créature qui recèle une quantité particulièrement abondante de bienfaits "dunyawî", on parle de "bénédiction d'ordre temporel" (baraka dunyawiyya).
B) Une action "dînî" est une action dont l'avantage est uniquement ou essentiellement ou immédiatement lié à la vie de l'au-delà : par exemple la prière ; ou le jeûne ; etc.
Un bienfait "dînî" (ni'ma dîniyya) est donc un bienfait lié à ce qui sert uniquement, essentiellement ou immédiatement par rapport à la vie de l'au-delà ; par exemple la guidance vers la croyance orthodoxe ; l'acceptation par Dieu de l'action cultuelle que l'on a faite pour Lui ; le fait que Dieu se relie avec l'homme qui cherche à se relier avec Lui.
S'il s'agit d'une créature qui recèle une quantité particulièrement abondante de bienfaits "dînî", on parle de "bénédiction dînî" (baraka dîniyya).
3) Il existe différents degrés de bénédiction (Baraka), aussi bien dunyawî que dînî :
La créature ayant reçu la bénédiction de la part de Dieu est dite : "chose bénie" (mubârak). Certaines créatures ont cependant reçu de la part de Dieu une part plus importante de bénédiction que d'autres (soit de bénédiction dînî, soit de bénédiction dunyawî, soit des deux), ce qui fait qu'elles sont dites : "plus bénies" (par rapport à telle autre chose).
Ibn ul-Qayyim écrit ainsi : "La chose qui apporte le plus de bienfait (anfa'), c'est la chose la plus bénie (ab'rak)" (Zâd ul-ma'âd 4/157).
Ainsi, Dieu dit qu'Il a béni la Terre : "Dis : "Renierez-vous, et donnerez-vous des égaux à Celui qui a créé la Terre en deux périodes – voilà le Seigneur de l'univers –, et a placé au-dessus d'elle des ancres, l'a bénie (bâraka fîhâ) et lui a assigné ses ressources en quatre périodes, égales pour ceux qui interrogent. Puis (thumma) Il S'est établi vers le ciel alors que celui-ci était fumée, puis Il a dit à celui-ci et à la Terre : "Venez, de gré ou de force !" Ils dirent : "Nous venons obéissants." Il fit d'eux sept cieux en deux périodes et Il révéla à chaque ciel l'ordre (qui) lui (revenait). Et Nous avons embelli le ciel le plus bas [ou : le plus proche] par des lampes, et [celles-ci servent aussi] de protection. Voilà l'ordre établi par le Puissant, l'Omniscient" (41/9-12) ; (article 547). Ibn Kathîr écrit : "Il l'a rendue bénie, capable de (produire) le bien, de (recevoir) la semence et le plant" (Tafsîr Ibn Kathîr). La Terre tout entière a donc été bénie par Dieu.
Pourtant, il est des lieux de la Terre que Dieu a davantage bénis encore.
Ainsi, Dieu a dit de la Kaaba : "La première Maison qui a été placée sur Terre est assurément celle qui est à Bakka, bénie (mubârakan), et orientation pour les mondes" (Coran 3/96). Il s'agit d'une baraka dîniyya, liée à l'essence même de la Maison, qui est une orientation pour les mondes, les conduisant à l'adoration de Dieu l'Unique. La présence de la Maison a entraîné aussi une baraka dunyawiyya pour toute la Mecque et même pour tout le Haram, vu que, comme Dieu le rappelait aux polythéistes mecquois : "Ne les avons-nous pas établis dans un Haram sûr, jusque auquel, comme attribution de Notre part, les produits de toute chose sont apportés ?" (Coran 28/57). Ceci constitue une baraka dunyawiyya.
De même, Dieu désigne la terre de Shâm par les termes "la terre que Nous avons bénie (bârakna fîhâ)" (voir Coran 7/137 ; 17/1 ; 21/71 ; 21/81 ; 34/18). Ar-Râzî dit qu'il s'agit d'une baraka dunyawiyya et dîniyya : dunyawî par rapport à la fertilité de cette région et de l'excellence de son climat ; dînî par rapport à la quantité unique de prophètes qui y sont nés et y ont vécus (Tafsîr ur-Râzî, sur Coran 21/71).
En fait, toute la Terre ayant reçu une baraka dunyawiyya de la part de Dieu (conformément à ce que dit le verset 41/9), ces autres versets signifient que la terre de Shâm a pour sa part reçu une part particulièrement importante de cette baraka dunyawiyya, plus importante que d'autres régions de la Terre.
Par ailleurs, cette terre de Shâm a été également décrite dans le Coran comme étant : "la terre sanctifiée" ("al-ardh ul-muqaddassa") (Coran 5/21). Le terme "taqdîs" signifie : "purifier de toute souillure spirituelle et morale (Muf'radât ur-Râghib). "Muqaddassa" veut donc dire : "purifié de ce qui est mal" ; cependant, il s'agit de ce qui est "purifié de ce qui est mal" tout en étant "empli de ce qui est bien" (Asmâ' ullâh il-husnâ, Ar-Ridwânî, p. 250). C'est parce que le terme recèle lui aussi le sens de "être empli de bien" que Mujâhid a commenté "al-ardh ul-muqaddassa" par : "mubâraka" (Tafsîr ul-Qurtubî sur 5/21) ; c'est aussi pourquoi Ibn ul-Anbârî a commenté le terme "Tabâraka" par : "Taqaddassa" (Jalâl' ul-af'hâm, p. 167). Ceci constitue donc ce que nous avions déjà dit plus haut : la terre de SHâm recèle de la baraka dîniyya.
Pareillement à des lieux, il est des moments dans le temps que nous connaissons auxquels Dieu a conféré une bénédiction dînî, c'est-à-dire qu'ils recèlent une valeur (fadhl) dînî particulière. Ainsi en est-il du mois de ramadan, dont le Prophète a dit une fois : "Est venu à vous ramadan, un mois béni (mubârak). Dieu a rendu obligatoire pour vous le fait de jeûner. Les portes du ciel s'ouvrent pendant ce (mois), et les portes de l'enfer se ferment pendant ce (mois). Il se trouve pendant ce (mois) une nuit pour Dieu, qui est meilleure que mille mois. Celui qui est privé du bien de cette (nuit), celui-là est (vraiment) privé" (an-Nassâ'ï 2106, Ahmad). Il s'agit d'une baraka dîniyya, que Dieu a accordée à ce mois.
De même encore, il est des personnes dans l'humanité à qui Dieu a donné plus de faveurs qu'à d'autres. Dieu dit : "Nous (les) bénîmes lui* et Isaac" (Coran 37/113) (* il s'agit d'Ismaël.) De même, le prophète Muhammad (sur lui et sur tous les prophètes soit la paix) est un être béni de baraka dîniyya et de baraka dunyawiyya (ses Compagnons profitaient également de la bénédiction dunyawî de sa personne. Est-il béni parce qu'il a été nommé prophète, ou bien a-t-il été nommé prophète parce qu'il était déjà béni ? Les deux aspects sont vrais.
Pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, on voit qu'il y a des personnes dont Dieu ou Son Messager a dit qu'elles sont plus bénies que d'autres, des lieux sur Terre qui sont plus bénis que d'autres, et des moments du temps qui sont plus bénis que d'autres. On dit que Dieu a favorisé (fadhdhala - yufadhdhilu - tafdhîlan) ces choses par rapport aux autres.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
http://www.maison-islam.com/articles/?p=632
Les madhahibs,la jurisprudence et l'influence de la charia sur les lois modernes
- Le 04/04/2021
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale
Dr Omar Mukhtar Qadhi(*)
Cette étude s'intéresse à cette question vitale qu'est la conciliation entre les écoles de fiqh qui prévalent dans les pays islamiques. Bien que les madhahib islamiques soient considérés comme indépendants les uns des autres, leur analyse confirme que ce sont toutes des écoles d'interprétation de la charia et que chacun de ces madhahib a exercé son influence dans une partie de la vaste région islamique. Loin d'être délibérée, cette répartition était plutôt due à certaines circonstances. En effet, des ulémas sont apparus dans ces régions et ont fondé des écoles qui ont porté leurs noms. A l'époque, les moyens d'information et de communication n'étant pas aussi développés et aussi rapides qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est là la principale raison pour laquelle l'histoire n'a pas réuni toutes ces écoles dans une seule grande école qui serait appelée «l'école de la jurisprudence islamique».
Il importe de noter que jadis, la région où régnait un madhab donné ne connaît pas l'émergence d'un autre madhab concurrent. Le madhab régnant s'impose donc de manière spontanée, et non de façon délibérée, dans la culture religieuse des habitants de la région concernée. A l'ère actuelle, tous les madhahib peuvent cohabiter dans un pays islamique donné, chez les intellectuels et dans les facultés et instituts d'études religieuses.
Quant aux magistrats, les choses ont changés par rapport au passé lorsqu'ils étaient élus en fonction d'un madhab ou d'un autre. Ils sont actuellement des lauréats des facultés de droit, de la charia et des études juridiques où ils ont étudié, outre la jurisprudence islamique, les différents systèmes juridiques. Celà est dû au fait que les institutions de l'Etat ont connu quelques changements substantiels. Ainsi, les institutions législatives modernes, telles que les parlements, ont pour mission de promulguer des lois écrites qui doivent être soumises à l'appréciation des magistrats, sinon les dispositions y afférentes seraient contradictoires.
Quel est le statut du faqih (docteur de droit musulman) aujourd'hui ? La réalité confirme que le travail jurisprudentiel est unique lorsqu'il s'agit aussi bien des questions juridiques positives que celles soulevées par la charia. La distinction entre la jurisprudence islamique et la jurisprudence positive est due au fait que le spécialiste de la première utilise une terminologie autre que celle utilisée par le spécialiste de la seconde. Cela montre que la spécialisation n'est qu'une répartition formelle des matières dont la nature reste la même lorsqu'il s'agit d'une recherche jurisprudentielle. Or, on assiste à une différenciation substantielle entre le travail d'un chercheur en jurisprudence islamique et celui d'un spécialiste en droit positif même si la nature de ce travail est la même, la différence étant dans les moyens utilisés, qui peuvent être facilement fournis à tous les chercheurs. Partant, l'écart entre le spécialiste de la jurisprudence et le chercheur dans le domaine juridique serait plus réduit. A cela s'ajoute l'effort qui devra être déployé en matière de terminologie qui a connu certains changements, même si la distinction entre termes anciens et nouveaux n'a pas touché à leur essence. Dès lors, la comparaison entre les termes est nécessaire aux fins de mieux saisir les significations exactes de tel ou tel autre et de rechercher un langage commun entre les spécialistes de la jurisprudence et les docteurs en droit. Peut-être viendrait-il le jour où l'on parlera de fiqh ou de spécialistes de la jurisprudence dans les pays islamiques sans faire de distinction sur la base de la spécialisation.
Ce constat mérite de faire l'objet d'une étude dont la première phase est le rapprochement entre les madhahib islamiques, puis le rapprochement entre le travail jurisprudentiel dans les domaines de la charia et du droit positif. Enfin, nous considérerons quelques exemples de pays islamiques qui se prêtent à l'étude de l'ampleur de l'influence de la charia sur les lois qui y sont adoptées.
L'Ijtihad et la nécessité de rapprochement entre les madhahib islamiques
Il est nécessaire d'opter pour une application mesurée de la charia islamique en insistant sur la revivification de usul al-fiqh (fondements du fiqh) afin d'y puiser des solutions aux questions actuelles, car à travers la jurisprudence, on peut déterminer, selon des critères bien établis, la légalité et l'illégalité.
Le fait d'adopter les sciences de la jurisprudence met en lumière la conception actuelle de l'application de la charia et conduit également au rapprochement entre les madhahib islamiques d'une part et entre ceux-ci et la jurisprudence d'autre part.
Introduction
Avant d'aborder ce sujet, il convient de mettre en évidence les possibilités théoriques et pratiques de cet essai de rapprochement entre les madhahib islamiques à travers certains points accessibles au lecteur non averti.
Les ulémas, même ceux qui sont attachés à un seul madhab, ne sont pas en proie au fanatisme doctrinal. Certes, certains d'entre eux demeurent attachés en général à un madhab déterminé, mais ils connaissent les constantes et les variables de la charia islamique, dans la mesure où, lors de la discussion d'une question sociale par exemple, ils ne trouvent aucun mal à emprunter la fatwa ou l'avis d'un autre madhab que celui auquel ils appartiennent, d'autant qu'ils fournissent souvent des efforts en utilisant les critères des fondements de la jurisprudence afin d'aboutir à une solution légale contemporaine à laquelle les imams et les ulémas anciens n'auront jamais pensé, différence d'époque oblige.
C'est pour cette raison que nous résumons clairement pour le lecteur la notion du rapprochement entre les madhahib à travers les points suivants :
L'idée de rapprochement entre les madhahib peut être explicitée en deux points :
Dans le premier : nous expliquerons les conceptions théoriques du rapprochement entre les madhahib.
Dans le second : Nous mettrons en évidence la possibilité de mettre en application ces conceptions ou certaines d'entre elles dans notre société islamique moderne à travers les différents pays musulmans.
Premièrement : Les conceptions théoriques du rapprochement entre les madhahib
Ces conceptions se limitent aux trois aspects suivants :
Le premier aspect : la comparaison entre les madhahib et l'adoption de ce qui est commun - parmi les solutions et les avis juridiques- à la plupart d'entre eux et l'invalidation des solutions divergentes et improbables.
Le deuxième aspect : l'adoption de tous les madhahib, avec tous leurs avis et solutions probables et improbables qu'il est possible d'aborder en tant que matière dans laquelle chaque société puise les avis les plus appropriés à sa situation et les codifie en conséquence.
Le troisième aspect : la détermination des critères intellectuels fondamentaux à partir des madhahib anciens et leur utilisation dans la résolution des problèmes, conformément à ces critères scientifiques islamiques, quels que soient les résultats et les solutions proposés à travers l'utilisation de tels critères. Il n'est nullement interdit d'aboutir à des solutions et des résultats que les anciens imams et ulémas n'auront jamais imaginés, tant que ces résultats s'appuient sur une preuve valable et convaincante, qui soit établie grâce à l'utilisation minutieuse et disciplinée des fondements de la jurisprudence.
Deuxièmement : Les possibilités de mise en pratique de ces conceptions
Il est indispensable que le lecteur comprenne que l'objectif du rapprochement entre les madhahib est la recherche d'une application exemplaire de la charia islamique dans tous les pays du monde islamique. Partant, chacun des trois aspects précités implique certains effets lors de sa mise en pratique.
La première conception, c'est-à-dire le choix des différents avis juridiques probables émis par les différents madhahib adoptés et l'invalidation des avis improbables, est difficile à appliquer car elle nécessite un effort colossal. En effet, sa réalisation, d'abord en tant que projet, présuppose une comparaison entre les madhahib, ce qui serait impossible vu la richesse de ce patrimoine, tant au niveau quantitatif que qualitatif.
Le fait d'inventorier le patrimoine qui existe déjà est nécessaire à la comparaison entre ce qui est probable et ce qui est improbable. Par ailleurs, il existe de nombreux détails sur lesquels les ulémas ne se sont pas convenus, outre les questions qui nous sont parvenues des imams et des ulémas les plus célèbres. Il est possible que celui qui défend l'idée de la possibilité d'inventorier ce patrimoine du fiqh soit moqué par ceux qui connaissent bien ce domaine.
Il y a donc une difficulté majeure à faire l'inventaire de ce qui est nécessaire à une comparaison qui pourrait aboutir un madhab commun. D'autre part, concernant les effets pratiques, si l'on suppose la naissance d'un madhab unique et unificateur des Musulmans, nous pouvons nous référer à l'expérience de l'Empire Ottoman qui avait publié «le code des règles adulaires»(1) comme système juridique unifié, issu du madhab hanbalite, en raison de sa simplicité.
Considérant cette expérience, nous pouvons affirmer qu'elle a annulé l'une des caractéristiques primordiales de la charia islamique, à savoir la légitimité de la différence et de la diversité des solutions suivant les changements des circonstances spatio-temporelles. C'est là où réside la commodité qui distingue la religion islamique.
Ce qui est accessible et facilement assimilable n'est pas forcément simple à mettre en application. En effet, une tentative, menée pendant le règne de la dynastie abbaside et qui visait l'adoption du malékisme par tous les pays islamiques, fut abandonnée vu que l'Imam Malik, que Dieu l'agrée, ne l'aura pas admise de son vivant.
Tous les imams conviennent du fait qu'il n'est pas légal d'imposer un madhab donné et que les ulémas doivent également s'abstenir de le faire quelque soit l'époque à laquelle ils appartiennent.
A cet égard, certains livres de l'histoire nous renseignent que des règles de la loi ottomane n'étaient pas appliquées dans certaines régions de l'empire car les habitants adhéraient non seulement au hanafisme mais également à d'autres madhahib.
Quant à la deuxième conception, à savoir la fusion de tous les madhahib de sorte à en faire une matière dans laquelle seront puisés les solutions les plus simples et les plus adaptées à l'époque, elle ne fait certainement pas l'objet des critiques adressées à la première conception, notamment la difficulté de comparer les questions qui font l'objet d'un désaccord ou d'un accord dans un patrimoine riche et varié, mais elle est l'objet, par contre, d'une critique primordiale qui lui reproche la recherche des avis les plus simples et les plus appropriés à l'époque, même si ces avis sont improbables. Nous avons déjà mentionné que l'application d'un avis simple, qui semble facile à appliquer dans notre société moderne peut entraîner des effets non souhaitables. C'est le cas du législateur égyptien qui a promulgué le code du statut personnel dans les années 1970s du siècle passé, après la sélection, par les docteurs de droit musulman et les juristes, des solutions qui paraissaient simples et dans l'intérêt de la femme, mais qui avaient généré des retombées négatives dans la pratique. Le système judiciaire a dû recourir à des astuces juridiques pour contourner l'application de certains textes de cette loi. Néanmoins, les textes encore en vigueur demeurent une source d'insatisfaction pour la majorité des personnes concernées.
Ces deux conceptions de l'application de la charia par mimétisme doctrinal, soit par le choix des meilleurs avis en éliminant les solutions faibles et improbables, soit en considérant tous les avis comme bons, y compris les plus solides et les plus faibles, auront comme résultat une correction radicale des lois actuellement en vigueur dans les pays islamiques. D'autant que l'adoption des madhahib comme règle du qiyas (raisonnement par analogie) de ce qui est légal et ce qui ne l'est pas présuppose de ne plus maintenir aucun texte des lois appliquées actuellement tant que ce texte traite d'une question qui a fait l'objet d'une fatwa par les anciens imams et que l'on n'a pas trouvé un document qui lui est compatible dans ces anciens avis. Le changement qui devrait toucher ces lois serait alors énorme.
Les anciens imams ont fourni un effort de jurisprudence. Cette action jurisprudentielle n'a pas dépassé un certain niveau au fil de l'histoire de la jurisprudence des madhahib. Les Anciens ont fondé des règles qui étaient adéquates à leurs époques. Par contraste, les règles contemporaines diffèrent de celles arrêtées par les Anciens. Comme les anciennes, ces nouvelles règles ne sont instaurées que pour servir les principes de justice et d'équité.
Par ailleurs, les entreprises ont été également traitées par les anciens docteurs de droit musulman en s'inspirant du droit coutumier. A cet égard, la question se pose de savoir comment on peut raviver les sociétés dans leur ancien aspect. Les entreprises connues aujourd'hui contredisent-elles les fondements et les préceptes islamiques ? ou plutôt se distinguent-elles uniquement par leurs formes par rapport aux règles anciennes du fiqh, sans toucher les principes islamiques ?
Le fait d'imposer la jurisprudence doctrinale ancienne comme règle contraignante unique pour mesurer la légalité ou l'illégalité signifie qu'on porte un jugement sur la légitimité islamique, selon lequel les critères de celle-ci ne sont pas en mesure de déduire plus de solutions légales que les Anciens. Cela signifie également que les variables de l'ijtihad sont considérées comme étant des constantes, au même titre que le Coran et la Sunna, sachant que ces deux dernières sources se caractérisent, dans de nombreux textes, par une flexibilité suffisante permettant la déduction d'avis contemporains qui n'auraient jamais traversé l'esprit des anciens.
Dès lors, la notion de charia islamique est circonscrite dans un champ très étroit. Selon les deux courants précités, tous les textes des lois contemporaines qui traitent de questions ou de sujets non soulevés par l'ancien fiqh des madhahib, sont frappés d'illégalité et demeurent insatisfaisants, quels que soient leurs bienfaits ou leurs méfaits, indépendamment de leur caractère équitable ou injuste.
Les effets que nous avons énumérés et qui concernent le domaine du droit contemporain, s'appliquent également aux administrations et aux institutions modernes. En effet, un grand nombre de leurs règles seront considérées illégales, si l'on s'inspire du fiqh doctrinal ancien. La troisième conception, c'est l'application mesurée de la charia islamique, en insistant sur la revivification des usûl Al-Fiqh (fondements du fiqh), afin de puiser dans ses dispositions les solutions aux questions contemporaines, car à travers la jurisprudence, on peut mesurer, selon des critères bien établis, la légalité et l'illégalité.
L'usage des fondements du fiqh et de ses critères, sans imitation des aspects secondaires de ces fondements, conduira à des effets intéressants et souhaités dont :
- La possibilité d'une vision contemporaine de l'acception pratique de la charia islamique, qui n'entrainerait pas un bouleversement radical des lois et des cou-tumes communément connues, mais présuppose uniquement une correction de certaines contradictions par rapport aux sources fondamentales de la charia islamique, le Coran et la Sunna, ainsi qu'à certains critères scientifiques fondamentaux utiles pour en appréhender les textes et en saisir l'esprit.
- La possibilité de mesurer tous les sujets et les questions -non soulevés par les Anciens et non traités de manière directe par le Coran et la Sunna- du point de vue de leur légalité ou illégalité islamique et de leur compatibilité ou non à l'esprit de la charia.
Partant, le concept d'islam véridique apparaîtra, à savoir la correction mesurée de la situation des entreprises, la visée de l'islam n'étant pas d'imposer une seule forme et une seule conduite à tous les peuples musulmans, mais comme admettant les différences sociales, environnementales et de coutumes, tant qu'elles n'altèrent pas les principes essentiels de cette religion. En islam, l'unité escomptée réside dans l'adoration de Dieu Seul et la défense de cette religion face aux agressions éventuelles. A chaque société ses circonstances et ses potentialités qui lui sont propres. Il est, par conséquent, impossible, qu'elles soient conformes à celles d'une autre société.
C'est cette acception pratique de la charia islamique, exempte de mimétisme, qui a recours aux critères des fondements du fiqh, pour répandre la da'awa islamique (l'appel à l'islam). Car dans la société non musulmane, si quelqu'un veut se convertir à l'islam sans avoir une référence intellectuelle fondamentale pour comprendre cette religion, ce qui est permis et ce qui est interdit à travers le mimétisme superficiel des anciens madhahib, sans faire la distinction entre les variables et les constantes de ces fatwa, se trouvera devant un vaste océan qui exige de sa part des changements radicaux. Il sera alors plus craintif de devenir adepte de cette religion ou de sa prolifération dans son pays.
A la lumière de la flexibilité qui caractérise les règles et les critères des fondements de la jurisprudence, nous pourrons aboutir à une pensée généralement unifiée et nous comprendrons que les différends sur les détails, en ce qui concerne certaines questions, sont dus aux différences de l'emplacement géographique et du climat social. C'est là l'essence même de l'objectif que visent à réaliser les partisans du rapprochement entre les madhahib.
Il convient de signaler, à cet égard, que la revivification des usul al-fiqh est, en réalité, une unification de la méthodologie intellectuelle et une ressuscitation des madhahib anciens sous une forme moderne, d'autant que nous sommes intéressés par la revivification des mêmes critères usités par les anciens ulémas. Or, ces critères constituent la voie la plus aisée pour l'instauration de relations de coopération saines et avancées entre le monde islamique et l'Occident. Ils sont empreints de légalité islamique en étant acceptables et accessibles par les non musulmans. De fait, la revivification de la pensée fondamentaliste normative aura un impact important sur la reformulation des principes et des fondements dans un discours moderne servi par une terminologie et une sémantique contemporaines.
La revivification des usul al-fiqh et de ses règles globales pour le rapprochement entre les critères de la pensée islamique
1. L'importance des fondements du fiqh :
Les fondements du fiqh sont la science qui comprend les critères abstraits par lequels le mujtahid (celui qui pratique l'ijtihad) traite des problèmes et des questions pratiques à la lumière du Coran et de la Sunna, afin de leur attribuer la description jurisprudentielle adéquate : licite, illicite, souhaitable, interdit, prohibé, obligatoire ou recommandé.
La science des fondements du fiqh ne se limite pas aux critères d'interprétation des textes du Coran et de la Sunna, indépendamment les uns des autres -avec tout ce qu'elle comprend comme règles dialectiques et logiques explicitant ces textes- mais les dépasse plutôt en englobant les critères de compréhension de l'esprit général de la charia islamique qui vise à la réalisation des objectifs dans un cadre de tolérance et de facilité pour les membres de la société. C'est pourquoi les spécialistes de la jurisprudence pratiquaient l'ijtihad afin de préserver les intérêts et réaliser les objectifs, dans un esprit de commodité, et considèrent certaines coutumes légales malgré son caractère clairement contradictoire aux textes, parce qu'elles correspondent, d'un autre angle, à l'esprit général de la charia.
D'autre part, il existe des questions qui n'ont pas été traitées directement par le Coran et la Sunna, mais auxquelles ces sources ont tracé les voies de l'ijtihad et de la réflexion. Ainsi, il est dit dans le Saint Coran : «Ceux qui répondent à l'appel de leur Dieu, accomplissent la Salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons»(2). La soumission à la prescription divine de consultation dans le traitement de ces questions ne concerne pas une génération à l'exclusion de l'autre puisque le Saint Coran s'adresse à tous les gens quel que soit le contexte spatio-temporel. Partant, la prescription de consultation est durable et son adoption obligatoire, ce qui nous appelle ipso facto à l'ijtihad.
L'ijtihad est constitué de plusieurs types car la réflexion est une opération mentale individuelle qui diffère selon les besoins et les objectifs, aussi divers qu'ils soient. On cite, à titre d'exemple, l'ijtihad du spécialiste du fiqh, objet de la présente étude.
Quant à l'ijtihad collectif par la consultation, il consiste à réunir tous les efforts individuels de réflexion et leur comparaison en vue de déterminer l'avis ou la fatwa -qui constitue le point commun entre la majorité des efforts individuels- et l'adopter dans le respect de la prescription de consultation instituée par Dieu Tout-Puissant.
La consultation se décline de différentes manières et fait l'objet de la même analyse car la collectivité ne constitue une mentalité unique ni ne développe une réflexion uniforme ; c'est plutôt une somme d'idées et de pensées individuelles dont chacune développe une réflexion et une analyse indépendante.
Les Anciens nous ont transmis un patrimoine dont les éléments les plus précieux - après le Coran et la Sunna - sont la science des fondements du fiqh et ses règles générales. L'utilisation de cette science présuppose d'en adopter les critères, sans pour autant imiter, jusque dans les détails, les Anciens dont les écrits se sont accumulés dans nos bibliothèques et qui ont conduit à un certain relâchement dans la considération de notre réalité actuelle, puisque nous avons récupéré et adopté avec une simplicité déconcertante les fatwas de nos prédécesseurs. Partant, nous avons inversé les situations: le climat général régnant étant de faire en sorte que le recours aux aspects secondaires du fiqh et l'imitation des Anciens sur ce chapitre prime sur le retour au Coran et la compréhension de ses textes et de son esprit à la lumière de notre réalité actuelle. Nous sommes devenus alors des fanatiques de madhahib sans nous rendre compte que le madhab était une école de la pensée fondamentale qui inculque aux élèves les fondements de la réflexion et d'éviter de craindre d'être en désaccord avec leur maître. En effet, les disciples des imams - même s'ils adoptent leurs méthodologies scientifiques fondamentales - avaient des points de vue différents sur bon nombre de questions.
Par conséquent, si les temps changent et que les événements sont infinis, la soumission aux prescriptions divines exige que nous poursuivions la voie de l'ijtihad en adoptant les règles issues des fondements du fiqh. L'exploitation de cette science n'altérera point les principes immuables et les constantes de notre religion, mais contribuera à les préserver.
Les variables de l'ijtihad, c'est-à-dire les fatwas et les avis qu'il est possible de changer, en suivant en ce sens les critères des fondements du fiqh, sont nombreux dans notre patrimoine écrit. Il est nécessaire de donner raison à ces avis pour qu'ils aient une valeur consultative chez les ulémas contemporains. Cependant, il ne faut pas craindre leur modification, comme il ne faut pas craindre d'être en accord avec ces avis en suivant la méthode des fondements du fiqh, autrement ils auraient la même valeur que les dispositions contenues dans le Coran.
En effet, l'Imam Al-Chafi'i a changé les fatwas qu'il a émises en Irak lorsqu'il est arrivé en Egypte, à tel enseigne que les historiens ont dit qu'il a adopté deux madhab : une école ancienne irakienne et une nouvelle école égyptienne.
Vu que les livres du patrimoine étaient des manuscrits destinés à ce moment là aux spécialistes et n'étaient pas accessibles au grand public, ni même aux intellectuels, leurs auteurs ne trouvaient pas d'intérêt à donner des indications suffisantes ou des références montrant la source directe dans laquelle le docteur en droit musulman a puisé son avis ou sa fatwa. Les lecteurs de ces livres n'avaient pas besoin de ces éclaircissements pour connaître les dispositions renvoyant aux textes, à la coutume, à l'intérêt général ou à l'appréciation.
Aujourd'hui que ces livres sont largement diffusés grâce à l'imprimerie, le grand public semble se désintéresser des ulémas contemporains, croyant qu'il n'en a plus besoin, puisque ces livres traiteraient des questions du fiqh sous toutes les coutures. Ils considèrent comme absolues les vérités contenues dans ces livres par analogie aux questions relatives aux pratiques du culte(3).
C'est pour cette raison que dans le grand public, certaines personnes prétendent détenir le savoir alors qu'ils ne justifient d'aucune compétence en matière d'ijtihad et qu'ils ne font rien d'autre que réciter les paroles d'autrui sans analyse ni distinction entre ce qui pourrait être modifié et ce qui ne le pourrait. Du coup, les gens se rassemblent autour de ces personnes croyant à tort que leurs paroles ont une valeur absolue et irréfragable.
Il est regrettable, par ailleurs, de constater que les ulémas contemporains ne fournissent pas assez d'efforts pour apporter des indications et des éclaircissements dans les livres du fiqh, qui soient accessibles au grand public, le but étant de renseigner les lecteurs sur les constantes qui relèvent du Coran et de la Sunna d'une part, et des variables qui participent de la coutume, de l'intérêt général, de la préférence et bien d'autres sources du fiqh.
L'application moderne ou ancienne des fondements du fiqh est à l'origine de la charia. Ce sont, par ailleurs, les anciens ulémas qui ont interdit l'imitation et qui ont soutenu qu'elle porte atteinte à la charia(4).
Certes, les règles des fondements de la charia étaient utilisées par tous les anciens spécialistes du fiqh, mais c'est l'imam Al-Châfi'i qui a le mérite de les avoir mis au jour et d'en avoir établi les bases théoriques.
La véritable fidélité aux Anciens réside dans l'adoption de leur voie intellectuelle et leur méthode fondamentale -sans imitation des détails et des fatwa- car c'est ainsi que nous garantissons leur diffusion, voire leur réactivation, alors que la répétition de leurs paroles et de leurs fatwa sans ijtihad ni effort revient à réduire les horizons qui s'offrent dans ce domaine et à nier le fait que la charia est une source intarissable de solutions et de possibilités valables en tout temps et en tout lieu.
Le responsable usant des fondements du fiqh, en se basant sur sa propre réflexion, devra être un connaisseur des critères de cette science. L'utilisation des fondements et des critères du fiqh à partir d'une position donnée est générale et devra intervenir dans tous les domaines de la société islamique en visant à une application normative, moderne et correcte.
L'utilisation de ces critères n'implique pas que les responsables devront en avoir une connaissance approfondie. A cet égard, ils devront plutôt se référer aux experts dans ce domaine ou avoir des conseillers spécialisés en la matière. Partant, il faut qu'il y ait un nombre important de spécialistes du fiqh et de ses fondements dans la société islamique.
2. Les règles fondamentales du fiqh
Nous avons vu que la science des fondements du fiqh vise la formation de l'esprit scientifique et technique chez l'expert ou le spécialiste afin de servir le grand public dans les différents domaines de la vie (la culture, l'enseignement, le droit, la politique.). Il devra donc avoir connaissance de la politique générale du gouvernement dans la promulgation des lois et la création d'institutions et de services nécessaires à la société et à son progrès. A cet égard, Il faut tenir compte du fait que cette science comprend l'un des principaux fondements relatifs à la politique légale, à savoir le principe de consultation qui doit revêtir divers aspects plus ou moins étendus selon la graduation des intérêts dans une société, lesquels diffèrent en fonction des sociétés islamiques et de leur diversité culturelle, intellectuelle, sociale, politique et économique.
A cette science se joignent les règles fondamentales du fiqh qui viennent après les fondements généraux. Elles se positionnent -dans la réflexion et l'analyse- entre ces fondements et les branches auxquelles elles devraient être comparées afin de déceler leurs caractéristiques légales de proscription et de prescription en tout temps, et ce à travers les ulémas et les experts en matière technique et pratique.
Si nous considérons que les sciences de Usul Al-Fiqh, en tant qu'étapes de la recherche et de la connaissance qui commence par le retour aux préceptes du Coran et de la Sunna en nous référant à ces dispositions, nous nous rendrons compte que l'esprit de la législation tend vers la facilité et non la difficulté et nous nous rendrons compte forcément que cette législation s'adresse aux gens dans des circonstances normales. Dans le cas de circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'application littérale de l'une des dispositions législatives conduirait à une difficulté ou à des effets néfastes, il est permis -et en nous basant sur les mêmes textes- de ne pas être en accord avec les ordres sans embarras, suivant en cela le verset qui dit : «Quiconque a renié Allah après avoir cru...- sauf celui qui y a été contraint alors que son cour demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cour à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible»(5), ou le hadith suivant : «Que ma Oumma soit exempte de l'erreur, de l'oubli ou de toute chose blâmée»(6). Il est admis aussi d'atténuer autant que faire se peut le degré de la récompense si l'acte astreignant constitue encore un danger ou pouvant entraîner un impact négatif ou si son auteur était en mesure d'éviter d'être en désaccord avec le texte ou de se conduire d'une façon à produire un impact ou un danger moindre.
Face à ce genre de problématiques interviennent les règles fondamentales du fiqh par la formulation théorique abstraite telle : «les obligations légalisent les interdit» ou «les obligations sont appréciées selon leur valeur».
Ces règles aident les magistrats dans leurs appréciations, renforcent leur discernement durant les procès et aident le législateur dans la promulgation des lois nécessaires à la réalisation de l'intérêt général.
Il en ressort que les règles générales du fiqh comprennent celles qui sont directement inspirées des textes, et dans ce cas le spécialiste du fiqh se contentera de formuler leur contenu de manière simple, claire et compréhensible pour toute personne intéressée. Comme à titre d'exemple, «les obligations légalisent les interdits» et «l'allégement de la peine». Certaines règles relèvent de la créativité comme la bidaâ (l'innovation), mais elles visent toutes le maintien de l'ordre comme par exemple la règle : «La preuve pour celui qui prétend, et le sermon pour celui qui renie».
Comme ces règles se caractérisent par une formulation créative dont la visée est la bonne compréhension de la législation, l'application équitable de la loi et le règne de la justice, il n'est nullement interdit de développer ces formulations et ces approches esthétiques afin de rendre plus intelligible ces règles dans la culture actuelle et permettre à la société de poursuivre son chemin dans la voie de la justice et de l'équité dans le cadre de la législation et de la loi.
3. La nécessité de l'ijtihad
L'adoption de la méthodologie de la pensée fondamentale islamique présuppose que le penseur ne mesure pas les questions à la lumière des fatwas des autres -qu'ils soient anciens ou modernes- mais plutôt en usant des critères scientifiques fondamentaux et en étant à la fois crédible et précis dans les formulations. Il importe peu que les avis soient, en définitive, en accord ou en désaccord avec les avis hérités des Anciens, tant que ces avis sont le fruit d'une analyse fondamentale. Car les critères de la charia islamique permettent la diversité des solutions dans de nombreux cas. Il n'est nullement approprié de limiter cette diversité dans un nombre déterminé car c'est par l'utilisation des fondements du fiqh qu'il est possible d'ajouter des alternatives législatives modernes aux anciennes solutions et fatwas.
Il importe toujours de faire la distinction entre les constantes et les variantes. Dès lors, la connaissance de cette différence dépend à la fois de l'adoption des ulémas de la méthodologie des fondements du fiqh islamique et de la prise de conscience par tout individu de la véracité des paroles de ces ulémas et de la force de leurs arguments.
Les exemples relatifs au caractère inéluctable de l'ijtihad dans la charia ne manquent pas. Il est à l'origine de la charia, sans lequel point de foi. L'ijtihad présente des degrés dont le plus élevé est l'effort intellectuel fourni pour comprendre le discours divin. Ainsi, le Coran nécessite que l'on fasse un effort pour en interpréter les textes, d'autant plus qu'il procure un plaisir et un soulagement à celui qui le comprend alors que celui qui n'y arrive pas reste sur sa faim et la foi ne trouve pas le chemin de son cour.
Il n'est d'individu qui croit et continue de croire en une confession héritée de ses ancêtres sans que sa foi ne soit basée sur un ijtihad personnel.
La recherche de la Grâce et d'Allah, par la connaissance de l'esprit général de la charia, ses principes et l'ijtihad dans la gestion de la société à la lumière de la tolérance prônée par cette charia, est une exigence. En effet, les textes ont traité certaines questions essentielles mais ils en ont laissé une infinité. Ce qui reste revêt également un grand intérêt. Dieu l'a sciemment laissé à l'effort de l'ijtihad et la consultation, afin que ne cessent ni la coopération entre les individus, ni la pensée et la réflexion. Partant, l'esprit est soumis à un exercice de réflexion continu afin d'atteindre le degré le plus élevé de la conception de la justice et de la bonté, et d'acquérir la capacité soutenue de mettre en relation théorie à pratique.
Aujourd'hui, les ulémas qui pratiquent l'ijtihad sont peu nombreux par rapport à ceux qui récitent les paroles des autres. Ces derniers se laissent emporter par la facilité et ne recourent guère à la réflexion même pour le choix d'un exemple moderne confirmant leurs opinions. A titre d'exemple, ils en sont encore à ergoter sur les modalités de partage d'un esclave entre plusieurs partenaires, omettant une problématique bien plus importante, à savoir : «L'islam accepte-t-il l'esclavagisme?».
Une partie des imitateurs cherchent à gagner de l'argent en publiant des livrets portant leurs noms, mais dont le contenu est copié des anciens livres. D'autres utilisent la même méthode dans la production de recherches servant à l'avancement de leur carrière académique, sans que celles-ci ne portent le sceau de leur propre réflexion. Ceux-là et leur semblables ne jouent aucun rôle dans la formation des esprits et ne servent guère leurs sociétés.
Les mujtahidûn (Ceux qui pratiquent l'ijtihad) existent, mais ils ne constituent qu'une minorité. Le mujtahid n'est pas celui qui exprime des idées anciennes dans un langage moderne en utilisant des exemples actuels. C'est plutôt celui qui porte une réflexion sur un sujet donné en puisant dans les règles et les critères des fondements du fiqh : Comment se réfère-t-il au Saint Coran, à la Sunna et au consensus légué par les compagnons du Prophète ? Comment fournit-il l'effort de l'ijtihad pour comprendre ces textes ainsi que les raisons de leur révélation, et comment les relie-t-il à la réalité présente en association ou en dissociation, en usant d'une argumentation fondamentale islamique ? L'ijthad est donc un processus scientifique, technique et juridique qui doit être valable en tout temps et en tout lieu.
Nous avons constaté que le nombre des ulémas utilisant les fondements du fiqh est trop limité pour subvenir aux besoins de la société islamique en la matière. Afin d'augmenter leur nombre, il faudra réfléchir à une méthode pratique et efficace. Nous pensons, à cet égard, que la manière la plus efficace réside dans les programmes d'enseignement.
Comme les cursus des universités islamiques sont axés sur les aspects théoriques et académiques plutôt que sur la pratique intellectuelle de l'ijtihad, nous croyons qu'il convient d'intégrer de nouvelles matières dans les programmes actuels. Nous faisons allusion aux matières stimulant la réflexion et suscitant la méditation, l'appréciation et l'analyse, telles par exemple «les circonstances sous-tendant les hadiths».
Il faudra également accorder de l'intérêt à la formation universitaire, et ce à travers les recherches qui se basent sur l'utilisation de la science des fondements du fiqh, sans pour autant imiter les Anciens et sans appliquer un qiyas fondé sur les branches du fiqh. Cette formation doit être dispensée en veillant à ce qu'elle ait la même importance que les études théoriques afin d'atteindre les objectifs escomptés.
(*) Professeur à l'Université Al-Azhar (Egypte) et à l'Université Al-Mamlaka (Bahreïn) ; Consultant auprès de l'Institut Avicenne des sciences humaines (Lille, France).
(1) C'est le premier code civil islamique. De fait, il s'agit d'une codification officielle du fiqh islamique qui a eu lieu sous l'empire ottoman. Ce code civil fud édité par décret du Sultan Abdel Aziz bin Mahmoud II en 1869 et est entré en vigueur en 1876 sous le règne du Sultan Abdel Hamid II.
(2) Sourate Al-Choura, verset 38.
(3) L'imam Al-Suyûti affirme que le commun des mortels ne peut pas saisir la signification de tenter les dispositions de la charia en se référant aux écrits des docteurs de droit musulman, Cf- Ar-rad ala man akhlada ila al-ardi wa jahala ana al-ijtihada fi kuli asrin fardun, annoté par Khalil Al-Mays, p. 118, Beyrouth, 1403H / 1983.
(4) Op. cit., p. 70.
(5) Sourate An-nahl, verset 106.
(6) Rapporté par Ibn Maja, Ibn Hayyân et Al-Daraqtâni Ibn Abbas.









































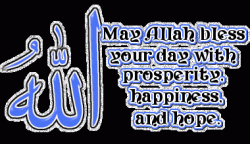
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité