L'Islam et les autres religions
L’islam estime que toutes les religions procèdent d’une même source : Allah. De ce fait, elles conservent malgré les péripéties de l’histoire une morale et des valeurs communes. Quand bien même les voies et les moyens diffèrent, les religions - plutôt la religion car en principe il n’y a qu’une seule religion- ont essentiellement pour but d’assurer à l’homme le bonheur ici-bas et dans l’au-delà.
« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait prescrit à Noé, ce que Nous t’avons révélé à toi-même, ce que Nous avions prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus : « Etablissez la religion et n’en faites pas un sujet de divisions. » s42 v13
Découvrez les articles classés par catégories
Pourquoi le Coran reprend certains récits bibliques?
- Le 11/08/2012
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
Le fait que des récits se trouvant dans le texte biblique soient aussi présents dans le texte coranique n'implique pas que le second soit un plagiat du premier : nous musulmans expliquons cette communauté de certains récits par deux raisons…
A) L'une est que le Coran a le même auteur qu'un certain nombre de passages de la Bible ; le texte de l'Ancien Testament a connu des retouches à cause de l'histoire difficile que connurent ses porteurs, mais il est des éléments s'y trouvant qui ont la même origine que le texte coranique : Dieu. Car il faut rappeler ici que Muhammad n'a jamais prétendu être le seul prophète de Dieu, mais bien le dernier prophète et messager de Dieu, dont le message présente, par rapport à ceux de Moïse et de Jésus notamment, ce qu'on peut appeler un "changement dans la continuité". L'origine commune explique la similitude de certains récits. Une nuance, toutefois : Youssef Seddik écrit : "Le Coran est la transcription, pour ainsi dire brute, d'une révélation qui fut faite à Muhammad le Mecquois entre 610 et 632. Les Ecritures saintes précédentes se contentent de "citer" Dieu" (Le Nouvel Observateur, n° 2042-2043, 24 décembre 2003-7 janvier 2004, p. 78). En effet, la forme qu'a prise ce qu'on nomme l'Ancien Testament est telle que si un certain nombre de passages de cet Ancien Testament contiennent d'authentiques révélations divines faites à des prophètes antérieurs, ces révélations sont insérées dans la narration de la vie de ces prophètes. Les quatre Evangiles constituent quant à eux des "biographies religieuses" de Jésus, où sont relatés sa mission, ses actes et ses propos. Youssef Seddik poursuit : "Le texte du Coran, lui, est "à la première personne" : c'est Dieu qui parle de bout en bout" (Ibid.).
B) L'autre raison expliquant la communauté de certains récits entre le texte coranique et certains écrits judéo-chrétiens non prophétiques est que parfois Dieu a, dans Sa Parole qu'est le Coran, relaté des événements historiques auparavant rapportés par des hommes non-prophètes. C'est le cas par exemple du récit des Sept Dormants : l'événement que ce récit mentionne s'est déroulé postérieurement à l'époque de Jésus comme de celle de ses Apôtres, et de ce fait ne figure pas dans le texte biblique (ni les Evangiles ni les Actes des Apôtres ni les Epîtres de l'un ou de l'autre) ; par contre il était présent dans la tradition syriaque chrétienne (et notamment dans deux homélies de Jacques de Saroug, mort en 521 de l'ère chrétienne) avant d'avoir été relaté et donc confirmé par Dieu, dans Sa Parole qu'est le Coran, à un moment compris – dans le calendrier d'humains – entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne (c'est la période des vingt-trois années où eut lieu la révélation du Coran à Muhammad). L'historicité de l'événement explique qu'il ait été relaté par des hommes, et aussi par Dieu lors de Sa dernière révélation, le Coran (récit des "Gens de la Caverne", Coran 18/9-26) : Dieu n'a fait que confirmer un événement que des hommes non prophètes avaient relaté avant qu'Il n'en parle dans une Révélation.
-
Ensuite il faut savoir qu'à côté des similitudes entre texte biblique et texte coranique à propos de certains récits, il existe aussi entre eux trois différences majeures à ce propos…
1) Première différence entre la Bible et le Coran :
A côté des récits présents dans la Bible aussi, le Coran contient d'autres récits qui ne figurent absolument pas dans le texte biblique. Ainsi, les histoires de 'Ad, de Thamûd, de Madian avec leur prophète respectif – Hûd, Sâlih et Shu'ayb – ne figurent pas dans le texte biblique, alors qu'ils sont développés dans le Coran (cf. Al-Jawâb us-sahîh 1/180).
-
2) Seconde différence :
Il arrive que, pour un même récit, texte coranique et texte biblique présentent de sérieuses divergences. Au regard des musulmans, la raison en est la présence d'erreurs humaines dans la retransmission d'une parole divine antérieure, ou dans la relation d'un événement historique antérieur (pour plus de détails, lire notre article à ce propos). Maurice Bucaille écrit ainsi : "(…) Dans les pays occidentaux, juifs, chrétiens et athées s'accordent unanimement pour avancer (sans d'ailleurs la moindre preuve) que Mahomet a écrit ou fait écrire le Coran en imitant la Bible. On avance que des récits coraniques reprennent les récits bibliques. Cette prise de position est aussi légère que celle qui amènerait à dire que Jésus aurait lui aussi trompé ses contemporains pour s'être inspiré de l'Ancien Testament au cours de sa prédication : tout l'Evangile de Matthieu est – on l'a vu – fondé sur cette continuité avec l'Ancien Testament. Quel exégète aurait l'idée d'enlever à Jésus son caractère d'envoyé de Dieu pour ce motif ? C'est bien ainsi, pourtant, qu'en Occident le plus souvent on juge Mahomet : il n'a fait que copier la Bible. Jugement sommaire qui ne tient aucun compte du fait que, sur un même événement, Coran et Bible peuvent donner des versions différentes. On préfère passer sous silence la divergence des récits. On les déclare identiques et ainsi les connaissances scientifiques n'ont pas à intervenir. Ces questions seront développées à propos des récits de la création et du déluge" (La Bible, le Coran et la science, Seghers, Paris, p. 126).
2.1) Il est des points où le Coran se démarque explicitement d'éléments présents dans le texte biblique : ainsi, le Coran affirme que Adam et Eve mangèrent ensemble le fruit interdit, demandèrent ensemble pardon à Dieu et reçurent ensemble le pardon de Dieu : ce disant, il semble se démarquer de l'idée que ce soit Eve qui ait montré la voie du péché à Adam et que Adam se soit plaint à Dieu de son épouse comme étant l'instigatrice de la faute ; ainsi encore, le Coran se démarque explicitement de l'idée que Jacob, entendant le récit que Joseph, son fils, lui fait de son songe, l'ait grondé ; le Coran affirme clairement que la main de Moïse est devenue blanche sans aucune maladie (allusion au fait qu'elle ne devenait pas "lépreuse", comme le dit le texte biblique) ; le Coran déclare avec force que Salomon n'a jamais adoré des idoles, etc. ; de même, le Coran donne comme nom au père de Abraham : "Azar", et non "Térah" ; pareillement, le Coran parle du roi d'Egypte de l'époque de Moïse en disant "Pharaon", mais désigne celui de l'époque de Joseph par un simple "le roi" (nous allons y revenir plus bas)...
2.2) Il est d'autres points à propos desquels le Coran ne confirme ni n'infirme les éléments du texte biblique : le Coran n'affirme par exemple pas que le Déluge de l'époque de Noé ait été universel, comme il n'affirme pas non plus qu'il ait été localisé ; en fait il ne dit rien de son ampleur ; le Coran ne donne non plus aucun chiffre concernant la communauté israélite qui émigre d'Egypte sous la conduite de Moïse ...
2.3) Enfin, il est des éléments que l'on trouve dans le Coran alors qu'ils sont inconnus de la tradition judéo-chrétienne (ils sont absents aussi bien du texte biblique que des autres écrits) : ainsi en est-il de la présence d'un "Haman", responsable de constructions, dans l'entourage de Pharaon, du sauvetage du corps de Pharaon après sa mort dans les flots (Coran 10/92), de la demande faite par les apôtres à Jésus de prier Dieu qu'Il fasse descendre une table garnie (Coran 5/112-115 ; voir commentaire de H. Boubakeur, tome 1 pp. 332 et 395).
-
3) Troisième différence :
Dans le Coran, les détails des récits et la narration linéaire sont souvent estompés, au profit d'allusions et de réminiscences qui mettent en exergue l'objectif premier du récit : la leçon spirituelle, morale et humaine à en retirer. Youssef Seddik écrit : "Faisant preuve d'une profonde connaissance de la matière biblique, il [le Coran] en récapitule l'héritage, du récit adamique jusqu'à l'ascension de Jésus et la prédication de Jean-Baptiste, en passant par le Déluge, l'Exode, le règne de David et de Salomon, les vicissitudes de Job et Jonas… Mais il abandonne la narration factuelle, si frappante dans les deux Testaments, au profit d'un ton métaphorique visant à délivrer une leçon d'humanité. Les péripéties historiques s'estompent, le récit coranique se fait parabole" (Le Nouvel Observateur, n° 2042-2043, p. 78). Je me suis ici contenté de reproduire ces explications de Y. Seddik, tout en sachant qu'il est certains points – qui n'ont rien à voir directement avec le sujet en cours – où il ne partage pas vraiment la vision islamique orthodoxe à propos du Coran.
-
Un point, simple, qui prouve que l'auteur du Coran n'est pas le prophète Muhammad :
La Bible emploie le mot "pharaon" pour désigner non seulement le souverain d'Egypte de l'époque de Moïse mais aussi celui de l'époque de Joseph (Genèse 47/11) et même celle de Abraham (Genèse 12/15-20).
Or, alors qu'il emploie bien ce nom "pharaon" à propos du souverain d'Egypte de l'époque de Moïse, et ce en plus de 74 fois (cf. Al-Mu'jam ul-muhah'ras li alfâz il-qur'ân il-karîm), le Coran n'emploie jamais le nom "pharaon" pour désigner le souverain d'Egypte de l'époque de Joseph : à son sujet il utilise le terme "roi", et ce aux cinq occasions où il fait allusion à lui (12/43, 12/50, 12/54, 12/72, 12/76), et bien qu'il dise explicitement que cette partie du récit de Joseph se déroule en Egypte (12/21, 12/99).
Maurice Bucaille écrit : "(…) les études linguistiques modernes ont montré que le mot "pharaon" a commencé par désigner "la grande maison", la demeure du roi de l'Ancien Empire, vers 2400 avant J.-C., mais son emploi pour désigner la personne même du souverain n'est attesté dans les textes qu'à partir de l'époque amarnienne, vers 1370 avant J.-C (J. Vercoutter)" (Moïse et Pharaon, Seghers, p. 73). "Le roi d'Egypte n'a été désigné par le vocable "Pharaon" qu'à partir du roi Aménophis IV, c'est-à-dire au deuxième quart du XIVè siècle avant J.-C. Toute utilisation du mot pour désigner un roi d'Egypte avant cette époque est un anachronisme (…)" (p. 298), anachronisme "qui serait comparable à l'erreur que commettrait, par exemple, un historien du futur – connaissant l'usage courant que l'on fait du mot "Elysée" pour désigner le chef de l'Etat – en appliquant ce mot pour nommer le roi de France il y a plusieurs siècles" (p. 73).
Si le Coran était un plagiat de la Bible, et si Muhammad, un arabe illettré du VIIè siècle de l'ère chrétienne, était son auteur – comme certains l'affirment – et non son récepteur-retransmetteur – comme le dit la croyance des musulmans –, alors comment expliquer que cet homme ait pu savoir que, pour désigner soixante-quatorze fois le souverain d'Egypte de l'époque de Moïse, il fallait bien recopier du texte biblique le terme "Pharaon", alors que, pour décrire cinq fois le souverain d'Egypte du temps de Joseph, il était impératif de délaisser ce même terme, ayant pourtant été ici aussi employé dans le texte biblique, et lui préférer le mot "roi".
Bucaille écrit : "Je signale qu'à l'époque de la communication aux hommes du Coran, la langue égyptienne ancienne était disparue depuis plus de deux siècles de la mémoire humaine [cf. p. 252] ; elle en restera effacée jusque dans le cours du XIXè siècle. On ne pouvait par conséquent pas alors savoir qu'un roi d'Egypte de l'époque de Joseph devait être désigné autrement que dans la Bible. Subtilité du choix des expressions, à ce sujet, du texte du Coran, qui suscite la réflexion" (Moïse et Pharaon, p. 298).
-
Un mot pour conclure :
On peut, en un mot, dire que le récit coranique renvoie au récit biblique – dont il confirme des passages, parce qu'ils sont d'origine divine et/ou de relation humaine authentique – et, tout à la fois, se démarque de lui.
Le Coran renvoie au récit biblique dans la mesure où une partie de celui-ci relate des vérités historiques – que l'auteur du passage soit Dieu ou des chroniqueurs humains – et qu'il s'agit de se référer à cette partie du texte biblique si on désire obtenir le détail de ce à quoi le Coran ne fait (comme l'a fait remarquer Y. Seddik) qu'allusion. Tout musulman qui a un tant soit peu étudié les ouvrages de commentaires du Coran (tafsîr) le dira : comprendre certains éléments du texte coranique mentionnés sans détail ni explication (comme par exemple l'identité de Gog et Magog) se fait par référence à des éléments présents dans des écrits judéo-chrétiens (désignés par les Commentateurs du Coran sous le nom général de "isrâ'îliyyât"), qu'il s'agisse de passages du texte biblique, ou d'autres traditions (haggada, homélies...). (Soit dit en passant que parfois, dans le cas des récits coraniques qui renvoient à des événements propres à la péninsule arabique, il s'agit de se référer à des traditions arabes préislamiques, pour les mêmes raisons : ainsi en est-il du récit de l'installation de Ismaël à la Mecque.) Il est à noter que si le Coran renvoie à des passages de textes bibliques, et s'il s'agit parfois de textes jugés "canoniques" par les autorités religieuses, il s'agit aussi, d'autres fois, de textes qu'elles ont décrétés "apocryphes" : ainsi, l'allusion coranique au tirage au sort par lancer de calame pour désigner à qui devait revenir la garde de Marie encore enfant (Coran 3/44) renvoie à un texte chrétien "apocryphe" (Yussuf Ali) ; l'allusion au miracle de l'oiseau de glaise réalisé par Jésus (3/49, 5/110) renvoie à l'Evangile de l'Enfance (Hamidullah), également "apocryphe"...
Mais parallèlement à tout cela, le Coran se différencie du texte biblique, et ce non pas seulement parce que parfois il contredit formellement certains détails de son récit (comme nous l'avons vu plus haut) mais aussi dans la mesure où les détails bibliques que lui, le Coran, ne contredit ni ne confirme, ne l'engagent pas : dès lors, quand on s'aperçoit, à la suite de recherches scientifiques, que certains de ces détails (comme la période depuis laquelle des humains habitent la terre, l'ampleur du Déluge, le nombre des israélites ayant quitté l'Egypte avec Moïse, la façon dont ils se sont installés en Canaan, etc.) sont erronés, lui n'est pas impliqué.
Tout ceci concerne, rappelons-le, les rapports entre les récits coraniques et bibliques. Car pour ce qui est des croyances et des règles, le musulman ne se réfère qu'au Coran (lire à ce sujet le point 3 de notre article à propos de la Bible).
http://www.maison-islam.com/articles/?p=419

La mort des prophètes dans le Coran
- Le 06/08/2012
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
COMMENT LA MORT DES PROPHETES EST-ELLE DECRITE DANS LE CORAN?
Si on examine les passages coraniques qui évoquent la mort ou l'assassinat des prophètes et qu'on les compare aux versets relatifs à la mort de Jésus, l'on voit apparaître un fait notable concernant cette mort. Dans les lignes qui suivent, nous allons nous pencher sur la signification des termes employés pour évoquer la mort de Jésus et des autres envoyés et étudier la façon dont il sont utilisés dans les versets.
Comme nous le verrons tout à l'heure, Le Coran emploie un certain nombre de termes spécifiques pour relater la mort des prophètes, tels que 'katele' (tuer), 'mate' (mourir), 'haleke' (détruire) et 'salebe' (pendre). Cependant, le Coran affirme clairement qu"'ils ne l'ont pas tué (ma katelehu) ni crucifié (ma salebuhu)", ce qui signifie qu'il n'a été tué en aucune façon. Da,s un autre verset il est dit qu'une personne qui ressemblait à Jésus lui a été substitué et que c'est lui qui a été élevé vers Allah. Nous lisons dans un autre verset:
(Rappelle-toi) quand Allah dit: "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas…
(Sourate al-Imran: 55)
Dans ce qui suit, nous allons voir comment sont employés les différents verbes relatifs à la mort et au fait de reprendre l' qui apparaissent dans la sourate Al 'Imran:
1. TEVEFFA: REPRENDRE L'AME
Le terme traduit par "mort" qui est utilisé dans ce verset admet plusieurs acceptions. L'étude des termes synonymes employés dans ces versets montre que Jésus n'est pas mort, au sens commun du terme. Voici la description qui est faite de sa "mort" dans la sourate al-Ma'ida, 117:
Je ne leur ai dit que ce que Tu m'as ordonné de dire à savoir: "Adorez servilement Allah mon Seigneur et Le vôtre!" Je fus témoin contre eux tant que je fus parmi eux et, lorsque Tu as repris mon âme, Tu fus leur observateur attentif et Tu es de toute chose témoin. (Sourate al-Maidah: 117)
En arabe, le mot traduit dans ce verset par "reprendre l'âme" est "tawaffa", et il vient de la racine "wafa" (accomplir). Tawaffa ne signifie pas "la mort" mais "la prise de l’âme", dans le sommeil ou dans la mort. Nous voyons encore dans le Coran que "la prise de l’âme" ne signifie pas nécessairement la mort. Par exemple, dans un verset où le mot "tawaffa" est employé, il ne s’agit pas de la mort d’un être humain, mais de "la prise de son âme pendant le sommeil":
C'est Lui qui vous reprend votre âme pendant la nuit et qui sait ce qu'ont fait vos membres pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'achève un délai fixé (nommé) à l'avance… (Sourate al-Anam: 60)
Le mot arabe traduit par "prendre" dans ce verset est le même que celui employé dans le verset 55 de la sourate Al-’Imran. Le mot "tawaffa" est utilisé dans le verset ci-dessus. Il est, dès lors, évident que l’on ne meurt pas pendant le sommeil. Il est donc ici toujours question de "la prise de l’âme".
Le même mot est utilisé dans le verset ci-dessous comme suit:
Allah reçoit les âmes au moment de leur mort (mevt) ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil (lem temut). Il retient celles à qui Il a décrété la mort (el mevte), tandis qu'Il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé… (Sourate az-Zumar: 42)
Comme ces versets nous le montrent, Dieu prend l’âme de celui qui est endormi, cependant Il renvoie les âmes de ceux dont la mort n’a pas encore été décrétée. Dans ce contexte, l’homme ne meurt pas au cours de son sommeil dans le sens où nous le comprenons. L’âme quitte le corps et reste dans une autre dimension seulement pendant une période provisoire. Quand nous nous réveillons, l’âme retourne au corps.
Le Professeur Süleyman Ates, de l'Université d'Istanbul, Faculté de Théologie, directeur du Département des Sciences Fondamentales Islamiques et ancien ministre des Affaires religieuses a consacré le développement suivant au mot "tevaffa" dans son commentaire:
Selon ceux qui disent que le terme "tevaffa" est utilisé dans le sens de "sommeil", ce qui est l'acception généralement admise, le verset signifie: "Je te plongerai dans le sommeil". Nous pouvons donc dire que Jésus a été plongé dans un état qui ressemble à la mort et élevé auprès d'Allah et que cet état n'est pas une mort, au sens où nous l'entendons généralement, mais désigne le fait de quitter cette dimension terrestre. (Professeur Süleyman Ates, Une exégèse moderne du Saint Coran, vol. 2, pp. 49- 50) 1
2) KATELE: TUER
Le verbe correspondant à l'idée de "tuer" dans le Coran est 'katele.' C'est dans cette acception qu'il est utilisé dans la sourate Mu'min:
Et Pharaon dit: "Laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur! Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre." (Sourate al-Mu'min: 26)
"Laissez-moi tuer Moïse" traduit 'aktul Musa (Moïse)'. C'est une forme dérivée de 'katele'. On note encore cet emploi dans un autre verset:
…Cela est parce qu'ils… tuaient sans droit les prophètes...
(Sourate al-Baqarah: 61)
"Ils ont tué" traduit 'yaktulune' dans le texte original, qui est une forme conjuguée là encore de 'katele.' La traduction nous montre clairement que ce verbe signifie "tuer".
L'emploi du verbe 'katele" est clair dans les versets suivants, relatifs à la mort des prophètes. Toutes les formes mises entre crochets proviennent de 'katele'.
…Nous enregistrons leur parole, ainsi que leur meurtre (katlehum), sans droit, des prophètes…
(Sourate al-Imran: 181)
…vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres (taktulune). (Sourate al-Baqarah: 87)
…- Dis: "Pourquoi donc avez-vous tué (taktulune) auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants?". (Sourate al-Baqarah: 91)
Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent (yaktulune) sans droit les prophètes et tuent (yaktulune) les gens qui commandent la justice… (Sourate al-Imran: 21)
… Pourquoi donc les avez-vous tués (kateltumuhum), si vous êtes véridiques" ? (Sourate al-Imran: 183)
… Celui-ci dit: "Je te tuerai (Le aktulenneke) sûrement"… (Sourate al-Maidah: 27)
Si tu étends vers moi ta main pour me tuer (taktuleni), moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer (aktuleke)… (Sourate al-Maidah: 28)
Tuez (uktulu) Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays… (Sourate Yusuf: 9)
Et la femme de Pharaon dit: "(Cet enfant) réjouira mon oeil et le tien! Ne le tuez pas (la taktulu)…
(Sourate al-Qasas: 9)
…"Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer (li yaktulu)…
(Sourate al-Qasas: 20)
Son peuple ne fît d'autre réponse que: "tuez-le (uktuluhu) ou brûlez-le"…
(Sourate al-Ankabut: 24)
3) HALEKE: TUER
'Haleke' est un autre verbe qui est employé dans le Coran à plusieurs reprises, avec le sens de "être détruit, mourir". On lit par exemple dans la sourate al-Mu'min:
…lorsqu'il mourut (haleke), vous dites alors: "Allah n'enverra plus jamais de messager après lui"…
(Sourate al-Mu'min: 34)
Dans ce verset, "quand il mourut" traduit l'expression arabe 'iza heleke' prise au sens de "mourir".
4) EL MEVTE: LA MORT
C'est un terme que l'on rencontre souvent dans le récit de la mort des prophètes. 'Mate' est employé avec le sens de mourir dans différents versets, notamment dans la sourate Saba':
Puis, quand Nous décidâmes sa mort (el mevte), il n'y eut pour les avertir de sa mort (mevtihi) que "la bête de terre", qui rongea sa canne…
(Sourate Saba: 14)
Une autre forme de ce verbe est employée au sujet du prophèteYahya:
Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra (yemutu), et le jour où il sera ressuscité vivant!
(Sourate Maryam: 15)
"Quand il mourra" est la traduction de 'yemutu'. Ce même terme apparaît dans le récit de la mort du prophète Yakub, notamment dans la sourate al-Baqarah:
Etiez-vous témoins quand la mort (el mevte) se présenta à Jacob…
(Sourate al-Baqarah: 133)
Le mot el 'mevte' dérive de la même origine et signifie "mort". Dans un verset qui concerne le prophète Muhammad (saas), les verbes 'katele' et 'mate' sont utilisés en meme temps:
Muhammad n'est qu'un messager - des messagers avant lui sont passés - S'il mourait (mate), donc, ou s'il était tué (kutile), retourneriez-vous sur vos talons?... (Sourate al-Imran: 144)
Le mot "mevt" qui a la même racine que "mate" (mourir) apparaît encore dans d'autres versets relatifs à la mort des prophètes:
… elle dit: "Malheur à moi! Que je fusse mort (mittu) avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée!"
(Sourate Maryam: 23)
Et Nous n'avons attribué l'immortalité (el hulde) à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs (mitte), toi, ils seront, eux éternels?
(Sourate al-Anbiya: 34)
…et qui me fera mourir (yumituni), puis me redonnera la vie…
(Sourate as-Shuaraa: 81)
5) HALID: IMMORTEL
"Halid" n'a pas de lien direct avec l'idée de mourir ou de tuer mais il signifie "immortel". C'est l'idée d'exister de façon permanente. Ce terme apparaît dans la sourate Anbiya':
Et Nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels (halidiyne). (Sourate al-Anbiya: 8)
6) SALEBE: CRUCIFIER
Lorsqu'il est question de la mort des prophètes, le Coran emploie parfois le verbe 'salebe' (crucifier). Ses acceptions sont variées, il signifie "pendre", "crucifier" ou "exécuter" selon les contextes. On le retrouve dans les versets suivants::
… ils ne l'ont ni tué ni crucifié (ma salebu)… (Sourate an-Nisa: 157)
… L'un de vous donnera du vin à boire à son maître; quand à l'autre, il sera crucifié (yuslebi)… (Sourate Yusuf: 41)
… qu'ils soient tués, ou crucifiés (yusallebu)… (Sourate al-Maidah: 33)
Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis, je vous crucifierai (usallibennekum) tous. (Sourate al-Araf: 124)
… Je vous ferai sûrement, couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier (usallibennekum)… (Sourate Ta-Ha: 71)
… Je vous couperai, sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierai (usallibennekum) tous. (Sourate as-Shuaraa: 49)
Comme on peut le voir dans ces versets, ce sont des verbes très différents qui sont employés pour décrire la mort de Jésus et celle d'autres prophètes. Dieu a révélé dans le Coran que Jésus n'avait pas été tué, ni crucifié, que quelqu'un d'autre lui avait été substitué et qu'il avait été rappelé par Dieu (en d'autres termes, que son âme lui avait été prise comme lors du sommeil). Tandis que le mot 'teveffa' qui signifie "prendre l'âme" est utilisé au sujet de Jésus, ce sont des expressions telles que 'katele' et 'mate', expressions qui décrivent une mort ordinaire, qui sont employées pour les autres prophètes. Ceci montre bien que la situation de Jésus est particulière. Pour conclure, nous pouvons dire que Jésus (as) a pu être dans un état spécial quand il a été élevé vers Dieu; il n'a pas éprouvé la mort, telle que nous la connaissons. Il s'agissait simplement d'un passage entre les deux mondes. Dieu est plus savant.
http://www.jesusreviendra.com/s1_8.html

Le déluge: comparaison entre les religions monothéistes
- Le 01/08/2012
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions

le mythe du Déluge et de l'arche de Noé, commun aux 3 religions monothéistes, revêt une importance capitale pour les défenseurs des religions.
L'histoire biblique du déluge a beaucoup influencé les travaux des premiers géologues jusqu'à l'avènement des nouvelles théories sur l'âge de la terre et la dérive des continents. Les traces d'organismes marins et de coquillages trouvés en montagne étaient perçus comme autant de résidus du déluge universel... Un déluge ordonné par Dieu qui aurait submergé la terre toute entière, éradiquant toute la faune sauf les couples embarqués par Noé dans son arche. Ce récit propose aussi que les humains actuels seraient tous les descendants des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet.
Dans La Bible
la Bible (Genèse 7:11): « en ce jour-là se fendirent toutes les sources de l’immense abîme d’eau et les écluses des cieux s’ouvrirent.»
"L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et le déluge fut sur la terre 40 jours, et toutes les montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes." (Genèse 7 versets 11, 17 et19)
La Bible affirme explicitement que le déluge du temps de Noé fut universel et que tous les oiseaux, tous les animaux terrestres et tous les humains furent tués, sauf ceux qui se trouvaient dans l'arche.
Le passage de la Bible décrivant le déluge est particulièrement riche en valeurs numériques. Certaines sont relatives aux dimensions de l'arche et aux phases de déroulement du déluge. Au delà de leur sens immédiat, les valeurs numériques peuvent être considérées comme des symboles renfermant un message discret.
Genèse 6/15-16: "Et voici comment tu la feras (l'arche): trois cent coudées seront la longueur de l'arche; cinquante coudées sa largeur et trente coudées sa hauteur…Tu la composeras d'une charpente inférieure, d'une seconde et d'une troisième"
Sur le plan de l'espace le rapport entre la longueur et la hauteur de l'arche est de 10 (300 contre 30 coudées), celui entre la longueur et la largeur est de 6 (300 contre 50 coudées). La hauteur est constituée de 3 niveaux de 10 coudées chacun. À la partie supérieure de l'arche on trouve un "hublot" de 1 coudée de côté.
La répartition 1 + 3 + 6 = 10 est celle des attributs divins dans l'arbre de vie (voir chapitre sur l'Arbre de Vie) . L'arche est non seulement un lieu de survie physique, mais elle annonce un retour spirituel.
Le déluge commence le 17ème jour du 2ème mois de la première année, soit 217 et Noé sort de l'arche le 27ème jour du 2ème mois de l'année suivante, soit 227. La somme des valeurs numériques des deux nombres est respectivement 10, puis 11, 10 signifiant qu'un cycle est accompli, 11 annonçant un nouveau cycle.
Dans le Coran
Sourate Hud.
38. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il dit: 39. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable! »
40. Puis, lorsque Notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner [d'eau], Nous dîmes: « Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. [...]
42. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin de l'arche): « Mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants ».
43. [...] Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés ».
44. Et il fut dit: « Terre, absorbe ton eau! Et toi, ciel, cesse [de pleuvoir]! ». L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi [...]
48. Il fut dit: « Noé, débarque avec Notre sécurité et Nos bénédictions sur toi et sur des communautés [issues] de ceux qui sont avec toi. Et il y (en) aura des communautés auxquelles Nous accorderons une jouissance temporaire; puis un châtiment douloureux venant de Nous les toucheras ».
Bien que le Qour’aane fasse allusion au Déluge qui a eu lieu à l’époque de Nouh (alayhis salâm), il ne précise pas pour autant quel a été l’étendue de la surface touchée. C’est pour cette raison qu’il y a toujours eu des divergences entre les savants musulmans à ce sujet. Une partie des savants pensent que le Déluge a été universel. C’est par ailleurs l’opinion des juifs et des chrétiens. Mais il y a un très grand nombre de savants musulmans qui croient plutôt que le Déluge n’a eu lieu qu’à l’endroit où vivait le peuple de Nouh (alayhis salâm) et non pas sur toute la surface de la terre. Cette seconde opinion apparaît comme étant la plus plausible. J'ajouterai même que le Dr. Kassab, dans son excellent ouvrage "Les mille vérités scientifiques du Qour'aane" affirme également que le Déluge a été régional, et il apporte des arguments probants pour appuyer ses dires.
Le bateau de Noé (sur lui la Paix !). Ses dimensions.
Arche de Noé, espèce de grand navire que Noé construisit, par l'ordre de Dieu, pour s'y retirer avec sa famille et des couples de chaque espèce d'animaux, et à l'abri duquel il devait échapper aux eaux du Déluge. A part son existence et sa destination, tout ce qu'on pourrait dire de cette construction est conjectural. Selon la Bible, l'Arche était en bois de gopher, mot que les Septante traduisent par bois équarri, Jonathas par cèdre, Onkélos par cyprès, St Jérôme par bois goudronné. Moïse donne à l'arche 300 coudées de long; 50 de large, 30 de haut, et les savants sont loin d'être d'accord sur la valeur de ces coudées; si ce sont celles des Égyptiens de son temps, l'Arche aurait eu environ 170 mètres de longueur, 28 de largeur, 17 de hauteur, et sa capacité se serait élevée à plus de 42 000 tonneaux. Moïse attribue au bâtiment trois étages tandis que Philon et Josèphe lui en donnent quatre, et Origène cinq. Ce dernier prétend que l'Arche était de forme pyramidale, et d'autres en font un parallélépipède rectangle. Selon Origène, St Augustin et St Grégoire, Noé employa 100 ans à la construire; selon Salomon Jarchi, 120 ans; selon Bérose, 78; selon Tanchuma, 52; selon les Musulmans, 2 seulement. (B.). (Source : Imago Mundi.).
Fais une arche en bois (Gen. 6:14). Jacob ben Isaac d'écrire notamment : Toldot Itzhak dit : Noé n'a pas récité de prières car il était bon envers les gens mais sa foi en Dieu faisait parfois défaut. Noé pensait que le Saint, béni soit-Il, ne devait pas provoquer le déluge mais seulement faire peur afin qu'ils deviennent pieux.
A cause des eaux du Déluge (Gen. 7:7). Noé monta dans l'arche à cause des flots tumultueux. Noé ne croyait pas que Dieu déclencherait le déluge ; c'est pourquoi, il ne rentra pas dans l'arche avant que l'eau ne l'y oblige. (Le commentaire sur la Torah. Edit. Verdier).
Nous dirons : c'est porter là un jugement sévère et inadmissible sur/envers les prophètes. Mais, d'après les commentateurs, ceci correspond à l'image que le monde de la Synagogue, se fait en général de ses prophètes ! Or, après la foi des anges, la foi des prophètes et messagers divins n'est pas à mettre en doute. Et le Déluge n'est pas ici un jeu. C'est un châtiment envers ceux et celles qui ont mécru en leur divin Créateur, Lui ont donné des Associés, Lui ont désobéi, ont désobéi aux invitations et injonctions du prophète Noé (sur lui la Paix !). Et de ce fait, à lui de faire cette prière à son Seigneur :
« Seigneur ! Ne laisse sur terre pas un habitant d'entre les mécréants !
Pourquoi ?
Si Tu en laisses, en vérité, ils égareront Tes esclaves, et n'engendreront que du libertin, du trop ingrat... » (Coran LXXI 26-7).
Enfin, le divin Créateur du monde biblique n'est-Il pas présenté comme une sorte de divinité dépourvue de toute science, de connaissance réelle de l'invisible, de l'avenir ? A les lire, on fini par croire en la suprématie de l'Homme sur son Créateur ! Encore une vision propre au monde toranique.
La construction du bateau prendra de nombreuses années. On parle de 200 et plus. Entre temps, les gens de l'époque aiguiseront leurs moqueries envers Noé (sur lui la Paix !). Il est vrai qu'il sera le premier homme à construire, sur ordre divin, une pareille embarcation, et son peuple allait découvrir en final le vrai but de sa construction. Se sera une découverte à haut risque. On dit que Noé (sur lui la Paix !) sera assisté par les anges. Il lui sera montré comment construire une telle embarcation. Selon les commentateurs, Noé (sur lui la Paix !) le charpentier fabriquera son bateau en bois de teck. Bois dur, de densité moyenne, imputrescible. Il lui fut commandé de le faire d'une longueur de 80 coudées, d'une largeur de 50 coudées, sur une hauteur de 30 coudées. Selon Quatadah : longueur : 300 coudées, largeur : 50 coudées, hauteur 30 coudées. Selon Hassen : Longueur 1100 coudées, largeur : 600 coudées. C'est ainsi qu'il sera décrit par Ham fils de Noé, lorsque le Messie demanda à son Seigneur la permission de le ressusciter, sur demande express de ses compagnons. L'exégète Baidawi estime que les dimensions de l'arche sont de trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut. Il explique ensuite que le premier des trois étages était destiné aux animaux sauvages et domestiques, tandis que le second accueillait les êtres humains et que le troisième abritait les oiseaux. Pour l'historien Ibn Athîr, le premier abritait Noé et les autres humains, le second les animaux sauvages, et le troisième les oiseaux. Il y a divergences à ce sujet.
Les personnes qui monteront à bord. Leur nombre.
Les exégètes se contredisent sur le nombre des personnes embarquées. Il existe une fourchette entre 7 et 80 personnes. Le chiffre 80 étant le plus retenu. Selon le fils d'Abbas : ils étaient au nombre de 80 hommes dont Djourhoum, et tous étaient enfants de Seth (Chith). Selon Quatadah, ils étaient 80 personnes : Noé et son épouse, ses fils et leurs femmes. Le corps d'Adam sera monté à bord, puis son Seigneur lui commanda d'y faire monter les animaux. Le premier animal à monter à bord sera l'oie, le dernier, accompagné de Satan, l'âne.
Un seul ne montera pas parmi ses proches, son fils Yam (autre nom Canaan), il était mécréant. Quand l'eau se déchaînera faisant des vagues de la taille de montagnes, Noé tentera en vain de convaincre son fils de monter à bord. Mais il déclinera l'invitation. Espérant trouver refuge sur la plus haute des montagnes (Coran XI 42-3). La tristesse de Noé (sur lui la Paix !) sera grande (Coran XI 45-7). Le monde biblique ne reconnaît pas ce quatrième enfant de Noé (sur lui la Paix !). Les textes bibliques ne le mentionnent pas.
Les éléments naturels se déchaînent.
L'Ordre divin : Et lorsque Notre commandement vint, et que le four se mit à lancer des jets [d'eau], (...) (Coran XI 40).
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ
Puis, lorsque Notre commandement vint et que le four se mit à lancer des jets [d'eau], Nous dîmes : Charge [dans l'arche] un couple de chaque espèce ainsi que ta famille - sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé - et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux.
Le déluge était si énorme que la terre toute entière n'avait jamais témoigné d'une telle catastrophe, d'une telle furie. L'eau qui sortira et tombera, sera une partie venant de la terre, l'autre du ciel. Le "four" est ici un signe divin, inconnu du monde biblique. Selon les exégètes, il peut y avoir ici sept interprétations possibles : 1) la surface du sol, les Arabes appellent la surface du sol : le four. La terre se mit à bouillonner de sources. 2) le four à pain. Le four était de pierre, il appartenait à Eve. Puis, parvint à Noé. On lui dit : Si l'eau sort du four à pain, monte à bord toi et tes compagnons. Dieu alors fit sortit l'eau du four à pain. La femme de Noé le sut, et lui dit : O Noé ! L'eau sort du four ! Il dit : Est venu véritablement le rendez-vous de mon Seigneur ! 3) l'endroit, selon Hassen, où l'eau s'est rassemblée autour du navire. 4) Le lever du soleil, la lumière du matin. Parole de Ali (que Dieu l'agrée !) 5) La Mosquée de Koufah. Selon Ali (que Dieu l'agrée !) et Moudjahid. Moudjâhid : le four était dans la direction de Koufah. Noé prit le navire à l'intérieur de la Mosquée de Koufah. Et le four était à droite de l'entrée... Et de lui l'eau sortit, Noé le savait et c'était là une preuve évidente de la destruction de son peuple. 6) la partie élevée du sol, la partie la plus haute. 7) Source dans le Djaizirah (Arabie). On dit : La source est dénommée wardah... Nohas a dit : c'est là les sept paroles, lesquelles ne sont pas contradictoires entre elles puisque Dieu nous a informé que l'eau sortira à la fois du ciel et de la terre. (V. Qortobi).
Autre variante : Par le terme « four » (tannour), la majorité des Savants entende la surface de la terre, c'est-à-dire que de tous les côtés de la terre, l'eau avait jailli, au point qu'elle surgit même des fours qui sont des lieux du feu. Cependant le fils d'Abbas a dit que le four (tannour) est le nom d'une source qui se trouve en Inde ; Chi'bî a dit qu'elle se trouve à Koufa (en Irak) et Qatâdah a soutenu qu'elle se trouve dans la presqu'île arabique. Ali fils d'abou Talîb a dit, quant à lui, qu'il s'agit de l'aurore quand elle se fend et du jour quand il se lève. Ainsi selon lui, Dieu a ordonné à Noé de faire monter les créatures dans l'embarcation dès l'aurore. Avis personnel.
Le Coran met par ailleurs ces paroles dans la bouche de Noé, s'adressant à ses contemporains : « Montez dedans. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah » (Coran XI 41).
Al Baidawi, qui écrit au XIIIe siècle, en déduit que Noé proclama le nom d'Allah pour mettre l'arche en mouvement, et qu'il fit de même pour l'arrêter. Quand l'eau commencera à monter et à tomber, les animaux sauvages se présenteront à Noé (sur lui la Paix !). Ils lui seront soumis, et à lui de les faire monter à bord suivant l'ordre divin. Dieu donna également l'ordre à l'ange Gabriel d'élever la Ka'bah au quatrième ciel du Paradis. Elle était en hyacinthe du Paradis. La pierre noire fut cachée dans le mont Abou Qais de la Mecque. Elle restera ainsi jusqu'à la reconstruction de la Ka'bah par le prophète Abraham et son fils Ismaël (sur eux la Paix !) (Coran II 124-130). Og fils d'Anaq, pour avoir aidé Noé à construire le bateau, fut le seul des géants à avoir, dit-on, pu survivre au Déluge. Noé (sur lui la Paix !) avait besoin de bois de teck pour le bateau, il ne pouvait le transporter. C''est alors que Og le transporta jusqu'au Châm, et pour cela, il fut sauvé des eaux du Déluge.
Version biblique : Reste seulement Noé (Gen. 7:23). Il ne reste que Noé et tous ceux qui se trouvaient sur l'arche. Nos sages disent (Nid. 61a) : Og, roi de Basan, demeura sur une planche près de l'arche sous le toit. Noé creusa un trou dans l'arche et donna à manger à Og ; c'est pourquoi Og jura qu'il ne fera aucun mal à ses enfants. Il est écrit « seulement Noé », ce qui signifie que Noé gémissait car une fois, il tarda à nourrir le lion qui le mordit. Alors Noé se mit à crier (Akh veut dire « seulement » ; c'est également le cri que poussa Noé. (Op. cit.).
Remarques : propos qui n'engage que l'auteur. Voir notre version concernant Og. Lequel ne sera jamais roi. Quand il fut ordonné à Noé de faire entrer les animaux dans le bateau, il dit : ô Seigneur ! Que ferai-je du lion avec la vache ? De la chèvre, du loup, de l'oiseau, du chat ? Il dit : Celui qui a créé entre eux l'inimitié est capable de les rassembler. Il fit tomber la fièvre sur le lion qui l'occupa. Et Dieu est plus Savant !
Durée à bord. Le débarquement.
Noé (sur lui la Paix !) et ses compagnons passèrent seulement quarante jours à bord de l'embarcation, au bout desquels il envoya un corbeau pour les nouvelles, selon les commentateurs. Mais ce dernier s'arrêta pour se repaître d'une charogne, et à Noé d'envoyer alors un autre oiseau, une colombe qui revint avec une branche d'olivier en son bec. Et il vit aussi que ses deux pattes étaient pleine de glaise. Il comprit alors que l'eau s'était retirée. Il fit, dans son invocation, que le corbeau soit prit par la peur. C'est pour cela qu'il ne fréquente pas les maisons. Quand à la colombe parée par cette branche verte en son bec, Noé pria pour elle pour la sécurité. C'est pour cela qu'elle fréquente les maisons. Quand Al Masudi écrit que Dieu ordonna à la terre d'absorber l'eau, et que certains territoires peu prompts à obéir reçurent de l'eau salée en punition, devenant ainsi secs et arides. L'eau qui ne fut pas absorbée forma les mers et les océans, si bien que certaines eaux du Déluge existent encore aujourd'hui. Le fils de Djarîr mentionna que le déluge commença le 13 août du calendrier copte.
Noé (sur lui la Paix !) quitta l'arche le dixième jour du mois lunaire : Mouharram, c'est-à-dire à l'Achoura. Il ordonnera à tous de jeûner en ce jour béni, en remerciement d'avoir été sauvé du déluge. Les rescapés édifièrent une ville au pied du mont Joudi, en direction de Moussoul, qu'ils nommèrent Thamanin (« quatre-vingts ») en raison de leur nombre, et du fait que chacun y bâtira une maison, sa propre maison. Aujourd'hui dénommée : le marché des 80. C'est le premier village à être construit après le déluge. Ces personnes n'eurent pas d'enfants, et la totalité des êtres humains nés après le Déluge descendent des trois fils de Noé. Noé (sur lui la Paix !) ferma alors l'arche et en confia la clé à Sem. Yaqout al-Rumi (1179-1229) mentionne également une mosquée construite par Noé et visible à son époque. Quant à Ibn Battuta, (1304-1377), le grand voyageur marocain, il rapporte avoir franchi le mont Joudi au cours de ses voyages au XIVe siècle. Le monde de l'Islam actuel, bien que peu portés à s'engager dans une recherche active de l'arche, pensent souvent qu'elle existe toujours, sur les escarpements les plus élevés de la montagne.
Version toranique : elle sera quelque peu différente.
Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat (Gen. 8:4), ce qui signifie que le dix-septième jour de Nisan (le septième mois de l'année), l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat.. Le Ramban écrit : Il plut d'abord pendant quarante jours ; à partir de ce moment-là, les eaux s'élevèrent un peu plus chaque jour, jusqu'à atteindre quinze coudées au-dessus du sommet des plus hautes montagnes. Les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent et les eaux continuèrent à se déchaîner pendant cent cinquante jours. Par la suite, le Saint, béni soit-Il, envoya un vent si fort que les sources furent engorgées et que les vannes du ciel par où jaillissaient l'eau s'obstruèrent. L'arche resta enfoncée dans l'eau à une profondeur de plusieurs coudées, jusqu'à Roch Hodech Tamuz (le dixième mois de l'année). On put alors apercevoir la cime des montagnes ; le dixième jour d'Ab (le onzième mois de l'année)), Noé ouvrit les fenêtres de l'arche afin de voir si la terre était asséchée ; trente jours après, Noé ouvrit le toit de l'Arche (Gen.R33.7, PRE 32, R.H. 11b-12a). (Op. cit.).
Remarque : on parle des monts d'Ararat, au pluriel. Ce qui enveloppe ici une chaîne de montagne. Secundo : l'eau vient uniquement du ciel, version biblique et rabbinique. Les dates varient, le monde de la Synagogue bien qu'employant le système lunaire a un système propre à lui.
Il envoya un corbeau (Gen. 8:7). Il lâcha un corbeau pour savoir si les eaux avaient diminué. Le corbeau (Sanh.108b) refusa de sortir. L'oiseau se dit : « Le Saint Nom me déteste ; Il a ordonné qu'on fasse monter dans l'arche sept couples de tous les animaux purs, mais de mon espèce, Dieu a ordonné de ne prendre qu'un couple, moi et une femelle. A présent, Noé, tu veux m'envoyer hors de l'arche ; peut-être vais-je disparaître ; dans ce cas, où trouverez-vous sur terre un oiseau comme moi ? » Le corbeau ajouta : « Tu veux rester avec ma femme, alors tu m'expédies hors de l'arche. » Noé répliqua : « Impie, cela fait un an que je n'ai pas couché avec ma femme car nous étions dans l'arche ; comment peux-tu dire que je désire aller avec ta femme ? » Noé ne voulut pas le laisser revenir dans l'arche ; il dit : « Tu n'es ni bon à être mangé, ni bon pour être offert en sacrifice. » Dieu répliqua : « Fais-le rentrer, il servira pour une autre mission au temps du prophète Elie. » En effet, Elie s'était dissimulé aux yeux du roi Achab ; il n'avait plus rien à manger. Des corbeaux amenèrent de la viande et du pain de la maison du roi jusqu'à l'endroit où il se cachait (c'est-à-dire le palais de Jehochafat, roi de Judée, voir : I R. 22:41-51).
Remarque : Pour un homme censé et avertit, ce récit est une légende. Comment attribuer à Elohîm, à Hachem, de pareils propos ? De même, au prophète Noé sur lui la Paix !) ? En vérité, combien le Saint et Seigneur d'Israël et des mondes est au-dessus ce qu'ils décrivent et Lui associent !
Il lâcha une colombe (Gen. 8:8). Il envoya une colombe. Le Behaye pose une question : Pourquoi, au sujet du corbeau, n'est-il pas écrit « près de lui » ? Cela nous indique que les oiseaux purs demeuraient avec Noé dans sa chambre ; les oiseaux impurs habitaient à part. C'est la raison pour laquelle il n'est pas écrit « près de lui » en ce qui concerne le corbeau.
Une feuille d'olivier arrachée était dans son bec (Gen. 8:11). La colombe revint. Elle portait dans son bec une feuille d'olivier. On peut se demander où la colombe a pris cette feuille puisque tous les arbres du monde étaient arrachés. L'explication est : la pluie ne tomba pas en Terre d'Israël ; seules les eaux provenant d'autres pays y coulèrent. De ce fait, les arbres de la Terre d'Israël ne furent pas déracinés (Zeb. 113a, Gen.R. 36.6). Certains sages disent qu'elle rapporta une feuille du jardin d'Eden. On peut alors se demander comment Noé sut que le niveau des eaux avait baissé. Et la feuille, provenait-elle vraiment du jardin d'Eden qui avait été épargné par le déluge ? Le Ramban écrit : Les portes du jardin d'Eden avaient été fermées afin que les eaux ne pénètrent pas à l'intérieur ; quand les eaux diminuèrent, on ouvrit les portes et la colombe entra ; elle prit une feuille du jardin d'Eden. Elle aurait très bien pu ramener la feuille d'un meilleur arbre, mais elle rapporta celle d'un olivier afin de pouvoir dire à Noé qu'il valait mieux manger une feuille amère venant des mains du Saint, béni soit-Il, qu'une nourriture de mains humaines (Gen.R. 33. 6, Sanh. 108b). (Op. cit.).
Remarques : Sur le récit concernant le corbeau et la colombe, voir notre récit. "près de" ou "loin de", vient uniquement de la prière de Noé envers ces deux oiseaux. Nul rapport ici avec pur et impur. On retrouve toutefois le corbeau mentionné pour indiquer à Caïn (Qâbil) comment enterrer son frère (Coran V 31). Secundo : le commentateur biblique parle d'une feuille d'olivier, nos commentateurs d'une branche d'olivier. Ce qui paraît beaucoup plus logique. Le commentateur voit que la terre d'Israël n'aurait pas été recouverte pas les eaux. Ce qui est faux. De plus, la chaîne de montagne d'Ararat se trouve à combien de km de la terre d'Israël ? Comment une colombe peut-elle faire un pareil parcourt, et tenir en son bec une feuille d'arbre ? Et combien d'heures et de jours a-t-elle voyagée ? Cette feuille provenait-elle du jardin d'Eden ? Que le monde biblique semble situer sur terre : Localisations putatives Quantité d'hypothèses ont été avancées, parfois sans beaucoup (voire aucun) de rapport avec le texte biblique. Si la plupart situent Eden dans le Moyen Orient, près de l'ancienne Mésopotamie, d'autres l'ont "vu" en Ethiopie, à Java, au Sri Lanka, dans les Seychelles, dans le Brabant, voire à Bristol-en-Floride. Quelques théologiens chrétiens pensèrent, comme le jardin d'Eden commençait à être associé au paradis (cf. infra), que le Jardin n'avait jamais eu une existence terrestre propre, qu'il s'agissait d'un "bout de paradis céleste sur terre" au sens littéral. (Wikipédia) Là encore ce n'est que paroles rabbiniques, loin de toute réalité. Enfin l'olivier, et contrairement aux dires rabbiniques, est un arbre béni (Coran XCV 1). Le figuier : Mosquée de Noé (sur lui la Paix !) construite sur le Djoudi. L'olivier : Mosquée de Jérusalem (Temple de Salomon). Quatadah : le figuier est la montagne sur laquelle se trouve la ville de Damas. Et l'olivier est la montagne où se trouve la ville de Jérusalem. On peut faire un serment par ces deux montagnes. Jugé bon parce qu'ils sont deux endroits d'obéissance (à Dieu) (Khâzan). On a dit : le figuier et l'olivier sont deux montagnes de Châm. En syriaque, on dit : Tour zitan et Tour tinan. Ceci parce que ces arbres poussent sur ces montagnes. Enfin, l'olivier c'est l'exemple du prophète Avraham (sur lui la Paix !), dans ce verset : "elle tient sa lumière d'un arbre béni, l'olivier" (Coran XXIV 35). Les paroles des commentateurs sont nombreuses concernant ces deux arbres. S'y référer.
Notons enfin que les Mages, les Dualistes de la Perse antique, ne reconnaissent pas le Déluge. D'autres le reconnaissent, dit-on, mais uniquement pour Babel et ses environs. Mais dans tout cela, seule la parole du divin Créateur est la plus véridique. De Noé, en effet, une descendance sera. Aucune des personnes avec lui aura une descendance. De Noé et de ses fils la terre se repeuplera donc...
Sources:
http://www.le-carrefour-de-lislam.com/Prophetia/diluvium.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge
http://soued.chez.com/arche.htm
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=40

L'eau, symbolisme et religions monothéistes
- Le 26/07/2012
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
Les religions du Livre – judaïsme, christianisme et islam – ont toutes pris naissance dans des zones désertiques, où l’eau reste précieuse, “ don de Dieu ”.
L’eau dans l’ancien Testament apparaît comme “ principe créateur, au travers des nuées, brouillards (…). C’est de l’eau et de la terre qu’est façonné le premier homme. ”
L’épisode du déluge montre ensuite le caractère destructeur et purificateur de l’eau : les hommes qui ne respectent pas la loi divine sont noyés et seul Noé et son Arche survivront aux flots dévastateurs. Le symbole de l’arc en ciel, qui crée l’alliance entre Dieu et les hommes sauvés a ses fondements … sur l’océan.
Il est intéressant de noter que de nombreux travaux ont démontré l’existence d’un tel épisode dans les textes fondateurs des grandes civilisations, comme l’Amérique Latine, l’Egypte ou la civilisation mésopotamienne, où l’on retrouve des éléments de déluge liés à une notion de jugement et de sélection par les flots à la fois dévastateurs et purificateurs. Le déluge reste dans la plupart des cas rattaché à une faute rituelle, issue des péchés des hommes ou de la décrépitude du monde. Le déluge est ainsi la re-création du monde, sa régénération. Citons par exemple les religions australienne, où une grenouille géante absorbe toutes les eaux. Soufrant de la soif, les animaux décident de faire rire la grenouille, qui alors libère les eaux emprisonnés. La Grenouille est une des images mythiques de la Lune, et des marées.
La Parole, tant dans le Deutéronome que dans la Thora et ses 613 Tables de la Loi, est comparée à une pluie bénéfique, chargée de s’infiltrer sur la terre.
Moïse protégé par l’eau
L’eau, élément protecteur des bons et destructeurs des méchants, se retrouve dans l’épisode du passage de la Mer Rouge par Moïse, lui même “ sauvé des eaux ”. Ce dernier se distingue également en faisant surgir une source en tapant sur un rocher avec son bâton : c’est cette eau, symbolisant la Loi, qui sera bue pour fonder la civilisation de Moïse.
L’eau est souvent associée à la femme : puiser, transporter l’eau, laver les pieds par hospitalité sont des tâches quotidiennes souvent retranscrites dans les écrits anciens. Moïse rencontrera sa future épouse, Sephora, près d’un puits.
Dans le cantique des cantiques, la financée, la Terre d’Israël, est désignée comme la fontaine des jardins.
L’eau est également présente sous forme de rosée, et ainsi la Rosée de Pâques symbolise la survie du peuple hébreux, cette renaissance ou résurrection est symbolisée par le jour nouveau et la manifestation bénéfique de l’aube au travers de la rosée.
Il semble que les rites de purification aient été poussés très loin du temps du Christ, peut-être à cause des épidémies de peste. Par exemple, les esséniens pratiquaient un bain de purification avant chaque repas, comme l’indiquent les piscines retrouvées à Qumram.
L’eau et le judaïsme
Les premiers rites
Le rite et les symboles liés à l’eau et la purification sont nombreux dans la religion juive.
L’eau intervient souvent dans le déroulement d’un culte comme vecteur de pureté et de spiritualité. Rappelons en effet que Moïse a dû laver son corps et ses vêtements pour recevoir la Loi divine. L’eau et l’action de se laver instaure donc une limite entre le matériel et l’immatériel, entre l’homme et le divin. On retrouve le symbole de l’eau, lien visible entre le ciel et la terre.
Les rites d’eau sont de trois types : ablution, aspersion ou immersion. Ils restent indissociables d’une purification qui d’abord s’appliquait surtout aux prêtes. Après la destruction du temple, ces sites ont concernés tous les pratiquants, la purification ayant valeur d’aide à reconstruire le temple.
Les rites de purification , consignés dans le Lévitique, sont :
Lavage des mains après avoir lu les textes religieux, de façon à bien dissocier la vie spirituelle de la vie matérielle
Immersion des femmes venant d’accoucher
Lavage des mains avant la prière du matin et avant de bénir chaque repas.
Il existe un rituel de contact entre l’eau et les mains : prendre par 3 fois de l’eau d’un pichet et la faire couler doucement sur chaque main. Ce temps permet là encore de créer “ un sasse ” entre les phases matérielle et spirituelle.
Pour Pâques et Rosh Ashanah, le lavage des mains est instauré. La fête du Soukhot remonte à la tradition du second temple (VIè siècle avant JC) et symbolise les récoltes et vendanges automnales. Elle comprend toujours une prière pour la pluie et une évocation des eaux du ciel (nuages qui entourent le trône de Dieu).
La fête de Shavouot (commémoration de la révélation faite à Moïse) est célébrée au Maroc en particulier en se jetant de l’eau les uns sur les autres pour fêter l’eau qui sauva MoIse.
Le bain rituel se pratique dans le Miqvé. Les textes spécifient qu’ils doivent se faire dans des eaux non dormantes (eaux de pluie, rivières, sources, …). Le bassin d’eau de pluie qu’est le Miqvé représente ce lieu de purification. De taille suffisante pour recevoir plusieurs individus et pour qu’ils s’y immergent, c’est un lieu de culte et un lieu de rencontre où l’on vient se purifier ; comme par exemple pour marquer la fin des périodes menstruelles des femmes. Le miqvé s’est étendu sur le pourtour de la méditerranée et en Europe centrale alors que les termes romaines prenaient également de l’ampleur. Mais la signification reste opposée : les termes romaines sont ders lieux de plaisir et dévolus au corps alors que les miqvés sont parfois le centre de recueillement de la communauté juive, comme on peut encore le voir à Montpellier, Venise ou Cracovie. Originellement constitués pour des pays arides, ils ont souvent évolués, notamment en Europe, vers des bains enterrés, en relation directe avec les nappes phréatiques les plus pures.
L’eau dans le Nouveau Testament
L’ensemble des textes du nouveau testament reprend et prolonge les écrits anciens et en particulier les différents symboles. Les écrits se situent également dans la même zone géographique, où l’eau revêt une importance naturelle et sociale déterminante. Il n’est donc pas étonnant que nous retrouvions l’eau dans symbolique catholique, dans les rites de l’eucharistie et dans la plupart des paraboles.
Par exemple l’eau du puits de la samaritaine : Jésus demande à boire à une étrangère et en échange dit “ qui boira l’eau que je lui donnerai, n’aura plus jamais soif : l’eau que je lui donnerai devient en lui source d’eau jaillissante en vie éternelle ”. L’eau devient conductrice de divinité et de vie éternelle.
Ce symbole est repris abondamment notamment par les grands mystiques comme Ste Thérèse d’Avilla ou St Jean de la Croix : l’atteinte de la perfection divine ressemble à un arrosage et une irrigation de l’âme.
Jésus commence sa vie publique en transformant l’eau en vin, lors des fêtes de cana.
Puis il guérit un paralytique en “ le jetant dans les eaux bouillonnantes ”. Ensuite il marche sur l’eau.
Alors qu’ils subissent une tempête importante et que la barque se remplit d’eau, “ lui, s’étant éveillé, imposa silence aux vents et aux flots, qui s’apaisèrent et il se fit un grand calme ”.
Un symbole souvent difficile à expliquer concerne sa crucifixion : au moment d’expirer, de son flanc sort de l’eau qui se mêle au sang.
L’eau et les religions chrétiennes
Les fêtes chrétiennes reprennent abondamment la symbolique de la purification.
Le baptême reprend la scène décrite par les Evangiles où Jésus s’est fait immergé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, moment où il reçoit la révélation : Dieu le désigne comme son fils et une colombe vient se poser sur son épaule. “ moi, je vous baptise dans l’eau ”, dit Jean “ et lui vous baptisera dans l’Esprit ”. Les baptisés sont immergés partiellement ou aspergés pour devenir “ fils de Dieu ” : St Jean dit “ si quelqu’un ne renaît pas de l’eau et du St Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu ”.
Le sacrement du baptême se retrouve aujourd’hui chez tous les chrétiens, avec une présence plus ou moins forte de l’eau. On retrouve déjà des ablutions d’ordre initiatique dans les temples d’Isis et Mythra. Par différence aux religions plus anciennes, le baptême n’est donné qu’une fois, comme rite d’initiation.
L’immersion des statues de saints semble issue de pratiques héritées de religions antérieures. Les chrétiens continuent à organiser des pèlerinages vers des lieux sacrés liés à l’eau (Saintes Marie de la Mer).
Les Baptistes, qui regroupent des mouvements où la cérémonie du baptême et des ablutions joue un rôle central, pratiquent encore l’immersion complète. Les orthodoxes peuvent avoir des rites très complets d’immersion et d’onction d’huile.
L’utilisation de l’eau dans le rite de la messe est importante : l’eau bénite est utilisée en introduction du sacrement, par aspersion de l’autel (5 croix). L’eau bénite provient de la bénédiction du samedi sain, alors que le saint crème, l’huile bénite est bénie lors de la messe du matin du jeudi saint. Souvent l’eau bénite est mélangée au saint crème.
Après l’offertoire, moment où le prêtre accompagne la transfiguration du pain et du vin (coupé d’eau) et où l’assemblée communie, le prêtre se lave les mains. Un psaume l’accompagne, le psaume 26 “ lavabo (je laverai) ”. Le terme Lavabo vient de cet usage.
L’eau mélangée au vin lors de l’eucharistie représente l’humanité qui se mélange dans le sang du christ. Chez les orthodoxes, l’eau ajoutée est bouillante (la chaleur de la Foi qui a reçu l’Esprit sain).
Comme nous l’avons déjà vu, l’eau (en particulier les sources) revêt une importance capitale au moyen âge. Les sources bénéfiques sont protégées par des saints et y sont attachées des légendes où se mêlent les épisodes religieux et des anciennes coutumes celtes ou druidiques. Les sources miraculeuses sont à elles seules des lieux de culte importants. On ne citera que celui qui rassemble tous les ans au mois d’Août un nombre important de malades croyants ou non : Lourde.
La coutume veut qu’ils soient plongés dans la source qui a jailli du rocher où Bernadette a vu la Vierge. Les pèlerins emportent souvent un peu d’eau miraculeuse avec eux.
L’eau dans le Coran
L’eau occupe une place prépondérante dans l’Islam, non seulement de par sa valeur intrinsèque, pour une civilisation qui s’est surtout développée dans des pays désertiques, mais aussi par la symbolique très précise qu’elle véhicule. En effet l’eau présente dans le désert revêt deux formes ambivalentes : l’eau destructrice des oueds et des orages et l’eau bienfaitrice des jardins luxuriants. Le Coran cite 63 fois le mot “ eau ” - ma’-
C’est grâce à une source “ zam zam ” que la servante d’Israël qui porte son fils est sauvée. Cette source sacrée fait partie intégrante des sites du pèlerinage de La Mecque et le pèlerin doit s’y baigner et en rapporter quelques litres.
Quand Mohamed reçoit la parole, il demande qu’on le couvre d’une cape et qu’on l’asperge d’eau.
La purification
Le coran dit ainsi “ Vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, alors rincez-vous le visage et les mains, jusqu’aux coudes, passez-vous la main sur la tête et sur les pieds jusqu’aux chevilles. Si vous êtes en état d’impureté, alors purifiez-vous ”. La purification, comme pour les autres religions du Livre, revêt donc un aspect fondamental, mais cette fois au quotidien. En effet les musulmans se purifient avant les 5 prières quotidiennes par un rite très précis, touchant et aspergeant toutes les parties du corps dans un ordre très précis, de la tête vers les pieds, en commençant par le côté droit du corps. L’eau utilisée doit elle même être pure et n’avoir eu aucun contact avec des impuretés ou des êtres impurs.
Le pèlerinage de la Mecque
Evènement très important dans la vie d’un musulman, le pèlerinage répond à un trajet très précis, passant en particulier par la source sacrée de zam zam. Les pèlerins doivent se baigner (ou du moins accéder à l’eau et s’asperger) et se recouvrir d’un linge blanc, puis continuer jusqu’à la cité sainte, où les dernières étapes évoquent l’eau à de multiples reprises.
Les lieux d’ablution
La fontaine au centre de la cour de la Mosquée semble provenir de la coutume architecturale romaine du Pluvarium, destiné à recevoir les eaux de pluie et à maintenir une certaine humidité dans les villas. Elle est parfois transformée en puits plus ou moins ouvragé, et sert aux croyants dans le rite de purification.
La piscine rituelle, Midha, a bien sûr comme origine la midva judaïque. Sa forme et sa localisation sont très semblables, mais son usage reste plus rituel et moins communautaire.
Le Hammam est à l’origine un lieu de purification et de recentrage sur soi important. Plus proche du lieu de vie communautaire que la midha, il reste encore aujourd’hui un lieu privilégié de détente et de confidence.
L’eau dans les jardins du Paradis
Les sources d’eau vive et pure sont nombreuses dans le Paradis : elles doivent irriguer et assurer l’existence de jardins magnifiques, traduction d’une parfaite harmonie entre l’homme, la nature et la fin de la lutte contre la désertification. Cette tradition se retrouve dans l’architecture musulmane des jardins (Grenade, Ispahan, Samarkande, Seville), où l’eau joue un rôle prépondérant.
http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2002/jaskulke/article.htm

L'image de la femme entre l'Islam et la tradition Judéo- chrétienne
- Le 19/07/2012
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions

L'image d'une Eve tentatrice dans la Bible a eu pour résultat un impact extrêmement négatif sur les femmes au cours de la tradition judéo-chrétienne. Toutes les femmes sont suspectées d'avoir hérité de leur mère, la biblique Eve, et sa culpabilité et sa malignité. En conséquence, elles étaient toutes moralement inférieures, indignes de confiance, et perverties. Règles, grossesse et accouchement étaient considérés comme les justes punitions de la culpabilité éternelle du sexe féminin maudit.
Pour apprécier combien était négatif l'impact de cette Eve biblique sur toutes ses descendantes féminines, nous devons nous pencher sur quelques écrits des plus célèbres juif et chrétiens de tous les temps. Commençons par l'Ancien Testament en lisant ce qu'on appelle la Sage Littérature:
"26 Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le coeur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. 27 Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison; 28 voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille; mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. " (Ecclésiaste 7:26-28).
Dans une autre partie de la littérature hébraïque disponible dans la Bible catholique, nous lisons:
" La femme a été le principe du péché, et c'est par elle que nous mourons tous. " (25:33, Fi)
" toute malice, plutôt que la malice de la femme ". (25:19, Fi)
" le péché commença avec une femme et à cause d'elle nous devons tous mourir " (Ecclésiastique 25:19,24).
Les rabbins juifs ont établi une liste de neuf malédictions infligées à la femme depuis la Chute d'Adam et Eve:
"A la femme Il donna neuf fléaux et la mort: la peine du sang des règles et de la virginité; le fardeau de la grossesse; la souffrance de l'accouchement; la charge d'élever les enfants; sa tête est couverte comme en deuil; elle se perce les oreilles telle l'esclave à vie, qui sert son maître; elle n'est pas assez crédible comme témoin; et après tout cela: la mort. Au jour d'aujourd'hui, les hommes juifs orthodoxes récitent dans leur prière quotidienne du matin "Béni le Dieu Roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme". La femme, de son côté, remet Dieu chaque matin "de l'avoir faite selon Sa volonté" Une autre prière qu'o trouve dans de nombreux livres de prières juifs: "Loué soit Dieu de ne pas m'avoir créé un Gentil. Loué soit Dieu de ne pas m'avoir créé femme. Loué soit Dieu de ne pas m'avoir créé ignare."
L'Eve biblique a joué un bien plus grand rôle dans le christianisme que dans le judaïsme. Son péché constitue un pivot de la foi chrétienne toute entière car la raison, selon les chrétiens, pour laquelle Jésus Christ serait venu sur Terre découle directement de la désobéissance d'Eve à Dieu. Elle a commis un péché, séduit Adam en le poussant à faire de même. En conséquence, Dieu les expulsa tous deux des Jardins d'Eden sur Terre, maudite par leur cause. Ils léguèrent leur péché, qui n'a pas été pardonné par Dieu, à tous leurs descendants, et partant, tous les êtres humains naissent dans le péché. Pour purifier l'humanité du 'péché originel', Dieu devait sacrifier Jésus, qu'ils estiment le Fils de Dieu, sur la croix. En conséquence, Eve est responsable de sa propre erreur, du péché de son mari, du péché originel de toute l'humanité, et de la mort du Fils de Dieu. Autrement dit, une femme, agissant de son propre chef, a causé la chute de l'humanité . Que dire des filles? Elles sont aussi pécheresses qu'elles et doivent être traitées comme telles. Ecoutez le ton sévère de Saint Paul dans le Nouveau Testament:
"Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression." (I Timothée 2:11-14).
St. Tertullien mâche encore moins ses mots que St Paul, alors qu'il parlait à ses 'bien aimées soeurs' dans la foi, en disait : "Savez vous que vous êtes chacune une Eve? La sentence de Dieu sur votre sexe subsiste aujourd'hui: la culpabilité doit donc exister nécessairement. Vous êtes la porte du Démon: vous avez décacheté l'arbre interdit. Vous avez déserté les premières la loi divine: vous avez persuadé celui que le démon n'a pas été assez courageux pour attaquer de face . Vous avez détruit si facilement l'image de Dieu, l'homme. Par la cause de votre désobéissance, même le Fils de Dieu a dû mourir."
St Augustin fut fidèle à l'héritage de ses prédécesseurs, en écrivant à un ami: "Quelle différence que ce soit une épouse ou une mère? Nous devons toujours prendre garde à l'Eve tentatrice qui subsiste dans chaque femme......je ne vois pas....quelle utilisation peut faire l'homme de la femme, si on exclut la fonction d'élever les enfants."
Des siècles plus tard, St Thomas d'Aquin considérait toujours les femmes comme défectueuse. "En ce qui concerne sa nature individuelle, la femme est défectueuse et mal élevée, car la force active contenue dans la semence male tend à produire une similarité parfaite du sexe masculin. Alors que la production d'une femme vient d'un défaut dans la force active ou d'un manque d'une certaine matière ou même d'une influence externe. Finalement, le renommé réformateur Martin Luther ne pouvait voir aucun profit d'une femme si ce n'est d'amener au monde autant d'enfants que possible, peu importe les effets secondaires: " Si elles se fatiguent ou meurent, cela n'a pas d'importance. Laissez les mourir en couche, c'est ce pourquoi elle sont là "
Encore et encore, toutes les femmes sont dénigrées à cause de l'image d'Eve la tentatrice, grâce au récit de la Genèse.
Pour résumer, la conception judéo-chrétienne de la femme a été empoisonnée par la croyance dans la nature pécheresse d'Eve et de sa progéniture. Si nous tournons notre attention à ce que le Coran dit au sujet de la femme, nous nous apercevons bientôt que la conception islamique de la femme est radicalement différente de la tradition judéo-chrétienne. Laissons le Coran parler de lui-même:
" Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumònes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. ", sourate Al 'Ahzâb (33), verset 35.
" Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. ", sourate At-Tawba (9), verset 71.
" Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): ‹En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. ", sourate Al 'Imrân (3), verset 195.
" Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil; et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. ", sourate Ghâfir (40), verset 40.
" Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. ", sourate An-Nahl (16), verset 97.
Il est clair que le regard coranique porté sur la femme ne diffère en rien de l'homme. Ils sont tous deux, les créatures de Dieu, dont le but sublime est l'adoration de leur Seigneur, dans les bonnes actions, et dans l'éloignement du mal. Et ils seront, tous deux, estimés en conséquence. Le Coran ne mentionne jamais que la femme est la porte du mal ou qu'elle est une trompeuse par nature.
Le Coran ne mentionne jamais non plus que l'homme est à l'image de Dieu; tous les hommes et femmes sont Ses créatures, c'est tout. Selon le Coran, le rôle de la femme sur terre n'est pas limité à l'accouchement. Il lui est nécessaire de faire autant de bonnes actions que n'importe quel autre homme. Le Coran ne dit jamais qu'aucune femme honnête n'a jamais existé. Au contraire, le Coran a chargé tous les croyants, autant les femmes que les hommes, de suivre l'exemple de ces femmes idéales telles que la Vierge Marie et la femme de Pharaon :
" et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit "Seigneur, construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre; et sauve-moi des gens injustes".
De même, Marie, la fille d''Imrân qui avait préservé sa virginité; Nous y insufflâmes alors de Notre Esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres: elle fut parmi les dévoués. ", sourate at-Tahrîm (66), versets 11-12.
Source:
http://www.islamfrance.com/femmeislamvsjudeochretien.html#3








































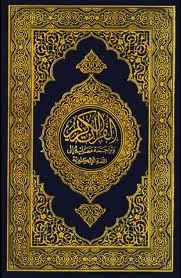
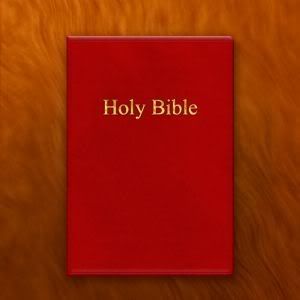
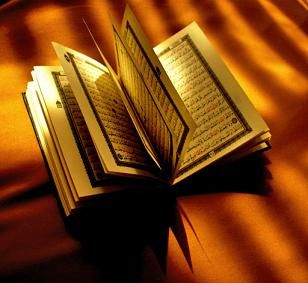
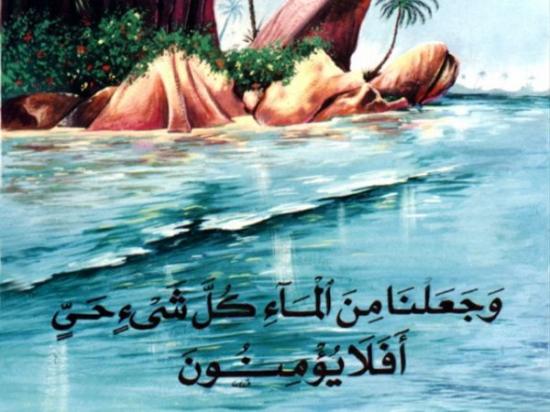
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité