islam
Le sourire et la bonne humeur en Islam
- Le 30/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale

On interrogea un homme :
"Pourquoi souris-tu tout le temps, ris-tu beaucoup, et tu plaisantes souvent ?".
Il répondit :
"Pourquoi ne serais-je pas ainsi alors qu'Allah (qu'Il soit exalté) a dit :
{Dis : "[Ceci provient] de la grâce d'Allah et de Sa miséricorde ; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent"} [Jonas : 58].
Etant donné que nous vivons à chaque instant par la grâce d'Allah et Sa miséricorde, alors nous devons être joyeux et heureux tout le temps.
Le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) n'a-t-il pas dit : (L'affaire du croyant est étonnante, toutes ses affaires sont un bien, et ce n'est pour personne sauf le croyant ; s'il lui arrive quelque chose qui le rend joyeux et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui ; et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui).
Donc, le croyant vit dans le bien quelque soit ce qui lui arrive.
Et à quoi nous serviront la morosité et la tristesse ? Est-ce que cela nous ramènera quelque chose que nous avons perdu ? Est-ce que cela résoudra les problèmes dont nous souffrons ? Ou est-ce que cela nous fera vivre une vie idéale et nous allons nous promener dans des rêves roses qui ne sont présents que dans notre imagination ?!
Par conséquent, celui qui réfléchit avec sa raison ne sera jamais triste pour une chose à propos de laquelle la tristesse ne sert à rien, mais au contraire il réfléchira avec réalisme et positivisme à ce qu'il peut faire, et il ne sera pas entraîné par ses sentiments qui ne le conduisent que vers ce qui assouvit ses désirs et ses besoins temporaires.
Il est difficile que tu ne trouves pas quelque chose qui te rende joyeux, parce que chacun de nous a des bienfaits qu'il est incapable de remercier, alors ne sois pas parmi ceux qui sont distraits de ce qui est présent et recherchent ce qui est absent ; donc, ceux qui sont ainsi, ne seront jamais heureux, parce que quelque soit ce qu'ils prennent ou ce qu'ils possèdent, il y aura toujours quelque chose qui leur manque. Alors, la personne douée d'intelligence est contente de ce qui est présent et elle n'est pas attristée pour ce qu'elle n'a pas.
Et supposons que tu ne vois pas ce qui te rend joyeux, alors pourquoi ne serais-tu pas content de la joie des autres ? Tu purifieras ainsi ton cœur de la rancune et de la jalousie, et tu remplieras ton cœur de l'amour du bien pour les gens ; alors tu auras un cœur sain et une âme pure.
Lorsque tu es content de la joie et du bonheur des autres, tu augmentes les occasions d'être joyeux ; tandis que celui qui n'est content que pour lui-même, sa joie sera limitée.
Et celui qui est triste de la joie des autres, a besoin d'être soigné ; et il lui suffit comme traitement de savoir qu'en faisant cela, il s'est infligé à lui-même d'être toujours triste.
Et notre prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), malgré tous les soucis qu'il avait en appelant les gens à Allah (qu'Il soit exalté), souriait souvent, et plusieurs hadiths ont été rapportés dans lesquels il est mentionné : (Il rit jusqu'à ce ses dents apparurent).
Les malheurs ne sont pas résolus en pleurant sur le passé, en étant pessimistes sur l'avenir, en étant insouciants du présent dans lequel nous vivons, mais au contraire en tirant profit du passé, en étant optimistes et en ayant confiance dans l'avenir brillant, et en travaillant dans le présent et la réalité selon les capacités, en faisant l'équilibre entre l'idéalisme et la réalité, et entre ce qui est obligatoire et ce qui est possible ; donc, nous donnons de l'importance à l'idéalisme et nous ne sommes pas insouciants de la réalité, et nous faisons ce qui est obligatoire selon ce qui est possible de faire.
Et bénédictions et salutations d'Allah sur notre prophète Mohammed, sur les membres de sa famille et ses compagnons".
http://fr.islamtoday.net/node/18856

Actuellement nous vivons les prémices de la victoire de l'Islam
- Le 02/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions

Celui qui suit de près ce qui se passe aujourd’hui en Palestine et dans le monde musulman en général ne peut être convaincu que de l’approche inéluctable de la victoire si Allah, exalté soit-Il, le veut, il y a des preuves et des faits qui étayent ce que j’affirme là, je les ai trouvés par le biais de mes analyses religieuses et historiques.
La Oumma a aujourd’hui un besoin pressant de ces prémices afin qu’elle se tienne droite de manière fière et digne, qu’elle élimine les illusions du désespoir et les susurrements de la frustration, lesquels écueils déchaînent en elle de terribles tempêtes, découragent son esprit de résistance et l’empêchent de travailler sérieusement.
Pour ce qui est des preuves concernant l’approche inéluctable de la victoire prises dans notre législation islamique purifiée elles sont nombreuses et on compte parmi ces dernières ce qui suit :
1- La parole d’Allah, exalté soit-Il : « Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher (la cause d’Allah), Il vous fera triompher et raffermira vos pas » (Coran 47/7). Nous voyons aujourd’hui de nombreux groupes, organisations, Etats ou individus qui font triompher la cause d’Allah, exalté soit-Il, dans la mesure de leurs moyens, ils donnent de leur personne, de leur temps et beaucoup de leur énergie afin d’atteindre la réalisation de cette victoire. Sachez, qu’Allah soit loué, que le cercle de cette victoire ne cesse se s’élargir chaque jour, ce cercle s’étend peu à peu et de manière inexorable à de nouveaux territoires et domaines, notamment dans les secteurs de la politique, de l’information, de l’économie, de l’enseignement, etc., notons que nous développerons plus avant ce sujet avec forces détails et des arguments un peu plus loin. Ainsi, si ces tenants de la victoire pratiquent sincèrement leur religion pour Allah, exalté soit-Il, et s’ils persévèrent dans leurs efforts, alors Allah, exalté soit-Il, leur apportera la victoire, même si cela doit prendre du temps.
2- Allah, exalté soit-Il, dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à Son messager ; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants » (Coran 8/45-46). Nous voyons aujourd’hui de nombreux individus, et notamment en Palestine, pour lesquels s’appliquent ces caractéristiques et situations rappelées dans ces magnifiques versets. Ainsi, ces individus sont des exemples de constance et de fermeté, ils font de leur mieux pour invoquer beaucoup Allah et Lui obéir, pour se conformer à la Sunna de Son prophète ainsi que pour s’unir dans la vérité et la patience, ces musulmans sont dignes de voir descendre sur eux la victoire promise si Allah, exalté soit-Il, le veut.
Si on compare entre ce qui se passe aujourd’hui et le siècle dernier durant lequel les musulmans n’ont fait qu’être soumis et écrasés, alors nous ne pouvons que constater que la victoire s’est approchée un peu plus si Allah, exalté soit-Il, le veut. Contentons-nous de dire en résumé la chose suivante : les ennemis de l’Islam contemporains n’avaient jusqu’à présent pas été confrontés à des combattants de cette qualité, rien ne pouvait dire que les musulmans allaient se réveiller de cette manière, car jusqu’à présent les étendards des armées arabes et musulmanes étaient en berne.
3- Allah, exalté soit-Il, dit : « Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leurs peuples et ils leur apportèrent les preuves. Nous Nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes [de la négation] ; et c’était Notre devoir de secourir les croyants » (Coran 30/47) ; ou encore une autre parole assez proche : « Nous secourons certes Nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente tout comme au jour où les témoins [les Anges gardiens] se dresseront (le Jour du Jugement) » (Coran 40/51). J’affirme qu’il y a aujourd’hui dans la Oumma des combattants croyants et intègres qui méritent d’obtenir une victoire proche si Allah, exalté soit-Il, le veut, je n’annonce pas ici de manière catégorique une chose qu’Allah, exalté soit-Il, a le choix de ne pas faire, qu’Allah m’en préserve, mais je ne fais que souhaiter la venue de bonnes nouvelles en analysant les faits.
4- Le Prophète (![]() ) a dit : « Vous combattrez les Juifs et vous aurez le dessus sur eux au point que les pierres et les arbres diront : ô musulman, ô serviteur d’Allah, il y a derrière moi un Juif, viens donc le tuer ! » (Boukhari). Allah, exalté soit-Il, Seul le sait, mais il semblerait que nous sommes proches de cette période qui paraît être arrivée, car en effet nos frères de Palestine reviennent de plus en plus vers Allah, désormais beaucoup d’entre eux peuvent être qualifiés de « musulman serviteur d’Allah », ces derniers si Allah, exalté soit-Il, le veut, formeront une avant-garde qui ouvrira la voie et montrera l’exemple à la prochaine génération.
) a dit : « Vous combattrez les Juifs et vous aurez le dessus sur eux au point que les pierres et les arbres diront : ô musulman, ô serviteur d’Allah, il y a derrière moi un Juif, viens donc le tuer ! » (Boukhari). Allah, exalté soit-Il, Seul le sait, mais il semblerait que nous sommes proches de cette période qui paraît être arrivée, car en effet nos frères de Palestine reviennent de plus en plus vers Allah, désormais beaucoup d’entre eux peuvent être qualifiés de « musulman serviteur d’Allah », ces derniers si Allah, exalté soit-Il, le veut, formeront une avant-garde qui ouvrira la voie et montrera l’exemple à la prochaine génération.
Quant aux études historiques, elles nous prodiguent des preuves aussi claires qu’un soleil au zénith dans un ciel bleu sur le fait que l’Islam va progresser avec force. A ce propos je me propose de rappeler pour ma part quelques anecdotes que je vais énoncer ici très brièvement, je souligne que tout ce que je vais évoquer ici concerne les quatre derniers siècles de notre histoire seulement et donc la comparaison que je ferais concerne ces quatre derniers siècles. Dans leur histoire, les musulmans n’ont jamais été aussi conscients et lucides sur les complots internationaux, les manipulations et les coups montés les visant qu’à notre époque actuelle. Il est certain que la conscience et la lucidité apparaissent comme des éléments essentiels quand on sait que les ennemis des musulmans ont pu asseoir leur domination sur eux grâce au fait que ces deux éléments ont été longtemps peu répandus voire inexistants chez les musulmans ; ainsi, combien furent nombreux les chefs et dirigeants des musulmans qui, à cause de leur ignorance, menèrent la Oumma vers des catastrophes, les exemples de ces derniers sont nombreux, disons qu’Atatürk ou ‘Abd al-Nâsir sont je crois assez bien représentatifs de ces dirigeants. A cause de chefs inconscients, le monde s’est longtemps moqué du monde musulman, mais aujourd’hui la situation est en train de changer, la Oumma actuelle n’a rien à voir avec celle d’hier, qu’Allah soit loué.
Voici des éléments qui annoncent un changement de situation positif pour les musulmans si Allah le veut :
-On constate une marche forcée pour se débarrasser du prêt à intérêt et des transactions financières non islamiques dans de nombreux pays musulmans ainsi que la fondation de structures bancaires et financières islamiques qui sont aujourd’hui proches de la centaine, notons qu’il y a encore trente ans n’existait aucune société ou banque islamique dans le monde, il est à ce propos très révélateur que la presse nassérienne haineuse dénigra le docteur ‘Îsâ ‘Abuh, qu’Allah lui fasse miséricorde, lorsque celui-ci voulut fonder une banque sur des bases islamiques. Cette évolution positive dans le domaine des transactions financières islamiques nous rapprochent de l’exécution d’un ordre d’Allah, exalté soit-Il : « Ô les croyants ! Craignez Allah et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants » (Coran 2/278) et nous éloignent de : « Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés » (Coran 2/279).
-On observe une augmentation de la pratique religieuse et du respect des préceptes de l’Islam au sein des armées arabes et islamiques, et ce, tant chez les officiers que chez les hommes de rangs. Si nous analysons la situation des armées arabes de ce point de vue là sur les quarante dernières années, nous constatons que l’écrasante majorité des officiers et des simples soldats ne pratiquaient ni la prière ni le jeûne, en outre il nous faut dire que la pratique des péchés majeurs était très répandue parmi eux ; par conséquent, les améliorations que nous observons dans ce domaine dans ces armées est la meilleure preuve que la victoire est très proche.
-On constate également une augmentation de la pratique de l’Islam chez les femmes, et ce, bien que les ennemis de notre religion ont essayé sans cesse, et essaient toujours, de corrompre la femme musulmane, ils ont d’ailleurs réussi en partie, car en effet on observe que pendant longtemps il était rare d’apercevoir des hijabs dans la plupart des capitales arabes et islamiques. L’objectif de cette propagande tendant à faire enlever le hijab aux femmes musulmanes était de « sauver » ces dernières du prétendu joug imposé sur elles par la Charia, cette situation ne commença à changer qu’il y a une trentaine d’années, et donc aujourd’hui, louanges à Allah, la situation est en train de s’inverser dans la plupart des capitales arabes et islamiques où on peut observer une présence de plus en plus nombreuse de femmes en hijab. A ce sujet, un professeur éminent qui est aussi un poète renommé m’a raconté que dans un grand pays arabe durant les années 60 il chercha une femme acceptant de mettre une écharpe sur la tête afin de la prendre pour épouse, il peina beaucoup avant de pouvoir trouver la perle rare !
Cependant, il nous faut saluer le fait que la femme musulmane d’aujourd’hui ne se contente pas de mettre le hijab, mais elle a décidé d’investir le champ du djihad politique, médiatique, économique ou encore social ; cette femme est en train de former une excellente génération de filles et de garçons. Par exemple, cette année des femmes palestiniennes ont directement participé à des combats que seuls les hommes courageux et les héros peuvent mener.
Ainsi, cette évolution positive que connaît la femme musulmane aujourd’hui est la meilleure preuve que les tentatives ennemies qui, durant ces deux derniers siècles, visèrent à occidentaliser cette dernière ont totalement échoué, louanges à Allah.
-On observe en outre une diffusion significative de la culture islamique authentique et consciente, de nombreux livres traitant de sa grandeur et de sa beauté et des concepts islamiques authentiques qui en découlent. Tout ce mouvement positif n’a vraiment commencé que depuis à peine une soixantaine d’années ; les débuts furent donc évidement modestes, puis peu à peu la diffusion a gagné en force et s’est élargie au point que les foires aux livres ne se maintiennent que grâce à la vente de livres islamiques.
-C’est un fait, les médias et moyens de communication ont connu ces dernières années un développement extraordinaire, par conséquent les médias islamiques ont profité de ces progrès et ils ont de nombreuses chaînes satellitaires qui diffusent d’innombrables programmes consacrés à l’Islam, c’est là une bonne évolution au regard de ce qu’était la situation de l’Islam dans les médias il y a trente ou même vingt ans. Ce sont des moyens d’accès au message et à la science islamiques pour des femmes, des hommes, des jeunes et même des enfants, il est à noter que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer cette évolution positive il y a encore quelques décennies. Par ailleurs, nous voyons qu’aujourd’hui se développent des structures islamiques médiatiques par centaines sur tous les continents, c’est là un immense bienfait.
-Enfin, il nous semble que la preuve incontestable et irréfutable la plus évidente du relèvement de l’Islam est l’émergence de la Sahwa (éveil) islamique qui eut lieu à partir des années 70 du siècle dernier, laquelle Sahwa fut dure à digérer pour les ennemis de l’Islam, elle fut pour eux une affliction et une écharde dans leur pied, Allah, exalté soit-Il, leur envoya cette dernière qui les surprit totalement, c’est ainsi que la religion se retrouva avec une armée forte de millions de jeunes hommes et femmes intègres et purifiés. Il faut se rappeler que ces jeunes exaltés n’étaient pas plus de quelques milliers dans tout le monde musulman à l’époque de l’obscurité qui recouvrit notre civilisation pendant près de quatre siècles. Et c’est ainsi que de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes n’ont désormais plus dans la bouche que le mot « Islam », ils s’accrochent de toutes leurs forces à « la corde d’Allah ». Tous ces jeunes sont les tenants de la victoire à venir si Allah, exalté soit-Il, le veut, ils symbolisent en outre le soleil de la Oumma, ses lendemains souriants et sa lumière éclatante. Si leur nombre augmente encore à un niveau défini par Allah, exalté soit-Il, alors il n’y aurait aucune force sur terre capable de leur résister, et demain approche à grand pas. Ce qui est le plus étonnant est que la plupart de ces jeunes travaillent dans les secteurs des nouvelles technologies, de l’économie, du social ou de l’éducation, c’est-à-dire dans des secteurs que les ennemis de l’Islam ont longtemps tenté d’occidentaliser ou tout simplement de saboter.
Nos frères plus âgés nous racontent que lors de la prière du tahadjud dans l’enceinte de la Mosquée sacrée à La Mecque en 1963 il n’y avait que quatre rangs de fidèles et l’imam lisait sans micro mais ils pouvaient néanmoins l’entendre du fait qu’ils étaient si peu nombreux ! De plus, à l’époque la plupart des mosquées n’étaient fréquentées que par des personnes âgées. Mais les choses ont aujourd’hui bien changé, car en effet les gens peuvent être des millions à accomplir du tahadjud durant le mois du Ramadan, et les nombreuses mosquées existant à travers tout le monde islamique sont pleines de dizaines de millions de jeunes hommes intègres et de jeunes femmes vertueuses. Notons que les grands oulémas du monde islamique se plaignaient dans les années 50 et 60 du fait que les jeunes gens ne suivaient pas leurs cours, mais au cours du temps ces savants virent changer cette situation très positivement, ce retour des jeunes musulmans vers les détenteurs du savoir n’est-il donc pas très significatif ?
En fait cet ardent désir de millions de jeunes hommes et femmes de faire quelque chose afin de sortir la Oumma de sa situation d’abaissement et de soumission et de faire qu’elle retrouve sa position de civilisation dominante. C’est indubitablement ce mouvement qui dérange les ennemis de l’Islam et leur fait terriblement peur, il fait trembler les fondements d’un système qu’ils n’ont cessé de vouloir consolider et par lesquels ils ont essayé de détourner les jeunes musulmans d’un travail sérieux pour les mener dans le chemin des divergences profondes et incessantes, de la réclusion dans les mosquées et autres lieux éloignés des choses du monde, du gâchage de leur potentiel et de la pratique des vices ou encore tous simplement des graves et grands péchés. Mais il se trouve qu’aujourd’hui de nombreux jeunes gens, hommes et femmes, savent parfaitement quelle route à suivre est la meilleure pour eux, ils se conforment de plus en plus aux préceptes de l’Islam et dans leur ensemble ils font tout ce qui est en leur pouvoir afin de faire vaincre l’Islam et les causes qui lui sont liées. Celui qui observe le phénomène des manifestations massives qui ont lieu dans de nombreux pays du monde musulman ou bien l’expansion phénoménale des chaînes satellitaires, des sites internet et réseaux sociaux islamiques, lesquels moyens de communication traitent avec une grande réactivité d’un nombre impressionnant de causes intéressant les musulmans, alors il comprendra de manière évidente qu’aujourd’hui n’est pas comme hier, que la Oumma a bel et bien changé et que de nombreux signes de changement sérieux ont commencé à apparaître grâce aux actions des jeunes musulmans intègres.
En guise de conclusion, ô chers frères et sœurs, nous voulons vous dire qu’il n’y a rien qui effraie plus les ennemis de l’Islam que notre confiance optimiste dans l’arrivée prochaine de la victoire puis le fait que nous y travaillions, et à contrario, rien ne les satisfait plus que lorsqu’ils nous voient affligés et pleins de pessimisme quant à cette victoire. Par Allah, nous vivons des jours extrêmement difficiles, ce qui fonctionne en ces jours n’est pas ce qui fonctionne dans des périodes tranquilles, demandez donc à Allah, exalté soit-Il, la victoire, la volonté d’y parvenir et l’accomplissement d’actions œuvrant dans ce sens, alors Allah, exalté soit-Il, nous permettra-t-Il que nous soyons les artisans de la victoire de l’Islam et des musulmans, car Seul Lui peut nous la donner.
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=202909&fromPart=49

Nous sommes protégés par les anges
- Le 08/10/2015
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale
Les musulmans croient que les anges jouent un rôle important dans la vie des êtres humains. Cela commence peu de temps après la conception et se poursuit jusqu'à la mort. Les anges et les êtres humains interagissent même dans l'au-delà. Des anges font entrer des gens au Paradis et d'autres gardent les portes de l'Enfer. La croyance aux anges est l'une des croyances fondamentales de l'islam.
Selon certains hadiths du prophète Mohammed, quelques mois après la conception, l'âme est insufflée dans le fœtus, par la permission de Dieu. Un ange écrit alors les réponses à quatre questions dans le livre des actions de cette personne. Est-ce que ce sera un homme ou une femme? Cette personne sera-t-elle heureuse ou malheureuse? Combien de temps vivra-t-elle? Et fera-t-elle surtout de bonnes ou de mauvaises actions?[1]
D'autres anges ont la responsabilité de protéger des gens tout au long de leur vie.
« Devant et derrière chaque personne se trouvent des anges qui se relaient et qui veillent sur elle, par ordre de Dieu. » (Coran 13:10)
À chaque personne sont attribués deux anges qui mettent par écrit leurs actions, bonnes et mauvaises.
« Il vous envoie des gardiens, et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers prennent son âme sans aucune négligence. » (Coran 6:61)
« Ou s'imaginent-ils que Nous ne pouvons entendre leurs pensées secrètes ni leurs conseils privés? Mais si! Nos envoyés, postés près d'eux, transcrivent tout. » (Coran 43:80)
« ...quand les deux (anges), assis à sa droite et à sa gauche, recueillent [ses moindres paroles et actions]. Il ne prononce pas une parole qu'un observateur installé près de lui ne soit prêt à inscrire. » (Coran 50:17-18)
« Certes, des gardiens veillent sur vous, de nobles scribes qui savent (tout) ce que vous faites. » (Coran 82:10-11)
Les anges transcrivent tout, de manière honorable, sans jamais faillir à leur tâche. Chaque parole, sans exception, est retranscrite. Mais comme toujours, Dieu demeure miséricordieux. Le prophète Mohammed a expliqué que Dieu a établit des règles sur la retranscription des bonnes et des mauvaises actions : « Quiconque avait l'intention de faire une bonne action, mais n'a pas pu la faire, une bonne action est tout de même inscrite à son compte. S'il accomplit la bonne action, elle est inscrite comme dix bonnes actions et, selon la volonté de Dieu, elle peut être multipliée jusqu'à sept cent fois ou plus. Quiconque avait l'intention de faire une mauvaise action, puis a décidé de ne pas la faire, elle lui est inscrite comme une bonne action. Mais s'il avait l'intention de la faire et qu'il la réalise, elle lui est inscrite comme une seule mauvaise action. »[2]
L'érudit musulman Ibn Kathir a ainsi commenté les versets 10 et 11 de la sourate 13 du Coran : « Il y a, aux côtés de chaque personne, des anges qui se relaient pour veiller sur elle jour et nuit, qui la protègent du mal et des accidents. Et il y a d'autres anges qui se relaient jour et nuit pour retranscrire ses actions, les bonnes comme les mauvaises. »
« Deux anges, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, mettent ses actions par écrit. Celui à droite écrit ses bonnes actions, tandis que celui à gauche écrit ses mauvaises actions. Deux autres anges veillent sur lui et le protègent, l'un derrière et l'autre, devant. Il y a donc quatre anges, à ses côtés, jour et nuit. »
À part ces quatre anges, d'autres anges visitent régulièrement les êtres humains, ce que rappelle Mohammed, à ses fidèles, dans un hadith : « Les anges vous rendent visite les uns après les autres, de jour comme de nuit, et ils se croisent tous au moment des prières du fajr (à l'aube) et de l'asr (l'après-midi). Ceux qui ont passé la nuit avec vous remontent au ciel et Dieu leur demande (bien qu'Il sache déjà la réponse) : « Dans quel état étaient Mes serviteurs lorsque vous les avez quittés? » Et les anges répondent : « Lorsque nous les avons quittés, ils priaient et quand nous sommes arrivés près d'eux, ils priaient également. »[3] Ils se rassemblent pour assister aux prières et écouter la récitation des versets du Coran.
Il est donc clair que les anges sont très impliqués dans la vie quotidienne des êtres humains et cette implication ne prend pas fin au moment où l'ange de la mort vient chercher l'âme d'une personne et après que d'autres anges l'aient interrogée dans sa tombe. Car des anges gardent le Paradis :
« Et ceux qui auront craint leur Seigneur et observé leurs devoirs envers leur Lui seront conduits par groupes au Paradis. Et quand ils y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront : « Paix sur vous! Vous avez été bons : entrez donc (dans le Jardin des Délices), pour y demeurer éternellement. » (Coran 39:73)
« De chaque porte, les anges afflueront vers eux (en leur disant) : « Paix sur vous, car vous avez persévéré. Comme est excellente votre demeure finale! » (Coran13:23)
Et des anges gardent également l'Enfer :
« Et qui te dira ce qu'est Saqar ? Il ne laisse rien et n'épargne rien ; il brûle la peau et la noircit. Ils sont dix-neuf [anges] (à veiller dessus). Nous n'avons assigné que des anges pour être gardiens du Feu et Nous n'en avons précisé le nombre que pour éprouver les mécréants, pour que les gens du Livre soient convaincus, et pour renforcer la foi des croyants. » (Coran74:27-31)
Dieu a créé les anges à partir de lumière. Ils sont incapables de désobéir à Dieu et ils obéissent à Ses ordres sans jamais hésiter ni broncher. Les anges adorent Dieu. Ces nobles créatures jouent un rôle important dans la vie des êtres humains. Ils veillent sur eux et les protègent, mettent par écrit leurs actions et les rapportent à Dieu, et tiennent compagnie aux êtres humains qui invoquent Dieu.
Footnotes:[1] Sahih Al-Boukhari
[2] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim
[3] Ibid.
http://www.islamreligion.com/fr/articles/2807/

Comment juger le fait d'anesthésier un agonisant?
- Le 10/09/2015
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et la vie sociale
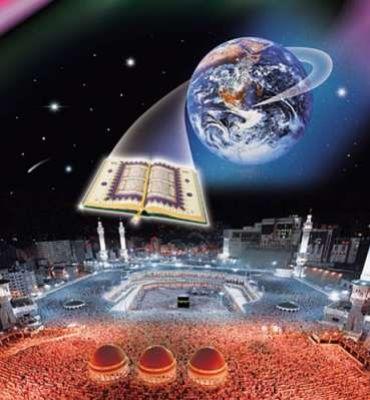
La mort fait partie des accidents qui arrivent à l'homme. Elle consiste dans le retrait de son âme et dans son déplacement de l'enveloppe physique présente et terrestre vers le vaste monde de l'au-delà. C'est l'instant où l'âme se sépare du corps et cesse de l'animer.
On lit dans at-Tabaqaat d'Ibn Saad (4/260) et dans al-Moustadrak d'al-Hakim (5915): Awaana ibn al-Hakam dit: Amer ibn al-As disait: il est étonnant que le mourant qui reste lucide ne puisse décrire la mort. A sa propre mort, son fils, Abdoullah ibn Amer lui dit: père, tu disait qu'il était étonnant que le mourant qui reste lucide ne puisse pas décrire la mort. Alors, puisque tu es lucide, décris nous la mort. Il dit: fiston, la mort est trop grave pour être décrite correctement mais je vais en esquisser une description: je me sens comme si la montagne Radwaa m'écrasait le coup. Je me sens comme si les épines de silaa me déchiraient le ventre et je me sens comme si mon âme passait à travers le trou d'une aiguille!!»
A cette grande étape de l'existence humaine, les différentes sortes de traitement et de calmants deviennent peu utiles. La mort est un processus mystérieux au cours duquel l'âme prend congé du corps. L'anesthésiant ou calment ne fait qu'atténuer la souffrance physique du mourant. Ces moyens matériels relèvent du monde sensible tandis que la mort relève du monde mystérieux qui n'est pas régi par les moyens matériels et ne peut faire l'objet d'expérimentation ni de traitement.
Cela étant, il nous semble qu'il faut éviter l'usage de l'anesthésie sur un agonisant pour les raisons que voici:
La première est qu'en principe l'usage de l'anesthésie est interdit sauf en cas de besoin ou de nécessité. Or, il n'y a pas de besoin dans le cas en question. Il a déjà été confirmé que l'anesthésie ne supprime pas les douleurs qui accompagnent l'extraction de l'âme du corps. Bien plus, il n'y a aucun rapport entre cette instance mystérieuse et les conditions de vie des gens, les causes et les expériences qui les accompagnent. Dès lors, l'usage de l'anesthésie revient à commettre l'appréhensible en l'absence d'une raison et une justification religieuses qui nous permettent de savoir ou de croire fortement que cela est utile et qu'on en a besoin dans une telle circonstance. Voir la réponse donnée à la question n° 46050.
La deuxième est que personne ne peut affirmer résolument le moment précis de l'arrivée de la mort. Or, l'anesthésie a des effets nocifs multiples sur le corps. Pire, les médecins disent que c'est un poison spécial. Il n'est donc pas acceptable de provoquer une nuisance certaine dans le but d'éviter une autre potentielle pour traiter une affaire dont nous ne connaissons pas la réalité et à propos de laquelle nous n'avons aucune expérience et ne savons pas si l'usage de l'anesthésiant est efficace.
Quand l'intéressé est un fidèle serviteur pieux qui termine sa vie dans l'obéissance envers Allah marquée par l'observance du culte et quand nous constatons qu'il s'est résolument oriente vers Allah Très-haut et que sa langue ne cesse de Le mentionner, nous pouvons nous attendre qu'un tel fidèle serviteur prononce ( à l'ultime instance de sa vie) l'attestation qui lui sert de viatique auprès de son Maître. Or, l'anesthésie le prive de cette vertu.
D'après Mouadh ibn Djabal (P.A.a) le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Celui dont l'ultime parole avant la mort est : il n'a pas de dieu en dehors d'Allah entrera au paradis.» (Rapporté par Abou Dawoud (3116). Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: cela signifie qu'il y entrera sans avoir subi aucun châtiment de quelque manière que ce soit. Nous avons choisi cette interprétation car tout musulman entrera nécessairement au paradis, fût-ce après avoir subi un châtiment. L'information selon laquelle celui dont l'ultime parole est : il n' y a pas de dieu en dehors d'Allah entrera au paradis serait inutile si elle ne comportait pas un facteur spécifiant. Ce facteur réside en ceci: ou bien l'auteur de cette ultime parole entre au paradis avec les premiers rescapés qui y seront admis sans avoir subi un châtiment ou bien alors Allah le Transcendant lui atténuera sa part du châtiment en le faisant entrer au paradis avant le moment qu'il y serait admis s'il n'avait pas prononcé la dite parole.» Extrait de az-zawaadjir (2/333).
Allah le sait mieux.
http://islamqa.info/fr/208491
L'Islam et ses débuts
- Le 02/07/2015
- Commentaires (0)
- Dans Histoire de L'Islam




Vers l’an 570, celui qu’on allait nommer Mohammed et qui allait devenir le prophète d’une des grandes religions du monde, l’islam, vit le jour dans une famille appartenant au clan de Qouraysh, la principale tribu de la Mecque, ville de la région du Hijaz, située dans le nord-ouest de l’Arabie.
D’abord connue comme le lieu abritant la Ka’aba, lieu de pèlerinage d’origine ancienne, la Mecque était devenue, avec le déclin de l’Arabie du Sud, au sixième siècle, un important centre d’échanges commerciaux auxquels participaient des puissances telles que les Sassaniens, les Byzantins et les Éthiopiens. C’est pourquoi elle était dominée par de puissantes familles marchandes, parmi lesquelles se démarquaient les membres de Qouraysh.
Le père de Mohammed, Abdallah ibn Abd al-Mouttalib, mourut avant sa naissance. Sa mère, Aminah, mourut à son tour lorsqu’il avait six ans. Il fut confié à son grand-père, qui était chef du clan Hashim. Après la mort de ce dernier, il fut élevé par son oncle, Abou Talib. Comme c’était la coutume à l’époque, lorsqu’il était encore enfant (et du vivant de sa mère), on l’envoya vivre avec une famille de bédouins, hors de la ville, durant un an ou deux. Cela eut un impact important sur la vie de Mohammed. En plus d’endurer la vie rude du désert, il apprit à apprécier la richesse de la langue arabe, tant aimée des gens de l’Arabie, chez qui la poésie était l’art dont ils tiraient la plus grande fierté. Il apprit la patience et la tolérance des gardiens de troupeaux; il s’habitua également à leur vie solitaire, ce qui allait lui faire apprécier la solitude, plus tard dans sa vie.
Dans la vingtaine, Mohammed entra au service d’une riche veuve qui s’appelait Khadijah; il allait vendre ses marchandises dans le Nord, à l’issue de longs voyages en caravane. Il finit par l’épouser et eut d’elle deux fils dont aucun ne survécut, puis quatre filles.
Un jour, alors qu’il avait quarante ans, il se trouvait dans une grotte sise dans une fissure du mont Hira, à l’extérieur de la Mecque. Il avait l’habitude de s’y retirer de façon régulière pour méditer et profiter de la solitude. Ce jour-là, il entendit une voix (celle de l’ange Gabriel, mais il l’ignorait alors) qui lui ordonna :
« Lis : au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme (à partir) d’un caillot (de sang). » (Coran 96:1-2)
Mohammed répéta à trois reprises qu’il ne savait pas lire, mais chaque fois, il entendit l’ordre de nouveau. Enfin, il finit par répéter les mots que la voix lui avait récités, mots qui composent les cinq premiers versets de la sourate 96 du Coran, mots qui déclarent que Dieu est le Créateur de l’homme et la source du savoir.
Mohammed s’enfuit de la grotte à toutes jambes et alla se réfugier chez lui. Il ne fit part de son expérience qu’à son épouse et à ses proches. Mais au fur et à mesure que lui parvinrent d’autres révélations lui ordonnant de proclamer l’unicité de Dieu, il se mit à prêcher un peu plus ouvertement, attirant chaque jour de nouveaux fidèles. Les premiers étaient surtout des pauvres et des esclaves qui avaient reconnu la vérité dans son message, puis, avec le temps, des nobles de la Mecque se convertirent à leur tour. Les révélations qu’il reçut à cette époque et celles qu’il reçut plus tard ont toutes été colligées sous forme de livre, pour former le Coran.
Le message de Dieu, transmis par Mohammed, ne fut bien reçu que d’un petit groupe de personnes. Même dans son propre clan, plusieurs s’y opposèrent activement, dont un nombre important de marchands. Cette opposition, toutefois, ne fit qu’encourager Mohammed dans sa mission et lui montra clairement de quelle façon l’islam se démarquait du paganisme. La croyance en l’unicité de Dieu était d’une importance capitale et c’était d’elle que découlait tout le reste. Les versets du Coran insistent beaucoup sur l’unicité de Dieu, mettent en garde ceux qui la rejettent contre un châtiment imminent et proclament Son infinie compassion envers ceux qui se soumettent à Sa volonté. Ils rappellent également le Jugement dernier quand Dieu, le Juge, mettra dans la balance la foi et les actions de chaque personne, rétribuant les croyants et châtiant les transgresseurs. Parce que le Coran rejetait avec véhémence le polythéisme et mettait l’accent sur la responsabilité morale de chaque personne et ce, en termes puissants, il posait un sérieux défi aux Mecquois.
Après que Mohammed eût prêché publiquement durant plus d’une décennie, l’opposition envers lui et ses fidèles atteignit une force telle que, craignant pour leur sécurité, il envoya un groupe d’entre eux en Éthiopie, où le dirigeant chrétien leur offrit sa protection (les musulmans apprécièrent tant ce geste qu’ils en caressent le souvenir aujourd’hui encore). À la Mecque, pendant ce temps, la persécution atteignait un sommet. Les fidèles de Mohammed étaient victimes de harcèlement, d’abus de toutes sortes et même de torture. C’est alors que Mohammed envoya soixante-dix de ses fidèles à Yathrib (plus tard renommée Médine), une ville située au nord, dans l’espoir d’y établir une nouvelle communauté musulmane. Plusieurs autres groupes de musulmans émigrèrent à la suite de ce premier groupe. Puis, en l’an 622, Mohammed et son ami intime, Abou Bakr al-Siddiq, partirent à leur tour vers Yathrib. Ce départ coïncidait avec un complot ourdi par les dirigeants de la Mecque pour assassiner Mohammed.
D’ailleurs, peu après le départ de Mohammed, ses ennemis firent irruption chez lui, où ils trouvèrent son cousin ‘Ali couché à sa place, dans son lit. Enragés, ils partirent à sa poursuite, le cherchant partout. Mohammed et Abou Bakr, de leur côté, avaient trouvé refuge dans une grotte, à l’abri de leurs poursuivants. Protégés par Dieu, ils ne furent jamais découverts par leurs ennemis qui passèrent pourtant tout près de leur cachette. Puis, le moment venu, ils quittèrent la grotte et partirent en direction de Médine où ils furent joyeusement accueillis par une foule enthousiaste composée de locaux et d’émigrants mecquois qui avaient atteint Médine avant eux.
Telle fut la hijrah (hégire, en français), qui marqua la première année de l’ère islamique. La hijrah, parfois définie à tort comme une fuite, fut en réalité une migration minutieusement planifiée qui marqua non seulement le début de l’ère islamique, mais aussi, pour Mohammed et ses fidèles, le début d’un nouveau mode de vie. Dès lors, ce qui allait unir les gens en communauté ne serait plus simplement le lien de parenté, mais une grande fraternité entre tous les musulmans. Les gens qui émigrèrent à Médine avec Mohammed furent appelés les Mouhajirounes (i.e. « ceux ayant accompli la hijrah », ou « émigrants »), tandis que les natifs de Médine convertis à l’islam furent appelés les Ansars (i.e. « alliés » ou « auxiliaires »).
Mohammed connaissait bien la situation de Médine. Avant la hijrah, certains de ses habitants étaient venus accomplir le pèlerinage annuel à la Mecque. Et comme le Prophète avait saisi l’occasion du pèlerinage pour prêcher l’islam aux pèlerins, le groupe qui était venu de Médine avait répondu à son invitation et accepté l’islam, puis l’avait invité, lui, à venir s’installer à Médine. Après la hijrah, les qualités exceptionnelles de Mohammed impressionnèrent tant les Médinois que les tribus rivales et leurs alliés serrèrent les rangs temporairement. Puis, au mois de mars de l’an 624, Mohammed et ses fidèles durent se battre contre les païens de la Mecque.
La première bataille, qui eut lieu près de Badr, une petite ville située au sud-ouest de Médine, eut d’importantes conséquences pour tous. L’armée musulmane, trois fois moins importante que l’armée mecquoise, parvint à mettre cette dernière en déroute. La discipline dont firent montre les musulmans fit découvrir aux Mecquois toute l’adresse et la capacité de ceux qu’ils avaient chassés de leur cité. Une des tribus alliées qui s’était engagée à soutenir les musulmans durant la bataille de Badr pour ensuite se désister dès le début de l’affrontement fut expulsée de Médine un mois après la bataille. Ceux qui prétendaient être alliés des musulmans tout en s’opposant à eux en secret virent en cela un avertissement : l’appartenance à la communauté obligeait à un soutien inconditionnel.
Un an plus tard, les Mecquois attaquèrent de nouveau. Ayant rassemblé une armée de trois milles hommes, ils affrontèrent les musulmans à Ouhoud, un mont situé à l’extérieur de Médine. Prenant le dessus dès le départ, les musulmans furent par la suite repoussés et le Prophète lui-même fut blessé.
Deux ans plus tard, les Mecquois marchèrent sur Médine avec une armée de dix milles hommes, mais l’issue de l’affrontement fut bien différente. Au cours de ce qui est maintenant connu sous le nom de « la bataille des tranchées » ou « la bataille des confédérés », les musulmans vinrent à bout de leurs ennemis en utilisant un nouveau type de défense. Du côté de Médine par lequel ils s’attendaient à voir arriver l’ennemi, ils creusèrent une tranchée impossible à franchir par la cavalerie mecquoise qui essuya, à chaque tentative, une pluie de flèches de la part d’archers dissimulés derrières des contreforts. Après un siège interminable et infructueux, les Mecquois furent forcés de se retirer, suite à quoi Médine revint entièrement aux mains des musulmans.
Après que Mohammed eût prêché publiquement durant plus d’une décennie, l’opposition envers lui et ses fidèles atteignit une force telle que, craignant pour leur sécurité, il envoya un groupe d’entre eux en Éthiopie, où le dirigeant chrétien leur offrit sa protection (les musulmans apprécièrent tant ce geste qu’ils en caressent le souvenir aujourd’hui encore). À la Mecque, pendant ce temps, la persécution atteignait un sommet. Les fidèles de Mohammed étaient victimes de harcèlement, d’abus de toutes sortes et même de torture. C’est alors que Mohammed envoya soixante-dix de ses fidèles à Yathrib (plus tard renommée Médine), une ville située au nord, dans l’espoir d’y établir une nouvelle communauté musulmane. Plusieurs autres groupes de musulmans émigrèrent à la suite de ce premier groupe. Puis, en l’an 622, Mohammed et son ami intime, Abou Bakr al-Siddiq, partirent à leur tour vers Yathrib. Ce départ coïncidait avec un complot ourdi par les dirigeants de la Mecque pour assassiner Mohammed.
D’ailleurs, peu après le départ de Mohammed, ses ennemis firent irruption chez lui, où ils trouvèrent son cousin ‘Ali couché à sa place, dans son lit. Enragés, ils partirent à sa poursuite, le cherchant partout. Mohammed et Abou Bakr, de leur côté, avaient trouvé refuge dans une grotte, à l’abri de leurs poursuivants. Protégés par Dieu, ils ne furent jamais découverts par leurs ennemis qui passèrent pourtant tout près de leur cachette. Puis, le moment venu, ils quittèrent la grotte et partirent en direction de Médine où ils furent joyeusement accueillis par une foule enthousiaste composée de locaux et d’émigrants mecquois qui avaient atteint Médine avant eux.
Telle fut la hijrah (hégire, en français), qui marqua la première année de l’ère islamique. La hijrah, parfois définie à tort comme une fuite, fut en réalité une migration minutieusement planifiée qui marqua non seulement le début de l’ère islamique, mais aussi, pour Mohammed et ses fidèles, le début d’un nouveau mode de vie. Dès lors, ce qui allait unir les gens en communauté ne serait plus simplement le lien de parenté, mais une grande fraternité entre tous les musulmans. Les gens qui émigrèrent à Médine avec Mohammed furent appelés les Mouhajirounes (i.e. « ceux ayant accompli la hijrah », ou « émigrants »), tandis que les natifs de Médine convertis à l’islam furent appelés les Ansars (i.e. « alliés » ou « auxiliaires »).
Mohammed connaissait bien la situation de Médine. Avant la hijrah, certains de ses habitants étaient venus accomplir le pèlerinage annuel à la Mecque. Et comme le Prophète avait saisi l’occasion du pèlerinage pour prêcher l’islam aux pèlerins, le groupe qui était venu de Médine avait répondu à son invitation et accepté l’islam, puis l’avait invité, lui, à venir s’installer à Médine. Après la hijrah, les qualités exceptionnelles de Mohammed impressionnèrent tant les Médinois que les tribus rivales et leurs alliés serrèrent les rangs temporairement. Puis, au mois de mars de l’an 624, Mohammed et ses fidèles durent se battre contre les païens de la Mecque.
La première bataille, qui eut lieu près de Badr, une petite ville située au sud-ouest de Médine, eut d’importantes conséquences pour tous. L’armée musulmane, trois fois moins importante que l’armée mecquoise, parvint à mettre cette dernière en déroute. La discipline dont firent montre les musulmans fit découvrir aux Mecquois toute l’adresse et la capacité de ceux qu’ils avaient chassés de leur cité. Une des tribus alliées qui s’était engagée à soutenir les musulmans durant la bataille de Badr pour ensuite se désister dès le début de l’affrontement fut expulsée de Médine un mois après la bataille. Ceux qui prétendaient être alliés des musulmans tout en s’opposant à eux en secret virent en cela un avertissement : l’appartenance à la communauté obligeait à un soutien inconditionnel.
Un an plus tard, les Mecquois attaquèrent de nouveau. Ayant rassemblé une armée de trois milles hommes, ils affrontèrent les musulmans à Ouhoud, un mont situé à l’extérieur de Médine. Prenant le dessus dès le départ, les musulmans furent par la suite repoussés et le Prophète lui-même fut blessé.
Deux ans plus tard, les Mecquois marchèrent sur Médine avec une armée de dix milles hommes, mais l’issue de l’affrontement fut bien différente. Au cours de ce qui est maintenant connu sous le nom de « la bataille des tranchées » ou « la bataille des confédérés », les musulmans vinrent à bout de leurs ennemis en utilisant un nouveau type de défense. Du côté de Médine par lequel ils s’attendaient à voir arriver l’ennemi, ils creusèrent une tranchée impossible à franchir par la cavalerie mecquoise qui essuya, à chaque tentative, une pluie de flèches de la part d’archers dissimulés derrières des contreforts. Après un siège interminable et infructueux, les Mecquois furent forcés de se retirer, suite à quoi Médine revint entièrement aux mains des musulmans.
Après que Mohammed eût prêché publiquement durant plus d’une décennie, l’opposition envers lui et ses fidèles atteignit une force telle que, craignant pour leur sécurité, il envoya un groupe d’entre eux en Éthiopie, où le dirigeant chrétien leur offrit sa protection (les musulmans apprécièrent tant ce geste qu’ils en caressent le souvenir aujourd’hui encore). À la Mecque, pendant ce temps, la persécution atteignait un sommet. Les fidèles de Mohammed étaient victimes de harcèlement, d’abus de toutes sortes et même de torture. C’est alors que Mohammed envoya soixante-dix de ses fidèles à Yathrib (plus tard renommée Médine), une ville située au nord, dans l’espoir d’y établir une nouvelle communauté musulmane. Plusieurs autres groupes de musulmans émigrèrent à la suite de ce premier groupe. Puis, en l’an 622, Mohammed et son ami intime, Abou Bakr al-Siddiq, partirent à leur tour vers Yathrib. Ce départ coïncidait avec un complot ourdi par les dirigeants de la Mecque pour assassiner Mohammed.
D’ailleurs, peu après le départ de Mohammed, ses ennemis firent irruption chez lui, où ils trouvèrent son cousin ‘Ali couché à sa place, dans son lit. Enragés, ils partirent à sa poursuite, le cherchant partout. Mohammed et Abou Bakr, de leur côté, avaient trouvé refuge dans une grotte, à l’abri de leurs poursuivants. Protégés par Dieu, ils ne furent jamais découverts par leurs ennemis qui passèrent pourtant tout près de leur cachette. Puis, le moment venu, ils quittèrent la grotte et partirent en direction de Médine où ils furent joyeusement accueillis par une foule enthousiaste composée de locaux et d’émigrants mecquois qui avaient atteint Médine avant eux.
Telle fut la hijrah (hégire, en français), qui marqua la première année de l’ère islamique. La hijrah, parfois définie à tort comme une fuite, fut en réalité une migration minutieusement planifiée qui marqua non seulement le début de l’ère islamique, mais aussi, pour Mohammed et ses fidèles, le début d’un nouveau mode de vie. Dès lors, ce qui allait unir les gens en communauté ne serait plus simplement le lien de parenté, mais une grande fraternité entre tous les musulmans. Les gens qui émigrèrent à Médine avec Mohammed furent appelés les Mouhajirounes (i.e. « ceux ayant accompli la hijrah », ou « émigrants »), tandis que les natifs de Médine convertis à l’islam furent appelés les Ansars (i.e. « alliés » ou « auxiliaires »).
Mohammed connaissait bien la situation de Médine. Avant la hijrah, certains de ses habitants étaient venus accomplir le pèlerinage annuel à la Mecque. Et comme le Prophète avait saisi l’occasion du pèlerinage pour prêcher l’islam aux pèlerins, le groupe qui était venu de Médine avait répondu à son invitation et accepté l’islam, puis l’avait invité, lui, à venir s’installer à Médine. Après la hijrah, les qualités exceptionnelles de Mohammed impressionnèrent tant les Médinois que les tribus rivales et leurs alliés serrèrent les rangs temporairement. Puis, au mois de mars de l’an 624, Mohammed et ses fidèles durent se battre contre les païens de la Mecque.
La première bataille, qui eut lieu près de Badr, une petite ville située au sud-ouest de Médine, eut d’importantes conséquences pour tous. L’armée musulmane, trois fois moins importante que l’armée mecquoise, parvint à mettre cette dernière en déroute. La discipline dont firent montre les musulmans fit découvrir aux Mecquois toute l’adresse et la capacité de ceux qu’ils avaient chassés de leur cité. Une des tribus alliées qui s’était engagée à soutenir les musulmans durant la bataille de Badr pour ensuite se désister dès le début de l’affrontement fut expulsée de Médine un mois après la bataille. Ceux qui prétendaient être alliés des musulmans tout en s’opposant à eux en secret virent en cela un avertissement : l’appartenance à la communauté obligeait à un soutien inconditionnel.
Un an plus tard, les Mecquois attaquèrent de nouveau. Ayant rassemblé une armée de trois milles hommes, ils affrontèrent les musulmans à Ouhoud, un mont situé à l’extérieur de Médine. Prenant le dessus dès le départ, les musulmans furent par la suite repoussés et le Prophète lui-même fut blessé.
Deux ans plus tard, les Mecquois marchèrent sur Médine avec une armée de dix milles hommes, mais l’issue de l’affrontement fut bien différente. Au cours de ce qui est maintenant connu sous le nom de « la bataille des tranchées » ou « la bataille des confédérés », les musulmans vinrent à bout de leurs ennemis en utilisant un nouveau type de défense. Du côté de Médine par lequel ils s’attendaient à voir arriver l’ennemi, ils creusèrent une tranchée impossible à franchir par la cavalerie mecquoise qui essuya, à chaque tentative, une pluie de flèches de la part d’archers dissimulés derrières des contreforts. Après un siège interminable et infructueux, les Mecquois furent forcés de se retirer, suite à quoi Médine revint entièrement aux mains des musulmans.









































1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité