 referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});



"La disparition du racisme, comme c'est le cas chez les Musulmans, est une des réussites les plus marquantes de l'Islam et il y a dans le monde contemporain, une urgente nécessité à propager cette vertu islamique..."
A.J. Toynbee "Civilization on Trial", New York, 1948, p. 205.
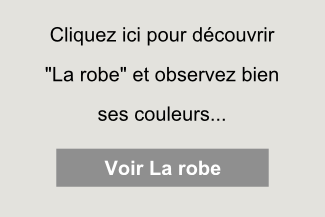 Si vous cliquez sur la photo ci-contre vous découvrirez une robe qui a beaucoup fait parler d'elle cet hiver. Et vous, de quelle couleur la voyez-vous ? Cette robe a en effet fait l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux cet hiver, créant deux groupes opposés, l'un percevant des rayures bleues et noires, tandis que l'autre des rayures blanches et dorées. Ces échanges ont pris tellement d'ampleur que des chercheurs se sont penchés sur la question pour tenter de trouver une explication.
Si vous cliquez sur la photo ci-contre vous découvrirez une robe qui a beaucoup fait parler d'elle cet hiver. Et vous, de quelle couleur la voyez-vous ? Cette robe a en effet fait l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux cet hiver, créant deux groupes opposés, l'un percevant des rayures bleues et noires, tandis que l'autre des rayures blanches et dorées. Ces échanges ont pris tellement d'ampleur que des chercheurs se sont penchés sur la question pour tenter de trouver une explication.
Les neurones miroirs : une explication de l’empathie
Découverts par l’équipe du neuroscientifique Giacomo Rizzolatti dans les années 90, les neurones miroirs ont totalement bouleversé la neurologie, la communication, mais aussi la philosophie. Cette découverte, que l’on doit presque au hasard comme le paracétamol, nous a permis de mieux comprendre les processus non-verbaux, et d’observer l’empathie à l’intérieur même d’un cerveau.
Comme nous allons le voir, les neurones miroirs sont un élément majeur à prendre en compte quand on s’intéresse au langage corporel.
Les neurones miroirs : du singe à l’homme
C’est par hasard que Rizzolatti mis en évidence les neurones miroirs. Alors qu’un chercheur travaillait sur le système moteur d’un singe branché sur des électrodes, il tendit la main pour attraper son sandwich. Les détecteurs se mirent à « biper », signifiant que le singe venait d’accomplir un mouvement… Alors qu’il était immobile, observant le chercheur.
Des tests ont alors été faits pour mieux observer ce processus qui a eu lieu, pour arriver à cette conclusion : quand un singe observe un mouvement, il le reproduit dans son cerveau, sans pour autant accomplir le mouvement. Pourtant, pour le cerveau, c’est comme s’il était acteur de ce geste : les mêmes zones du cerveau s’activent quand le primate observe et lorsqu’il fait une action précise. Cette découverte allait révolutionner notre système de penser les comportements, car ce qui a été observable chez le singe est applicable à l’homme, ainsi qu’à beaucoup de mammifères.
Une expérience intéressante a été réalisée par des chercheurs allemands et canadiens (Lindner, Echterhoff, Davidson, & Brand, 2010) : des participants ont pour consigne de réaliser certaines actions spécifiques et simples (comme secouer une bouteille), puis d’observer en vidéo quelqu’un exécuter d’autres actions. Puis on demande aux participants, deux semaines plus tard, d’identifier les actions auxquelles ils ont pris part.
Les résultats montrent que l’on a tendance à croire que l’on a réalisé une action… alors que l’on a fait que l’observer ! La faute aux neurones miroirs, qui ont recréé l’action… juste dans notre cerveau !
Les neurones miroirs responsables de notre évolution
Les neurones miroirs refont penser le mimétisme comme outil de notre évolution : ce qui a permis à l’homme d’aller vers une civilisation, c’est sa capacité à comprendre et transmettre un savoir, une technique et à la reproduire pour son usage ou celui de sa communauté.
Vers une explication de l’empathie
Dans notre étude de la communication non-verbale, on ne peut ignorer les neurones miroirs. Elles nous expliquent pourquoi quand nous observons l’émotion chez autrui, nous ressentons cette même émotion (avec des nuances cependant, dûes à notre relation ou notre détachement avec ce que l’on observe). Il a été remarqué quand nous observions un visage souriant, nous avions des micro-crispations de la bouche, comme une amorce de sourire. De même, quand nous observons un visage coléreux, des micro-crispations des sourcils sont détectées par les appareils de mesure. Nous ressentons ce que nous voyons, nous l’exprimons, même subrepticement : nous sommes empathiques. C’est une possible explication de l’autisme : les neurones miroirs des autistes sont moins réactifs que chez la plupart des personnes.
En communication non-verbale, nous devons prendre pleinement conscience de cette empathie dans notre analyse. En effet, la « contagion émotionnelle » provoquée par les neurones miroirs peut fausser une observation. Prenons par exemple le cas de l’effet Pygmalion : si j’adopte une posture inconsciemment agressive, mon interlocuteur va sentir cela, et réagir en conséquence, peut-être par une réaction elle aussi agressive. Puis-je honnêtement dire, si j’analyse mon interlocuteur, qu’il est agressif à mon encontre ? Ne suis-je pas moi-même responsable de son attitude ?
Voilà pourquoi nous devons prendre conscience que nous sommes tout autant émetteurs que récepteurs en communication, non pas à tour de rôle, mais en même temps.
Les neurones miroirs et la stimulation
Boris Cyrulnik, lors d’une émission radio, mettait en garde contre le manque de stimulation de nos neurones miroirs à cause de la technologie. En effet, nos méthodes de communications, aussi bien en téléphonie qu’en informatique, nous prive beaucoup d’un élément essentiel : l’autre. Vu que les neurones miroirs sont essentiels pour comprendre l’autre et surtout aller vers son prochain, quel risque à long terme si nous nous coupons du relationnel ? La question reste en suspend.
La plus belle observation des neurones miroirs que j’ai pu faire, c’est avec les enfants. Vous pouvez très facilement les stimuler, par l’apprentissage, le jeu et le non-verbal. Avec les bébés, vous pouvez observez à quel point ces derniers sont sensibles à l’émotion, à l’intention. Souriez-leur, et vous verrez au bout d’un moment leur sourire en retour.
Regardez un enfant grimacer de dégout à l’ingestion d’un aliment : vous verrez ses petits camarades eux aussi faire la même mimique. Les enfants apprennent petit à petit à être empathique car l’émotion de l’autre, c’est aussi leurs émotions.
Une empathie qu’il faut petit à petit ré-apprivoiser et non plus mettre de coté : c’est un pas vers la conscience de soi et la conscience de l’autre.
Je terminerai avec une citation de R.W Fassbinder :
Je crois que l’homme est ainsi fait, il a besoin de l’autre, mais il n’a pas appris à être deux.
http://www.cygnification.com/neurones-miroirs/






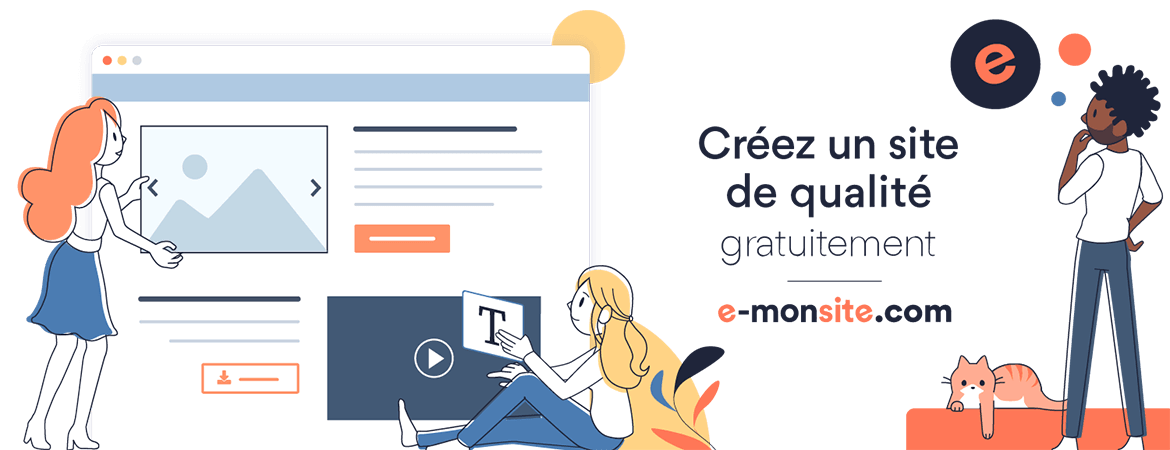


1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité