
Intuition, pressentiment, prémonition... Quels que soient la forme et le ressenti que prend cette sensation chez chacun d’entre nous, elle est toujours vécue comme l’assurance de savoir, sans savoir pourquoi l’on sait et d’où l’on tient sa certitude. Brutalement, l’évidence s’impose, c’est là, le corps et l’esprit le sentent et le savent en même temps, et sont réunis dans cette conviction. Les uns percevront une ouverture au niveau du plexus, d’autres connaîtront une accélération du rythme cardiaque, auront des picotements dans les mains ou dans la nuque...
L'intelligence du cerveau droit
« Tout le monde en a fait au moins une fois l’expérience, affirme Béatrice Millêtre, docteure en psychologie, spécialisée en sciences cognitives. Mais ce savoir intuitif peut être parasité par notre cerveau gauche, logique et raisonneur. » La psychologue distingue deux modes de raisonnement : « L’un séquentiel, logicomathématique : de l’énoncé, je déduis ma première étape, de laquelle découle la deuxième, et ainsi de suite jusqu’au résultat. Et l’autre intuitif, dans lequel la conscience verbale est le dernier maillon de la chaîne de traitement des informations. » C’est Archimède qui pousse le fameux « Eurêka » dans sa baignoire quand s’impose à lui une solution qui semble tomber du ciel, alors qu’en vérité elle est le fruit d’un long cheminement paraconscient.
Gerd Gigerenzer, directeur de l’institut de recherche Max-Planck à Berlin, qui a enseigné la psychologie à l’université de Chicago, définit l’intuition comme une forme d’intelligence exploitant « les capacités évoluées du cerveau et reposant sur les méthodes empiriques qui nous permettent d’agir rapidement, avec une exactitude étonnante ». Notre cerveau a accès à des informations qui échappent à notre conscience, ainsi qu’à des facultés qui se développent et qui s’affinent depuis des milliers d’années pour garantir notre survie et notre développement. Au point que le chercheur allemand utilise indifféremment les mots « intuition » et « instinct ». Pour lui, est intuition « ce qui jaillit dans la conscience, dont les raisons sous-jacentes nous échappent en partie et qui est cependant suffi samment convaincant pour nous pousser à agir ». Ce sont ces « je dois », « je ne dois pas » qui s’imposent face à un choix important (déménager, s’engager dans une relation affective, changer de travail) et qui semblent surgir des profondeurs de notre être. Que l’on choisisse de les écouter ou pas. C’est également un ressenti très fort et que démentent pourtant les apparences. Agnès, une de mes amies, m’a dit avoir eu un jour l’intuition, en jardinant, que son fils n’allait plus en cours à la fac, alors qu’objectivement aucun élément ne permettait de le soupçonner. « J’ai su, d’un coup. J’ai tout lâché et lui ai laissé un message téléphonique. Le soir, il me rappelait et avouait tout. J’ai bien fait d’écouter ma petite voix plutôt que les arguments rationnels de mon mari, qui n’y avait vu que du feu. »
Une petite voix difficile à entendre
Si nous laissons notre cerveau gauche, celui de la logique et de la raison « raisonnante », monter sur le ring, notre pensée intuitive n’a aucune chance de sortir gagnante du combat. Tout dans notre culture rationnelle, phobique de l’inexpliqué, concourt à étouffer dans l’oeuf notre sixième sens. Au travail, par exemple, comment expliquer que l’on ne « sente pas » une décision, une embauche, une stratégie ? Faire entendre son intuition à des sceptiques, des goguenards, des anxieux, qui ne sont rassurés que par le raisonnement logico- mathématique, est mission impossible. C’est ainsi que la petite voix meurt et que notre faculté finit par s’éteindre.
Catherine Balance, coach et thérapeute spécialisée dans l’intuition, constate quotidiennement, dans ses ateliers, la difficulté des gens à faire confiance à leur « petite voix », « soit parce que ce mode de pensée est découragé dès l’enfance, soit parce qu’il est méprisé dans notre culture, pour laquelle le “ressentir” est le parent pauvre de l’intelligence ». Selon la thérapeute, nombreux sont les freins qui bloquent notre intelligence intuitive : nos peurs, nos croyances, nos projections positives ou négatives… À ces mots, je réalise que dans ma famille celle-ci a toujours été un outil aussi noble et fiable que la raison ou la logique, au point que je sais – passé quelques minutes de parasitage – distinguer mes projections anxieuses d’un pressentiment négatif. « Je donne cette clé à mes clients, ajoute Catherine Balance : lorsqu’une pensée intuitive vient déranger la logique, un mode de réflexion habituel ou l’une de vos croyances, prenez-la en compte ! » La thérapeute ne se lasse pas d’énumérer les bénéfices d’un sixième sens aiguisé : une intelligence complète, car fonctionnant avec « les deux cerveaux », des décisions et des choix plus personnels, et, enfin, une vision et une perception plus globales de sa vie et des autres.
Un phénomène relié à l'univers
Décliner une invitation, relever un défi ou faire un choix sans argumentation rationnelle, puis apprendre que mes décisions spontanées étaient justes… Le phénomène m’est familier depuis longtemps, mais, à chaque confirmation, il me fait éprouver une joie presque enfantine accompagnée d’un sentiment profond d’harmonie, au sens musical du terme. Particulièrement dans ces moments, il me semble faire partie d’un grand tout généreux et cohérent. Comme si l’ensemble des informations dont nous avions besoin se trouvaient à portée de main.
Carole Sédillot, formatrice et spécialiste de Jung, partage cette conception de l’intuition : « Dans la perspective jungienne, cette fonction, qui est en relation avec le phénomène de synchronicité, est un signe de reliance. À son inconscient personnel, à l’inconscient collectif, mais aussi à l’univers. Ceux qui repèrent les synchronicités qui savent qui savent écouter leur voix intérieure ne sont jamais trompés. Si le moi s’égare dans ses désirs, l’âme, nous dit Jung, sait ce qui est bon pour elle, et en cela elle peut déranger le moi. » J’ai souvent constaté que les intuitions fulgurantes qui me traversaient pouvaient être en opposition avec ma raison ou mes croyances. Je me suis toujours mordu les doigts les rares fois où j’ai choisi de ne pas les suivre, par prudence ou peur de la frustration, pour faire plaisir ou ne pas déplaire. « Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent : “Si j’avais écouté mon intuition”, poursuit Carole Sédillot. Ce à quoi je réponds : “Il n’est jamais trop tard pour bien faire.” » Le conseil a la simplicité trompeuse des préceptes de sagesse. Il résonne en tout cas suffi samment en moi pour que je décide de le conserver en mémoire, au cas où.
Steve Jobs, le visionnaire
Nos objets seraient-ils devenus, eux aussi, « intuitifs » ? Le mot signifie ici que leurs fonctions sont à notre disposition, évidentes à comprendre et à utiliser. Tout cela pourrait passer pour du pur marketing s’il n’y avait eu Steve Jobs, créateur d’Apple. Dès 1984, il propose un ordinateur commandé par une souris et dont les logiciels apparaissent à l’écran. Jusque-là, il fallait entrer des lignes de codes pour piloter un appareil. L’échec commercial est cuisant, car, à cette époque, le monde de l’informatique ne jure que par le sérieux et la complexité. Il passe pour un doux allumé. Il est pourtant tout l’inverse : rigide, perfectionniste, irascible. Et têtu. Steve Jobs a voulu un ordinateur en forme de lampe ? Un écran tactile ? Une discothèque universelle ? En dépit des critiques, il a toujours tout obtenu, dans le moindre détail de ce que lui dictait son imagination, sans jamais, paraît-il, avoir recours à une étude de marché. « Le plus difficile est de faire simple, disait-il. Il faut avoir le courage de suivre son coeur et ses intuitions. »
Anne Pichon
Les neurologues et l'intuition
Régine Zekri-Hurstel, neurologue : « Ce n’est pas magique, c’est logique »
« L’intuition est une forme de connaissance directe qui a pu être qualifiée de « clairvoyance instantanée ». Notre cerveau intègre en permanence, dans une routine inconsciente, tous les ressentis sensoriels que nous éprouvons. Qu’un détail change dans une situation connue et notre intuition s’active. Elle surgit en un millième de seconde de la mémoire sensorielle. Elle relève d’un inconscient d’adaptation, d’une capacité du cerveau à arriver directement à des conclusions en zappant leur élaboration. C’est un processus inductif et non pas déductif comme l’est le raisonnement. Mais ce n’est pas parce que nous n’avons pas accès à sa mécanique cognitive que cette dernière n’existe pas. L’intuition n’est pas « magique », elle est parfaitement logique et rationnelle. Comment identifi er une intuition ? Comme l’intuition plonge ses racines dans la mémoire sensorielle, elle se manifeste par un ressenti corporel. Son surgissement s’assortit d’un dérèglement du système neurovégétatif : battements de coeur, sensation de chaleur, mains moites. Son apparition provoque une sensation physique, de bien-être ou de mal-être. Elle s’exprime par une émotion. Ensuite, c’est en tentant de la comprendre que nous mettons des mots sur ce qu’elle nous dit, pour passer de l’implicite à l’explicite. »
Propos recueillis par Christine Baudry Régine Zekri-Hurstel est l’auteure, avec Jacques Puisais, du Temps du goût (Éditions Privat, 2010).
http://www.psychologies.com


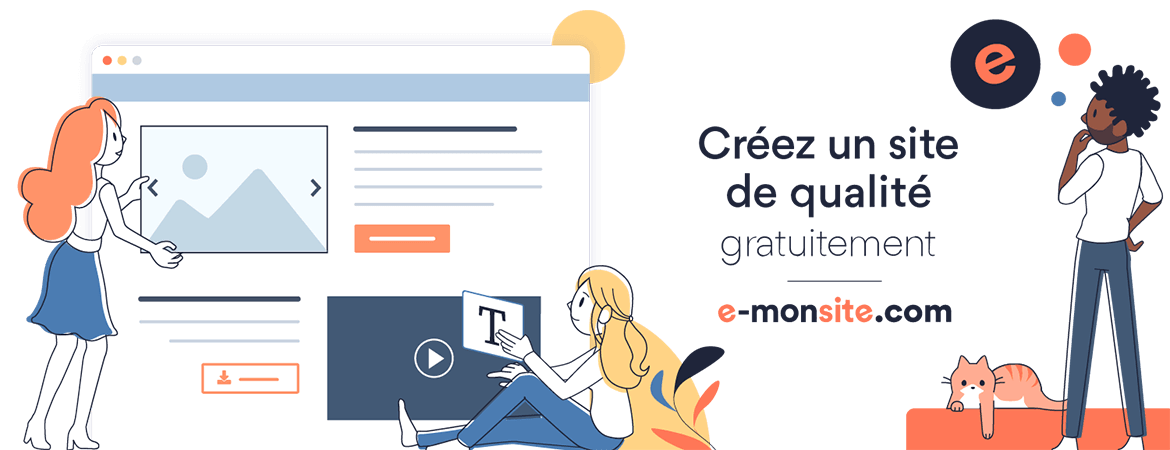













































1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité