L'Islam et les autres religions
L’islam estime que toutes les religions procèdent d’une même source : Allah. De ce fait, elles conservent malgré les péripéties de l’histoire une morale et des valeurs communes. Quand bien même les voies et les moyens diffèrent, les religions - plutôt la religion car en principe il n’y a qu’une seule religion- ont essentiellement pour but d’assurer à l’homme le bonheur ici-bas et dans l’au-delà.
« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait prescrit à Noé, ce que Nous t’avons révélé à toi-même, ce que Nous avions prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus : « Etablissez la religion et n’en faites pas un sujet de divisions. » s42 v13
Découvrez les articles classés par catégories
Le printemps arabe est un sinistre avertissement pour l’Occident
- Le 23/11/2011
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
Abid Mustafa, traduit de l'anglais
Pendant que le monde débat sur les divers mérites des révoltes arabes - est-ce que les révolutions engendreront un paysage politique alternatif ou non - très peu a été dit sur la façon de voir les choses par les Arabes. Oui, le peuple arabe a appris à devenir intrépide face aux régimes despotiques, mais ceci s’agit plus d’une description de leurs états psychologiques que de leurs façons de voir les choses. Le processus de penser des Arabes a subi une transformation énorme et il est rapidement en train d’atteindre un niveau de maturité intellectuel qui très probablement produira un effet crescendo.
Considérons l’euphorie provoquée par le bannissement de Ben Ali en Tunisie ou l’incarcération de Hosni Moubarak en Egypte. Au début, les Arabes ont en déduit que cela se s’accompagnerait par un changement permanent, un changement qui marquerait la différence avec les systèmes autocratiques actuels et leurs lois draconiennes.
A la place, et en l’espace de quelques mois, les Egyptiens ont compris que le régime avait non seulement survécu, mais avait reçu un nouveau souffle à travers un putsch miliatire. Le traité de paix avec l’état juif, méprisé par la majorité des Egyptiens, était resté intact. Les militaires, jadis les piliers de cette révolution, sont passés subitement de héros à traîtres. La torture, l’emprisonnement sans être jugé, les enlèvements par les forces de sécurité, les exécutions extrajudiciaires et les conflits sectaires, tous répandus sous Moubarak, sont retournés hanter les Egyptiens avec une nouvelle vigueur. Les protégés occidentaux préparés lors de leurs exils et présentés comme des alternatives viables au statu quo furent aussitôt répudiés par les masses. Ceux qui étaient étiquetés 'Islamistes', jadis désirés par les croyants, sont maintenant ridiculisés pour paraître plus laïques que les laïques! L’enthousiasme du public pour les réformes constitutionnelles et l’élection présidentielle s’est estompé.
L’expérience tunisienne est également très similaire. En regardant plus loin, la même chose peut être dit au sujet du Maroc, de l’Algérie, de la Libye, de la Jordanie, de la Syrie et de certains pays du Golfe. Le scénario avant et après la révolte est resté le même pour les Arabes. Pour eux, le monde arabe est gouverné par des élites pro-occidentales qui sont plus intéressées par la préservation des intérêts coloniaux occidentaux que par la libération des masses arabes de la tyrannie.
Néanmoins, il semble maintenant que toute tentative occidentale à orchestrer un changement politique dans les pays arabes est instantanément rejetée et renvoyée. L’esprit arabe dormant est finalement éveillé et il est en train de produire des résultats qui sont diamétralement opposés à la longévité et à la suprématie occidentale au Moyen-Orient.
On peut soutenir qu’au cours des quatre-vingt-dix dernières années, l’ampleur et la profondeur des problèmes touchant les Arabes se sont accrues. La destruction du Califat en 1924, l’occupation occidentale des terres Islamiques, la création de l’état juif en 1948, les deux guerres du Golfe, la guerre contre le terrorisme et la réoccupation des terres arabes ont toutes laissés des traces indélébiles sur le psyche arabe. Ces sentiments profonds d’humiliation, d’indignité et de violation des valeurs Islamiques ont poussés les Arabes à réfléchir profondément sur leurs situation. Mais l’Occident, à travers les exilés arabes et ses autres représentants dans le monde arabe, a nourri les masses d’un régime de pensées occidentales corrompues afin de troubler les gens et les empécher d’arriver au correct jugement au sujet des évènements qui les marquaient. Par conséquence, le processus de penser ou cycle de réflexion - c’est à dire d’abord ressentir les problèmes, ce qui demande pouvoir établir un lien et contempler, puis ensuite émettre un jugement - était soit brisé ou soit faussé en faveur d’interprétations occidentales. Pour la majorité des Arabes, ceci avait résulté en une paralysie intellectuelle et une stagnation des sociétés arabes. Coupés de leurs sentiments naturels, les Arabes étaient incapables de produire des solutions domestiques aux problèmes qu’ils rencontraient et ils étaient forcés d’importer les solutions et idées occidentales. Ainsi le processus de penser était temporairement interrompu. Ce qui exacerba la situation était l’adoption de solutions occidentales. Ces solutions résoudaient rarement les problèmes, mais en fait les exacerbaient et parfois, même, les prolongeaient car ces solutions étaient souvent ‘copiées et collées’ sans aucune compréhension réelle de leurs origines et de leurs motivations. Ceci eut pour effet de rendre les Arabes, impuissants, plus dépendants de l’Occident pour leurs problèmes toujours croissant .
De cette manière, l’Occident a été capable de maintenir son emprise intellectuelle sur les Arabes, ainsi que le monde musulman entier, pendant de très nombreuses années. Seule une minorité de musulmans fut parvenu à ponctuer la domination intellectuelle occidentale et à exposer la fausseté de son idéologie. En revanche, la majorité demeura dans une stagnation et s’enfonça dans le gouffre de l’obscurité et du désespoir.
Aujourd’hui, ceci ne semble plus être le cas. Le processus de penser des Arabes n’est plus fragmenté et déconnecté de son environnement. Au contraire, il est vif, en phase avec son environnement et prend réconfort dans son riche héritage islamique. Le temps pris pour véritablement comprendre les évènements est visiblement plus court et la plupart du temps les jugements trouve leurs racines dans la pensée Islamique. La pensée et vision occidentale sont habituellement écartées. A leurs place il y a une nouvelle constellation de concepts et valeurs Islamiques. Les concepts de Khilafah (Califat), Jihad, politique Islamique, Oumma, unité, Shariah et du Khalifah(le Calif, c’est à dire le dirigerant politique unique pour le monde musulman) sont tellement prévalents aujourd’hui qu’il est fréquent de les voir apparaître dans le lexique occidental pour interpréter les évènements dans le monde musulman.
http://albadil.edaama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=241:la-nouvelle-vision-des-arabes-est-un-sinistre-avertissement-pour-loccident&catid=43:analyses&Itemid=58
La liberté de culte en Islam
- Le 16/11/2011
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
La liberté de conscience et de culte en Islam... par Manifeste_des_Libertes
 L’islam ne force pas les gens des autres religions à se convertir. L’islam leur accorde la pleine liberté de demeurer au sein de leur religion. Cette liberté est documentée à la fois dans le Coran et dans les enseignements prophétiques que l’on appelle la sounnah. Dans le Coran, Dieu s’adresse ainsi au prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) :
L’islam ne force pas les gens des autres religions à se convertir. L’islam leur accorde la pleine liberté de demeurer au sein de leur religion. Cette liberté est documentée à la fois dans le Coran et dans les enseignements prophétiques que l’on appelle la sounnah. Dans le Coran, Dieu s’adresse ainsi au prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) :
« Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Contraindrais-tu les gens à devenir croyants, (ô Mohammed)? » (Coran 10:99)
Le prophète Mohammed laissait aux gens le choix d’embrasser l’islam ou de demeurer au sein de leur religion. S’il lui arrivait de leur proposer d’embrasser l’islam, ce n’était qu’après avoir conclu un accord avec eux, une fois qu’ils étaient devenus résidents de l’État islamique et qu’ils étaient assurés d’être protégés, eux et leurs biens. Cette protection leur faisait apprécier la sécurité que leur apportait leur alliance avec Dieu et Son prophète. C’est précisément pour cette raison que l’on fait référence aux citoyens non-musulmans en tant que « dhimmis ».[1] Quand le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) envoyait un commandant d’armée à la guerre, il lui recommandait de se comporter en ayant toujours conscience de la présence de Dieu et de bien traiter ses compagnons musulmans. Puis, il lui ordonnait ceci :
« Mets-toi en route pour aller te battre pour la cause de Dieu et pour combattre ceux qui refusent de croire en Lui. Bats-toi, mais ne sombre pas dans les extrêmes, ne te comporte pas en traître, ne mutile pas les corps de tes ennemis et ne tue jamais leurs enfants. Lorsque tu feras face à l’ennemi, les mécréants, présente-leur trois options et accepte celle qu’ils accepteront et cesse de les combattre :
(a) Invite-les à devenir musulmans. S’ils acceptent, cesse de les combattre. Puis, invite-les à quitter leur pays pour le pays des immigrants (Médine); et dis-leur que s’ils le font, ils jouiront des mêmes privilèges et auront les mêmes obligations que les autres immigrants. S’ils refusent d’immigrer, dis-leur qu’ils auront le même statut que les musulmans nomades; ils seront soumis à la Loi de Dieu, qui s’applique à tous les musulmans, mais n’auront pas de part dans les butins obtenus lors de conquêtes, à moins qu’ils ne participent à la guerre avec les musulmans.
(b) S’ils refusent (de se convertir), demande-leur de payer la jizyah[2]. S’ils acceptent de la payer, accepte-la et cesse de les combattre.
(c) S’ils refusent tout cela, alors demande l’aide de Dieu et combats-les. »[3]
Ces directives du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) étaient conformes au paroles de Dieu, dans le Coran :
« Nulle contrainte en religion. La bonne voie est désormais distincte de l’erreur. Celui qui rejette les fausses divinités et croit en Dieu a saisi l’anse la plus solide, qui ne se brisera jamais. Dieu entend tout, et Il est Omniscient. » (Coran 2:256)
Edwin Calgary, un érudit américain, a écrit, au sujet de ce verset : « Il y a un verset, dans le Coran, connu de tous les musulmans, qui est rempli de vérité et de sagesse. Tous devraient le connaître également; c’est celui qui dit qu’il n’y a nulle contrainte en religion. »[4]
Ce verset fut révélé relativement à certains résidents de Médine. Si leur femme donnait naissance à des enfants qui mouraient tous en bas âge, ils faisaient le vœu de faire de leur prochain enfant un juif ou un chrétien s’il ne mourait pas. Lorsque vint l’islam et que ces parents devinrent musulmans, ils tentèrent de forcer leurs enfants, qui étaient maintenant adultes et qui étaient soit juifs soit chrétiens, à devenir musulmans à leur tour. Ce verset fut donc révélé pour leur interdire un tel comportement. Le verset et l’histoire de sa révélation nous apprend donc qu’il n’est pas permis de forcer qui que ce soit à devenir musulman. Et tel est le cas même si les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, mais que ceux-ci choisissent de suivre une autre voie.[5]
Dieu dit, dans le Coran :
« Dis : « La vérité émane de votre Seigneur. » Quiconque souhaite croire, qu’il croie; et quiconque refuse de croire, qu’il ne croie pas. Nous avons certes préparé, pour les mécréants, un Feu dont (la fumée et les flammes), comme les parois et le toit d’une tente, les cernera. Et s’ils implorent quelque soulagement, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite! » (Coran 18:29)
Non seulement l’islam accorde-t-il la liberté de culte aux non-musulmans, sa loi va jusqu’à protéger leurs lieux de culte.[6]
Dieu dit, dans le Coran :
« Dieu autorise les gens à se défendre s’ils sont agressés. Et Il est bien capable de donner la victoire à ceux qui ont été injustement chassés de leur maison uniquement pour avoir dit : « Notre Seigneur est Dieu. » Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d’autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est souvent prononcé auraient assurément été démolis. Et certes, Dieu soutient ceux qui soutiennent Sa cause. Il est certainement Fort et Puissant. » (Coran 22:39-40)
Les califes musulmans avaient pour habitude d’ordonner à leurs chefs militaires, lorsqu’ils partaient en campagne, de prendre des mesures pour garantir la protection des lieux de culte. Le premier exemple de ce genre est l’ordre donné par Abou Bakr à Oussama bin Zayd :
« Je vous ordonne dix choses: ne tuez ni femmes ni enfants ni personnes âgées; n’abattez pas d’arbres fruitiers, ne vandalisez pas de maisons, ne blessez ni moutons ni chameaux si ce n’est pour les consommer; ne noyez pas de dattiers et n’en brûlez pas; ne vous comportez pas en traîtres ni en lâches; et si vous passez près de gens qui se sont consacrés à la vie monastique, laissez-les à leurs dévotions. »[7]
Le second exemple est le traité d’Omar ibn al-Khattab avec les gens d’Iliya (Jérusalem) :
« Ceci est la garantie de sécurité accordée par le serviteur de Dieu, Omar, chef des croyants, au peuple d’Iliya. Leur sécurité est assurée quant à leurs personnes, leurs possessions, leurs crucifix, leurs églises et tous ceux qui s’y trouvent, qu’ils soient malades ou en bonne santé, de même que tous les membres de leur communauté. Leurs églises ne seront ni occupées ni démolies, et rien n’en sera dérobé, qu’il s’agisse du mobilier, des crucifix ou de l’argent. Ils ne seront point forcés à abandonner leur religion et ne seront aucunement lésés à cause d’elle. Et ils ne seront pas occupés par les colons juifs d’Iliya. »[8]
Par conséquent, depuis l’époque des califes bien guidés, les juifs et les chrétiens ont tenu leurs cérémonies religieuses en toute liberté et en toute sécurité.[9]
Les musulmans ont toujours protégé les églises chrétiennes des contrées qu’ils ont occupées. Dans une lettre à Siméon, l’archevêque de Rifardashir et chef des archevêques de Perse, le patriarche nestorien Geoff III écrit :
« Les Arabes, à qui Dieu a accordé le pouvoir sur le monde entier, savent à quel point vous êtes riches, puisqu’ils vivent parmi vous. Malgré cela, ils ne s’attaquent pas à la foi chrétienne. Au contraire, ils ont une certaine sympathie pour notre religion, un grand respect pour nos prêtres et nos saints, et ils donnent volontiers à nos églises et à nos monastères. »[10]
Une fois, un des califes musulmans, Abdoul-Malik, s’était emparé de l’Église de Jean et l’avait annexée à une mosquée. Lorsque Omar bin Abdoulaziz lui succéda comme calife, les chrétiens vinrent se plaindre à lui au sujet de ce que son prédécesseur avait fait de leur église. Omar écrivit alors au gouverneur pour lui ordonner que la partie de la mosquée qui appartenait de droit aux chrétiens leur soit rendue s’ils étaient incapables de s’entendre, avec lui, sur un dédommagement financier satisfaisant. »[11]
Le Mur des Lamentations, à Jérusalem, est connu des historiens comme l’un des lieux de culte les plus sacrés du judaïsme. Il fut un temps où ce mur était complètement enterré sous des montagnes de débris et de gravats. Lorsque le calife ottoman Sultan Sulayman apprit cela, il ordonna à son gouverneur de Jérusalem de retirer ces débris, de nettoyer les lieux, de restaurer le Mur des Lamentations et de le rendre à nouveau accessible aux juifs.[12]
Des historiens occidentaux impartiaux reconnaissent ces faits. LeBon a écrit :
« La tolérance de Mohammed envers les juifs et les chrétiens était réellement impressionnante. Les fondateurs des autres religions avant lui, ceux du judaïsme et du christianisme, en particulier, n’avaient pas prescrit une telle ouverture. Les califes qui lui succédèrent appliquèrent la même politique, et sa tolérance fut reconnue à la fois par les musulmans et par les sceptiques qui étudièrent en profondeur l’histoire des Arabes. »[13]
Robertson a écrit :
« Seuls les musulmans réussirent à combiner leur zèle pour leur religion à une tolérance envers les fidèles des autres religions. Même lorsqu’ils brandissaient leurs épées lorsqu’ils se battaient pour gagner la liberté de prêcher leur religion, ils laissaient ceux qui ne désiraient pas se joindre à eux libres de rester fidèles à leurs croyances. »[14]
Sir Thomas Arnold, un orientaliste anglais, a écrit:
« Nous n’avons jamais entendu parler d’aucune tentative organisée pour forcer des minorités non-musulmanes à accepter l’islam, ni d’aucune persécution organisée visant à supprimer la religion chrétienne. Si n’importe lequel des califes avait choisi ce type d’approche, il aurait écrasé le christianisme avec la même facilité avec laquelle Ferdinand et Isabelle ont fait sortir l’islam d’Espagne, ou avec laquelle Louis XIV a fait du protestantisme un délit en France, ou encore avec laquelle les juifs ont été expulsés d’Angleterre pour une période de 350 ans. À cette époque, les églises orientales étaient totalement isolées du reste du monde chrétien. Elles n’avaient point de défenseurs, dans le monde, car elles étaient considérées comme des sectes chrétiennes hérétiques. Le fait qu’elles existent encore de nos jours est la preuve la plus concrète de la politique de tolérance du gouvernement islamique. »[15]
« Le calife Omar prenait grand soin de préserver le caractère sacré des lieux saints chrétiens, et ceux qui lui succédèrent en tant que califes suivirent son exemple. Jamais ils ne harcelèrent les pèlerins de toutes dénominations qui venaient chaque année, des quatre coins du monde chrétien, visiter Jérusalem. »[16]
L’auteur américain Lothrop Stoddard a écrit :
« La vérité est que les non-musulmans étaient traités avec plus de tolérance par les musulmans que par n’importe quelle autre secte de leur propre religion. »
Richard Stebbins parle ainsi de l’expérience chrétienne sous le règne turc :
« Ils (les Turcs) permirent à tous, catholiques romains et grecs orthodoxes, de préserver leur religion et d’adhérer aux croyances de leur choix. Ils leur permirent de garder leurs églises pour y accomplir leurs rituels sacrés, à Constantinople et en plusieurs autres lieux. Cela diffère totalement de ce dont je peux témoigner au sujet de l’Espagne, pour y avoir vécu durant douze ans; non seulement étions-nous forcés d’assister à leurs célébrations papistes, mais nos vies et celles de nos petits-enfants étaient en danger. »[17]
Thomas Arnold mentionne, dans son « Invitation à l’islam », qu’à cette époque, de nombreuses personnes, en Italie, souhaitaient vivre sous le règne ottoman, afin de se voir accorder la même liberté et être traitées avec la même tolérance que celles accordées par les Ottomans à leurs sujets chrétiens, car elles n’espéraient plus les obtenir sous quelque gouvernement chrétien que ce soit. Il mentionne également qu’un grand nombre de juifs avaient fui les persécutions, en Espagne, à la fin du 15e siècle, pour se réfugier en Turquie ottomane.[18]
Il vaut la peine de souligner, encore une fois, le point suivant : la présence de non-musulmans, des siècles durant, au sein du monde islamique, de l’Espagne maure à l’Afrique sub-saharienne, à l’Égypte, à la Syrie, à l’Inde et à l’Indonésie est une preuve claire de la tolérance religieuse accordée par l’islam aux personnes de foi différente. Cette tolérance a même mené à l’expulsion des musulmans d’Espagne, où les chrétiens profitèrent du manque d’autorité des musulmans pour les attaquer et les faire disparaître du pays, soit en les tuant, soit en les forçant à se convertir au christianisme, ou encore en les expulsant. Étienne Denier a écrit : « Les musulmans sont à l’opposé de ce que croient bien des gens. Ils n’ont jamais utilisé la force en dehors du Hejaz.[19] D’ailleurs, la présence de chrétiens au sein de leurs sociétés en témoigne; ces derniers ont pu vivre librement leur religion durant les huit siècles de règne musulman dans leurs contrées. Certains d’entre eux occupèrent même de hauts postes à Cordoba. Mais lorsque ces mêmes chrétiens prirent le pouvoir, leur première préoccupation, tout à coup, fut d’exterminer les musulmans. »[20]
Footnotes:
[1] Arnold, Thomas, ‘Invitation To Islam,’ p. 102
[2] Qaradawi, Yusuf, ‘Ghayr al-Muslimeen fil-Mujtama’ al-Islami,’ p. 32
[3] Hussayn, Abdul-Latif, ‘Tasamuh al-Gharb Ma’l-Muslimeen,’ p. 67
[4] LeBon, Gustav, ‘Arab Civilization,’ p. 128
[5] Cité dans Aayed, Saleh Hussain, ‘Huquq Ghayr al-Muslimeen fi Bilad il-Islam,’ p. 26
[6] Arnold, Thomas, ‘Invitation To Islam,’ p. 98-99
[7] Stoddard, L.W., ‘The Islamic World At Present,’ vol 1, p. 13-14
[8] Cité dans Qaradawi, Yusuf, ‘al-Aqaliyyat ad-Diniyya wa-Hal al-Islami,’ p. 56-57
[9] Arnold, Thomas, ‘Invitation To Islam,’ p. 183
[10] La partie occidentale de l’Arabie, qui inclut les villes de la Mecque et de Médine.
[11] Denier, Etienne, ‘Muhammad The Messenger Of God,’ p. 332
[12] Zuhaili, Wahba, ‘al-Islam wa Ghayr al-Muslimeen,’ p. 60-61
[13] Jizyah: taxe de protection payable par les non-musulmans au gouvernement musulman.
[14] Sahih Mouslim
[15] Quoted in Young, Quailar, ‘The Near East: Society & Culture,’ p. 163-164
[16] Qaradawi, Yusuf, ‘Ghayr al-Muslimeen fil-Mujtama’ al-Islami,’ p. 18-19
[17] Aayed, Saleh Hussain, ‘Huquq Ghayr al-Muslimeen fi Bilad il-Islam,’ p. 23-24
[18] Tabari, Tarirk al-Tabari, vol 3, p. 210
[19] Tabari, Tarirk al-Tabari, vol 3, p. 159
[20] Qaradawi, Yusuf, ‘al-Aqaliyyat ad-Diniyya wa-Hal al-Islami,’ p. 13
Source:http://www.islamreligion.com/fr/articles/381/
Islam et Protestantisme
- Le 15/11/2011
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
Les seules formes de christianisme connues par l'islam ont été longtemps uniquement celles du christianisme oriental, abondamment décrites par les polygraphes musulmans médiévaux, notamment Shahrastânî (m. 1153, Kitâb al-milal wa n-nihal ou Livre des Communautés religieuses). Bîrûnî (m. 1048) déjà avait inclus ces formes de christianisme dans des raisonnements d'histoire comparée des religions, notamment dans son Histoire de l'Inde.
Les musulmans médiévaux étaient immergés dans un monde chrétien, où ils ne formaient souvent au départ qu'une minorité. Les musulmans étaient donc naturellement au courant des doctrines et des rites des chrétiens orientaux, leurs voisins, même si mainte chose leur semblait extravagante.
Ce qui les frappaient c'étaient le faste et la luxuriance du culte, l'utilisation de la musique, l'encens, la durée inhabituelle des offices, le pouvoir clérical exorbitant, l'adoration du Christ, toutes choses inhabituelles en islam, dont les offices sont brefs, austères, uniquement parlés ou psalmodiés, qui ne connaît ni clercs ni pouvoir clérical et qui réprouve toute autre adoration que celle de Dieu.
Les contacts avec l'Europe, l'impact des missions au Proche-Orient notamment avait mis l'islam également en contact avec le catholicisme, dont certains us impressionnaient et stupéfiaient encore plus: les pouvoirs doctrinaux, législatifs et disciplinaires du pape, celui inouï de remettre les péchés, le célibat des prêtres.
Le protestantisme a longtemps été méconnu et le reste.
Au début, les observateurs musulmans du monde européen (surtout des voyageurs et des diplomates turcs) virent dans l'émergence du protestantisme avant tout une affaire politique: la volonté d'un certain nombre de souverains d'Europe du Nord d'en découdre avec le pouvoir temporel de la papauté ou des problèmes politico-religieux (problèmes conjugaux du roi d'Angleterre Henri VIII qui se heurtait à l'interprétation papale de la loi de l'Evangile sur le mariage) ou encore des problèmes ethniques (peuples germaniques contre peuples latins), voire une tentative biaisée de rapprochement entre la reine Elisabeth 1ère et le sultan Soliman le Magnifique.
La volonté de rupture théologique du protestantisme par rapport à des pratiques médiévales antérieures était largement sous-estimée, voire ignorée: retour à l'Ecriture, à une certaine simplicité évangélique, qui n'est pas sans rappeler la simplicité bédouine, volonté de décentralisation par rapport à l'autorité romaine (alors que l'islam sunnite est lui-même décentralisé et polycentrique), rapport plus ouvert à une sexualité mieux vécue.
A vrai dire, le protestantisme, par son désir de retour aux sources bibliques et évangéliques, donc sémitiques, est proche de bien des valeurs musulmanes.
En théologie, dans les deux religions, à Dieu seul l'adoration est due. Protestantisme et islam comprennent cela de manière radicale et se méfient donc de toute vénération des saints. La célèbre formule de la Réforme, solâ scripturâ, solâ fide pourrait être reprise à son compte par l'islam. Tout usage qui n'est pas fondé strictement sur l'Ecriture est réputé, selon les théologiens musulmans, sans valeur et quelquefois nuisible pour la foi. Evidemment, il y a eu eu en islam de multiples querelles sur la délimitation de l'Ecriture: est-ce le Coran et la Sunna (position classique) ou est-ce le Coran seul (position défendue actuellement par exemple par le colonel Kadhafi en Lybie) ?
En islam, la foi a priorité sur les oeuvres: seule la foi sauve en théologie ach'arite (école de référence dans le sunnisme).
La reconnaissance de Dieu comme seul auteur du monde et son auteur actuel (dogme de la création continue) conduit en la croyance en la prédestination, problématique que l'on sait, ô combien présente, chez les réformateurs protestants du 16ème s.
Ce qui oppose principalement protestantisme et islam, c'est la priorité de la conscience personnelle sur la Loi. Le combat historique du protestantisme pour le libre-examen, face à tous les pouvoirs, fussent-ils religieux, la libre détermination de la vie personnelle et de son éthique, la reconnaissance d'un certain relativisme des normes morales, la réduction des normes éthiques à quelques grands principes généraux, notamment la norme de non-nuisance à l'égard du prochain, donc la reconnaissance de la légitimité d'un certain individualisme éthique, font que le protestantisme est particulièrement réceptif aux problèmes que pose l'incarnation des normes éthiques à chaque société et à chaque époque particulière.
La reconnaissance du sacerdoce universel et du caractère contingent de certaines normes chrétiennes liées à l'époque (par exemple la masculinité des douze disciples de Jésus) fait que le protestantisme au rebour d'autres mouvements religieux a accepté facilement dès ses origines le mariage des pasteurs et récemment (au 20ème s.) la légitimité de l'accès des femmes au ministère pastoral.
Les sociétés protestantes sont des sociétés occidentales de l'hémisphère nord, essentiellement germaniques, par opposition aux sociétés catholiques d'Europe qui sont latines et méditerranéennes, et aux sociétés musulmanes qui débordent la Méditerranée.
Les femmes y sont visibles dans la société, elles revendiquent leur présence active dans la vie de la Cité. Les sociétés protestantes sont des sociétés où l'on vit sereinement la mixité (la présence des deux sexes) en tout lieu. Il n'y a pas ces invisibles frontières de l'Europe du sud (dont parle Germaine Tillon), où il est inconcevable, comme dans les sociétés musulmanes, que l'on sorte en couple le soir, ou pis encore, qu'une femme circule seule dans ces villes, où, passé une certaine heure, la rue appartient aux mâles et où ceux-ci monopolisent les tavernes.
En matière de pudeur, les limites des rapports publics entre hommes et femmes est depuis longtemps intériorisée, elle n'est pas marquée par le voile des femmes comme dans certaines sociétés musulmanes. Elle y est purement intérieure.
Monde protestant et monde musulman se sont longtemps ignorés, malgré l'occidentalisation du monde musulman, qui,vu l'importante composante protestante de l'Occident contemporain, est aussi une protestantisation rampante du monde musulman.
Le protestantisme n'a longtemps vu l'islam qu'à travers ses missions engagées sur le terrain. Une nouvelle vision des choses n'est intervenue que récemment avec la création de la section Dialogue avec les religions et les fois vivantes du Conseil Oecuménique des Eglises. Il a manqué au protestantisme une figure prophétique de l'envergure de Louis Massignon (1882-1962, cf. Parole Donnée, et les Opera Minora). La profondeur et l'érudition de la recherche intellectuelle de M.W/ Watt (Mahomet à La Mecque, Mahomet à Médine, biographie du Prophète), l'honnêteté de la recherche théologique de Kenneth Cragg ( The Call of the Minaret) n'y font rien. Mais les travaux du Groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC, cf. Ces Ecritures qui nous questionnent, la Bible et le Coran) qui font autorité dans le dialogue islamo-chrétien ont intégré bien des aspects de la problématique protestante en matière de dialogue interreligieux, notamment la nécessité d'une base scientifique et méthodologique intégrant une lecture distancée, non dogmatique, du fait religieux.
© Ralph Stehly, Professeur d'histoire des religions, Université Marc Bloch, Strasbourg
Le Coran est-il antisémite ?
- Le 14/11/2011
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions
Simonnot: antisémitisme et Islam par unmondelibre
L’antisémitisme signifie la condamnation et la haine d’un peuple à cause de son origine sémite. L’antisémitisme est un sectarisme et un racisme. Il s’agit d’une chose condamnable qui n’a aucune place ni en Islam ni dans le Coran. Le Coran ne légitime nullement la haine contre une quelconque race, nationalité ou couleur. À travers l’histoire de l’Islam, les Musulmans n’ont jamais fait usage de passages coraniques pour justifier des actes antisémites. Les effets néfastes du racisme, incluant le nettoyage ethnique, le génocide et l’Holocauste, dont ont souffert aussi bien les Juifs que les non-Juifs au cours des siècles passés, n’ont jamais été commis sous la bannière du moindre passage coranique. Les Juifs figuraient parmi les tout premiers convertis à l’Islam (à Médine) et, à travers le Moyen-Age, les Juifs ont trouvé des synagogues pour la pratique de leur propre religion, et ce, au sein de l’Etat islamique. Il est vraiment décevant et naïf d’ignorer 1430 ans d’histoire et de savants discours sur le Coran, puis venir arguer que la situation politique actuelle au Moyen-Orient trouve ses racines dans des passages issus du Coran.
Comme toutes les écritures, les passages coraniques doivent être replacés dans leur contexte. Le Coran n’a pas été révélé pour les seuls Musulmans, mais pour l’humanité toute entière, en particulier pour les Juifs et les Chrétiens. Le Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était dans la continuité des Prophètes Abraham, Moïse et Jésus ; le Coran était quant à lui dans la continuité des anciennes écritures révélées par Dieu. Le Coran ne condamne pas la race sémite mais, en réalité, accorde aux Juifs un statut spécial à cause des traditions prophétiques qu’ils partagent avec l’Islam.
Le Coran critique plutôt les Juifs qui se sont détournés de l’authentique message divin et il réprimande ceux qui méprisaient et ridiculisaient le Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et le message coranique. Ces critiques contre les Juifs sont similaires à celles qu’on peut trouver dans d’autres écritures dont la Bible. Elles doivent être considérées par tout le monde comme un rappel et un avertissement contre l’abandon et l’égarement de l’authentique message divin. De telles critiques spécifiques n’ont jamais été interprétées par les grands savants du Coran comme une incitation à la haine du peuple juif. Elles ne doivent donc pas être confondues avec de l’antisémitisme.
Le Coran s’étend longuement sur les Enfants d’Israël (Banî Isrâ’îl et reconnaît que les Juifs (Al-Yahûd) sont, d’après leur généalogie, les descendants du Prophète Abraham à travers son fils Isaac et son petit-fils Jacob, paix et bénédiction sur eux. Les Juifs furent choisis par Dieu pour remplir une mission :
« À bon escient, Nous les choisîmes parmi tous les peuples de l’univers » (sourate 44 intitulée la Fumée, Ad-Dukhân, verset 32).
Dieu suscita parmi eux de nombreux prophètes et leur accorda ce qu’il n’accorda pas à de nombreux autres peuples :
« (Souvenez-vous) lorsque Moïse dit à son peuple : ‹Ô, mon peuple ! Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsqu’Il a désigné parmi vous des prophètes. Et Il a fait de vous des rois. Et Il vous a donné ce qu’Il n’avait donné à nul autre dans les mondes. » (sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 20).
Il les éleva au-dessus d’autres nations de la Terre, et leur accorda un grand nombre de faveurs :
« Ô Enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, (rappelez-vous) que Je vous ai préférés à tous les peuples (de l’époque). » (sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 47).
Les passages coraniques critiquant les Juifs se subdivisent principalement en deux catégories :
Premièrement, le Coran parle de la manière dont les Enfants d’Israël se détournèrent du message authentique qui leur avait été révélé. Ils désobéirent à Dieu et se montrèrent ingrats face aux faveurs divines qui leur avaient été accordées. Ils perdirent la Thora (Tawrâh) originelle et introduisirent leurs propres mots et leurs propres interprétations dans les livres divins. Ils devinrent arrogants et prétendirent qu’ils étaient les fils de Dieu ; ils ne cessaient de vanter leur position de peuple élu de Dieu (4 : 155 [2] ; 5 : 13, 18 [3]). Ils commirent également effrontément des péchés que leurs rabbins et docteurs ne tentèrent pas d’empêcher (5 : 63, 79 [4]). Dieu suscita parmi eux Son Prophète Jésus afin qu’il leur montre plusieurs miracles et qu’il les guide vers le droit chemin. Cependant, ils le refusèrent, essayèrent de le tuer, et prétendirent même qu’ils l’avaient effectivement tué bien qu’ils en furent incapables (4 : 157-158 [5]). Dans un grand nombre de ces passages, Dieu s’adresse spécifiquement aux Enfants d’Israël. Il est très important de noter cela, dans la mesure où cela montre que le Coran est destiné au monde entier et en particulier aux Juifs : les critiques sont ainsi dirigées contre un groupe de gens spécifique pour leurs actions spécifiques. Il faut distinguer ces critiques d’une malédiction jetée contre un peuple, simplement à cause de sa race.
Deuxièmement, concernant la critique des Juifs, qu’on peut trouver dans des passages parmi lesquels ceux que vous avez cités 5 : 60-64 [1], il faut noter que de tels versets critiquent les Juifs et les Chrétiens qui ridiculisaient le Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et son message. Ils raillaient son appel à la prière et se moquaient de lui. Ils lui faisaient des remontrances à chaque fois qu’il les invitait à croire en ce que Dieu lui avait révélé et en ce qui avait été révélé avant lui à leurs propres prophètes. Ils devinrent vindicatifs envers lui et le rejetèrent car n’étant pas issu de la souche israëlite (2 : 109 [6] ; 4 : 54 [7]).
Le Coran fait remarquer que de telles critiques ne sont pas dirigées contre l’ensemble des Juifs. Même lorsque le Coran critique les Juifs, il ajoute qu’ « il est, parmi les gens du Livre, une communauté » de pieux et de vertueux, ordonnant le convenable et interdisant le blâmable, qui tentent de s’encourager les uns les autres à atteindre l’excellence, et ce, par des actions de charité et de bonté. Le Coran dit que de telles personnes sont assurées que quoiqu’elles fassent de bien, rien ne leur sera dénié et qu’elles recevront entièrement leur récompense de la part de Dieu (3 : 113-115 [8]).
Prendre quelques passages du Coran, en les sortant de leur contexte historico-textuel ne peut mener à une compréhension exacte de cette écriture religieuse. Cela n’est pas vrai uniquement pour le Coran, mais également pour la Bible. De nombreux passages bibliques critiquent également les Juifs. Il vous suffit de lire la Bible Hébraïque, en particulier les livres de Michée (3 : 1-12 [9]) et d’Osée (8 : 1-14 [10]) dans lesquels ces prophètes condamnent les Juifs « qui exécrent la justice et qui tordent tout ce qui est droit » et qui « construisent Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime ». Ces prophètes ont maudit Israël, la décrivant comme un « vaisseau inutile parmi les nations ». Ils ont demandé à Dieu de la maudire en « envoyant le feu dans les villes [de Juda] » et en réduisant Jérusalem à devenir « un monceau de décombres ». De la même manière, dans le Deutéronome, Moïse avertit Israël que Dieu « enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l’imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement, pour la perversité de tes actions, pour m’avoir abandonné. » (Deutéronome, chapitre 28, verset 20).
Dans l’Evangile de Matthieu (23 : 13-39 [11]), Jésus réprimande continuellement les Juifs pour leur hypocrisie et leur injustice, et les condamne pour les meurtres qu’ils commirent contre les anciens prophètes. Jésus dit : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes..., et vous n’avez pas voulu ! ». Cela paraîtrait pour le moins étrange si quelqu’un, se fondant sur ces passages, déclarait que la Bible et les prophètes hébreux étaient antisémites et qu’ils appelaient à l’élimination de l’actuel peuple d’Israël. Par conséquent et de la même manière, contester des passages coraniques en les accusant d’être antisémites est infondé. »
Et Dieu est Le plus Savant.
P.-S.
Source : la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.netNotes
[1] Sourate 5, la Table servie, Al-Mâ’idah :
60. Dis : ‹Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de rétribution auprès de Dieu ? Celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a adoré la Rébellion, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit›.
61. Lorsqu’ils viennent chez vous, ils disent : ‹Nous croyons.› Alors qu’ils sont entrés avec la mécréance et qu’ils sont sortis avec. Et Dieu sait parfaitement ce qu’ils cachent.
62. Et tu verras beaucoup d’entre eux se précipiter vers le péché et l’iniquité, et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu’ils oeuvrent !
63. Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises !
64. Et les Juifs disent : ‹La main de Dieu est fermée !› Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l’inimitié et la haine jusqu’au Jour de la Résurrection. Toutes les fois qu’ils allument un feu pour la guerre, Dieu l’éteint. Et ils s’efforcent de semer le désordre sur la terre, alors que Dieu n’aime pas les semeurs de désordre.
[2] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’ :
155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l’engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole : ‹Nos coeurs sont (enveloppés) et imperméables›. Et réalité, c’est Dieu qui a scellé leurs coeurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu.
[3] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah :
13. Et puis, à cause de leur violation de l’engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs coeurs : ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d’un petit nombre d’entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. Car Dieu aime, certes, les bienfaisants.
[...]
18. Les Juifs et les Chrétiens ont dit : ‹Nous sommes les fils de Dieu et Ses préférés.› Dis : ‹Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ?› En fait, vous êtes des êtres humains d’entre ceux qu’Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c’est vers Lui que sera la destination finale.
[4] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah :
63. Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises !
[...]
79. Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient !
[5] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’ :
157. et à cause leur parole : ‹Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu›... Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué.
158. mais Dieu l’a élevé vers Lui. Et Dieu est Puissant et Sage.
[6] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah :
109. Nombre de gens du Livre aimeraient, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s’est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu’à ce que Dieu fasse venir Son commandement. Dieu est très certainement Omnipotent !
[7] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’ :
54. Envient-ils aux gens ce que Dieu leur a donné de par Sa grâce ? Or, Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse ; et Nous leur avons donné un immense royaume.
[8] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân :
113. Mais il ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets de Dieu en se prosternant.
114. Ils croient en Dieu et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes oeuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien.
115. Et quelque bien qu’ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Car Dieu connaît bien les pieux.
[9] Livre de Michée, chapitre 3 :
Mi 3:1- Puis je dis : Écoutez donc, chefs de la maison de Jacob et commandants de la maison d’Israël ! N’est-ce pas à vous de connaître le droit,
Mi 3:2- vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui leur arrachez la peau, et la chair de sur leurs os !
Mi 3:3- Ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, et lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l’ont déchiré comme chair dans la marmite et comme viande en plein chaudron,
Mi 3:4- alors, ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, à cause des crimes qu’ils ont commis.
Mi 3:5- Ainsi parle Yahvé contre les prophètes qui égarent mon peuple : S’ils ont quelque chose entre les dents, ils proclament : " Paix ! " Mais à qui ne leur met rien dans la bouche ils déclarent la guerre.
Mi 3:6- C’est pourquoi la nuit pour vous sera sans vision, les ténèbres pour vous sans divination. Le soleil va se coucher pour les prophètes et le jour s’obscurcir pour eux.
Mi 3:7- Alors les voyants seront couverts de honte et les devins de confusion ; tous, ils se couvriront les lèvres, car il n’y aura pas de réponse de Dieu.
Mi 3:8- Moi, au contraire, je suis plein de force et du souffle de Yahvé , de justice et de courage, pour proclamer à Jacob son crime, à Israël son péché.
Mi 3:9- Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et commandants de la maison d’Israël, vous qui exécrez la justice et qui tordez tout ce qui est droit,
Mi 3:10- vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime !
Mi 3:11- Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres décident pour un salaire, ses prophètes vaticinent à prix d’argent. Et c’est sur Yahvé qu’ils s’appuient ! Ils disent : " Yahvé n’est-il pas au milieu de nous ? le malheur ne tombera pas sur nous. "
Mi 3:12- C’est pourquoi, par votre faute, Sion deviendra une terre de labour, Jérusalem un monceau de décombres, et la montagne du Temple une hauteur boisée. Le règne futur de Yahvé à Sion.
[10] Livre d’Osée, chapitre 8 :
Os 8:1- Embouche la trompette ! Comme un aigle, le malheur fond sur la maison de Yahvé. Car ils ont transgressé mon alliance et ont été infidèles à ma Loi.
Os 8:2- Ils ont beau me crier : " Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. " Os 8:3- Israël a rejeté le bien, l’ennemi le poursuivra.
Os 8:4- Ils ont fait des rois, mais sans mon aveu, ils ont fait des chefs, mais à mon insu. De leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles, afin qu’elles soient supprimées.
Os 8:5- Ton veau, Samarie, je le repousse ! - ma colère s’est enflammée contre eux. Jusques à quand ne pourront-ils recouvrer l’innocence ? -
Os 8:6- Car il vient d’Israël, c’est un artisan qui l’a fabriqué, lui, il n’est pas Dieu, lui. Oui, le veau de Samarie tombera en miettes.
Os 8:7- Puisqu’ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête : tige qui n’a pas d’épi, qui ne donne pas de farine ; et si elle en donne, des étrangers l’engloutiront.
Os 8:8- Israël est englouti. Maintenant ils sont parmi les nations comme un objet dont personne ne veut ;
Os 8:9- car ils sont montés vers Assur, onagre qui vit à l’écart ; Éphraïm s’est acheté des amants.
Os 8:10- Qu’il s’en achète parmi les nations, maintenant je vais les rassembler et ils souffriront bientôt sous le fardeau du roi des princes.
Os 8:11- Quand Éphraïm a multiplié les autels, ces autels ne lui ont servi qu’à pécher.
Os 8:12- Que pour lui j’écrive les mille préceptes de ma loi, on les tient pour une chose étrangère.
Os 8:13- Les sacrifices qu’ils m’offrent, ils les sacrifient, ils en mangent la viande, mais Yahvé ne les agrée pas. Maintenant, il va se souvenir de leur faute et châtier leurs péchés : ils retourneront, eux, en Égypte.
Os 8:14- Israël a oublié son auteur et il a bâti des palais ; Juda a multiplié les villes fortes. Mais j’enverrai le feu dans ses villes, et il en dévorera les citadelles.
[11] Evangile de Matthieu, chapitre 23 :
Mt 23:13- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le Royaume des Cieux ! Vous n’entrez certes pas vous-mêmes, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient ! [
Mt 23:14- ].
Mt 23:15- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous l’avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous !
Mt 23:16- " Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : "Si l’on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas ; mais si l’on jure par l’or du sanctuaire, on est tenu. "
Mt 23:17- Insensés et aveugles ! quel est donc le plus digne, l’or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré ?
Mt 23:18- Vous dites encore : "Si l’on jure par l’autel, cela ne compte pas ; mais si l’on jure par l’offrande qui est dessus, on est tenu. "
Mt 23:19- Aveugles ! quel est donc le plus digne, l’offrande ou l’autel qui rend cette offrande sacrée ?
Mt 23:20- Aussi bien, jurer par l’autel, c’est jurer par lui et par tout ce qui est dessus ;
Mt 23:21- jurer par le sanctuaire, c’est jurer par lui et par Celui qui l’habite ;
Mt 23:22- jurer par le ciel, c’est jurer par le trône de Dieu et par Celui qui y siège.
Mt 23:23- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ; c’est ceci qu’il fallait pratiquer, sans négliger cela.
Mt 23:24- Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique et engloutissez le chameau.
Mt 23:25- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui purifiez l’extérieur de la coupe et de l’écuelle, quand l’intérieur en est rempli par rapine et intempérance !
Mt 23:26- Pharisien aveugle ! purifie d’abord l’intérieur de la coupe et de l’écuelle, afin que l’extérieur aussi devienne pur.
Mt 23:27- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins d’ossements de morts et de toute pourriture ;
Mt 23:28- vous de même, au-dehors vous offrez aux yeux des hommes l’apparence de justes, mais au-dedans vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
Mt 23:29- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes,
Mt 23:30- tout en disant : "Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. "
Mt 23:31- Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes !
Mt 23:32- Eh bien ! vous, comblez la mesure de vos pères !
Mt 23:33- " Serpents, engeance de vipères ! comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?
Mt 23:34- C’est pourquoi, voici que j’envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes : vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville,
Mt 23:35- pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l’innocent Abel jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l’autel !
Mt 23:36- En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération !
Mt 23:37- " Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes..., et vous n’avez pas voulu !
Mt 23:38- Voici que votre maison va vous être laissée déserte.
Mt 23:39- Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! "
Source:http://www.islamophile.org/spip/Le-Coran-est-il-antisemite.html
Les relations économiques entre le monde islamique et l'Occident
- Le 04/10/2011
- Commentaires (0)
- Dans L'Islam et les autres religions

Dr Khalid Mohammed Azab(*)
Introduction
Les échanges commerciaux entre le monde islamique et l'Occident se sont développés depuis les conquêtes islamiques de «la grande Syrie», de l'Egypte et de l'Afrique. La prospérité économique était devenue, pour l'un comme pour l'autre, un indicateur de la supériorité militaire et politique bien que, dans bon nombre de cas, l'on constate un équilibre dans la balance des forces, notamment dans la grande Syrie sur le plan du partage pendant les Croisades(1), ou des échanges économiques utilitaires entre les Mamelouks d'Egypte et de la grande Syrie et les républiques de Venise, de Pisée et de Gênes.
Les relations avant les conquêtes islamiques :
La Syrie et l'Asie mineure jouissaient d'une grande prospérité pendant le règne byzantin, en dépit des tremblements de terre et des invasions perses auxquels certaines régions étaient sujettes. Cette prospérité a perduré jusqu'au début du septième siècle de l'ère chrétienne. L'introduction de l'élevage du ver à soie à la fin du VI° siècle a permis d'impulser encore plus l'essor agricole, enrichissant ainsi davantage les villes qui commerçaient avec les pays du bassin méditerranéen. Le commerce mondial entre les provinces orientales et les pays occidentaux était concentré entre les mains de commerçants syriens et grecs. En effet, les Syriens résidant en France au VI° et au début du VII° siècle importaient les épices, les vins et le papyrus à Marseille et dans d'autres villes intérieures, telles Paris et Tours. Des communautés entières vinrent s'établirent par la suite partout où existait un centre majeur de commerce. Quant aux Grecs, leurs nombres étaient moindres. D'autre part, la demande des provinces orientales pour les graines de Sicile, le blé et l'huile d'olive de l'Afrique du Nord, le bois et le sel de l'Adriatique, le fer et les autres métaux d'Espagne, entre autres, n'était pas inférieure aux besoins de l'Occident en épices, papyrus, vins, soie, tissus et autres produits industriels luxueux fabriqués en Alexandrie, en Syrie ou à Constantinople(2). Les tentatives byzantines visant à dévier la voie commerciale vers le Nord loin de l'Iran n'ont cependant pas réussi, pas plus que leurs efforts d'arrêter l'importation de la soie brute, ou encore de contraindre les importateurs persans à accepter les prix qu'ils ont fixés pour la soie. Byzance continua donc de dépendre de la Perse en tant qu'intermédiaire commercial, sans cesser pour autant d'envoyer des subventions aux Sassanides. Cela ne signifie pas, cependant, que l'or de l'Empire soit passé au Levant, mais plutôt que les industries fécondes qu'il a mises en place en Syrie et à Constantinople ont engendré une sorte d'équilibre dans la balance du commerce avec la Perse. La monnaie byzantine devint, en outre, au milieu du XI° siècle une monnaie internationale sans concurrent dans la zone de l'Océan Indien, dominé naguère par les commerçants persans. Les Sassanides n'ont jamais frappé de monnaie en or, se contentant de la monnaie en argent, preuve de la domination économique byzantine(3).
Les conquêtes islamiques et leur impact :
La situation commerciale demeura inchangée en Méditerranée pendant la première moitié du XII° siècle (le premier tiers du premier siècle de l'hégire), et les conquêtes islamiques n'ont, au début, que très faiblement perturbé cette situation. Mais avec sa conquête de la Perse et de l'Irak, l'Etat islamique reprit à son compte les activités commerciales persanes en Extrême Orient. Et grâce à la conquête de la grande Syrie et de l'Egypte, il acquit une façade sur la Méditerranée, vieux rêve que les Perses n'ont jamais pu réaliser.
Les villes maritimes insulaires (y compris d'Arménie) et syriennes (dont les ports méditerranéens) étaient importantes en tant que centres de distribution des les pays occidentaux des produits amenés de l'Orient par les musulmans. Les habitants des pays conquis ont tôt compris que les conquérants arabes n'étaient pas des peuples barbares et arrogants qui dressaient des achoppements à la prospérité économique, mais qu'ils étaient, tout au contraire, des gens qui laissaient la vie économique poursuivre son rythme naturel, tout en l'entourant de leur attention, leurs encouragements et leur protection(4).
Arabisation de la monnaie :
Le calife Abd al-Malik ibn Marwân aspirait à donner à l'Etat un cachet arabe compatible avec la politique qu'il avait murement et soigneusement dessinée et qu'il s'efforçait d'appliquer dans tous les domaines administratifs et économiques. L'arabisation de la monnaie s'inscrivait justement dans le cadre de cette politique. En effet, la monnaie arabe, avec ses effigies portant le nom du calife, du prince régnant ou du gouverneur, exprimait la souveraineté de l'Etat islamique et son affranchissement de toute influence étrangère. Mais cette indépendance économique ne pouvait se concrétiser dès lors que la monnaie dans les pays arabes était encore attachée à la politique économique de Byzance et de la Perse. Aussi décida-t-il d'arabiser la monnaie pour libérer l'économie arabe. Cette arabisation fut le résultat d'un plan visant à unifier les systèmes monétaires de l'Etat, qui adoptait à l'époque les systèmes monétaires sassanide et byzantin. Ces différents systèmes étaient, par ailleurs, sources de divergence sur les règles applicables en matière de Jizya (tribut), de Kharaj (impôt foncier) et de 'Ushûr (dime) sur le commerce, qui n'étaient pas semblables en Irak et en Perse, d'une part, et dans la Grande Syrie et en Egypte d'autre part. Aussi Abd al-Malik estima-t-il que l'arabisation et l'unification de la monnaie étaient le seul remède pour sortir de cette impasse. D'autant que la disparition de l'empire perse après la conquête arabe et la dégradation de la situation dans l'empire byzantin ont provoqué un manque des monnaies circulant entre les gens. D'où la nécessité de frapper de la monnaie arabe pour combler l'insuffisance quantitative de la monnaie(5).
Le développement économique islamique s'était poursuivi depuis les Omeyyades, aidé en cela par les contraintes imposées par l'administration byzantine aux activités commerciales de ses administrés, car l'Etat byzantin n'avait pas l'esprit commercial, s'intéressant davantage à la domination et au contrôle plutôt qu'au domaine commercial, ne faisant rien pour le promouvoir à des fins de profit(6). Ceci a conduit à la détérioration graduelle de la situation économique de Constantinople et, inversement, à l'expansion du commerce islamique. Il suffit d'observer, à cet effet, les victoires du Dinar islamique en tant que moyen d'échange à travers le monde dans les temps médiévaux. Les récentes fouilles dans bon nombre d'endroits ont mis à jour des quantités considérables de monnaies islamiques, notamment en Russie, en Finlande et autres pays scandinaves, ainsi que dans les Balkans. Il est aussi des exemplaires séparés qui ont été découverts dans des lieux aussi lointains que l'Angleterre et l'Islande. La plupart des monnaies datent de périodes allant de la fin du septième siècle au onzième siècle de l'ère chrétienne, ce qui démontre de l'influence économique des musulmans à cette époque(7).
La prospérité économique du monde islamique avait atteint son apogée, le mouvement commercial international conduit par les musulmans générant des fortunes que nul commerçant ou Etat ne pouvait imaginer. Au dixième siècle, par exemple, les historiens ont enregistré des chiffres astronomiques qui traduisent la richesse et le progrès atteints par les pays tant de l'Est que de l'Ouest du califat. Les revenus du commerce dans les villes d'Alep, de Damas et de Jérusalem étaient estimés, en 908 après J.-C. à environ 2 millions de dinars en or, recettes qui n'étaient pas influencées par le phénomène de l'inflation caractéristique de l'époque moderne. Il convient de ne pas perdre de vue, non plus, le pouvoir d'achat mondial de la monnaie de cette époque. Plus on s'éloignait vers l'Ouest, plus le pouvoir d'achat croissait jusqu'à atteindre des niveaux qui dépassent l'imagination. L'explorateur ibn Hawqal (976 après J.-C.) affirme que le califat omeyyade de Cordoue a pu, sous le règne d'Abdel Rahman III, réaliser un revenu équivalent à 20 millions de dinars en or dans le commerce de l'or d'Afrique de l'Ouest que les caravanes amenaient à Sijilmassa et à Marrakech entre 912 et 951 de l'ère chrétienne(8).
Pour Byzance, les relations économiques avec les Arabes revêtaient une importance capitale qui ne se limitait pas uniquement à l'aspect commercial. L'empire byzantin s'évertuait à consolider sa position internationale tant vis-à-vis des Arabes que de l'Europe. En effet, le commerce de l'Orient islamique vers l'Europe passait dans sa grande majorité, avant les Croisades, par Byzance, et cette position d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident lui rapportait d'énormes revenus. Mais les Croisés finirent par établir des relations directes entre l'Europe et l'Orient de sorte que la prospérité économique de Byzance commença à s'effriter, cédant peu à peu la maîtrise de l'économie aux villes italiennes, notamment à Venise et à Gênes(9).
Les pays en partage :
Les guerres avec les Croisées ont imposé un nouveau type de relations entre le monde islamique et l'Occident. L'invasion des Croisées de la Grande Syrie a engendré de nombreux problèmes politiques et économiques sur les régions contestées et les zones frontalières. Il était donc nécessaire de mettre en place un nouveau système à même de résoudre ces conflits, système qui a reçu le nom de "pays en partage". En réalité, ce système représente, avec ses ingrédients et spécificités, un antécédent au système que certains pays ont adopté à l'époque contemporaine pour résoudre des problèmes suscités par les zones frontalières faisant l'objet de litiges(10). Avec le temps, la situation de ces pays a évolué pour devenir sous administration islamo-franque mixte régie par deux suppléants, l'un représentant le sultan des musulmans, l'autre représentant le gouverneur ou prince franc qui a approuvé le traité portant sur ce système. Le texte du traité stipulait qu'aucun des deux suppléants ne pouvait prendre une quelconque décision sans l'accord de l'autre(11).
Les textes des traités relatifs aux pays en partage comportaient également des clauses relatives à la sécurité des représentants des deux parties ainsi que la coordination de leurs actions respectives. D'autres clauses ont été introduites également prévoyant la solution des problèmes susceptibles d'éclater dans les relations quotidiennes entre les musulmans et les Francs dans les pays en partage ainsi que dans les autres pays pouvant être couverts ultérieurement par le traité. Ces clauses comportaient un principe capital, à savoir, l'application de la Charia islamique sur les musulmans et la loi franche sur les Francs(12).
S'agissant des droits, impôts et taxes, tous types confondus, ceux-ci étaient équitablement partagés entre le sultan et le responsable franc des pays en partage. Ces droits se sont étendus pour comprendre les volets des ressources et des secteurs économiques de l'époque, notamment les terres agricoles, les vergers, les pêcheries, les mines de sel et marais salants, les récoltes estivales et hivernales, les moulins, et les ressources animales dont les bêtes de somme, les bovins et les ovins. Ces droits comprenaient également les taxes versés par les voyageurs et les marchandises traversant le pays et ses ports(13).
Il convient de rappeler que les commerçants musulmans, tout autant que les commerçants chrétiens d'Orient ont joué un rôle capital majeur dans le transport des marchandises entre le Levant et l'Occident. Les sources contemporaines soulignent l'importance des relations entre ces commerçants et les commerçants francs, où peu d'intérêt était accordé aux facteurs religieux. A cet égard, le voyageur andalous Ibn Jubair affirme : «Les divergences entre les musulmans de Damas et d'Acre et les commerçants chrétiens ne constituaient pas un obstacle à leurs rapports mutuels». Et d'ajouter : «Il n'y a rien de plus paradoxal dans ce monde que de voir les caravanes des musulmans passaient dans les pays francs avant de revenir dans les pays musulmans chargés de leurs butins»(14). Les bonnes relations existant entre les commerçants musulmans et chrétiens dans les pays soumis aux Francs sont également démontrées dans les ouvrages d'ibn al-Athir, de Burchard et de Ludolf, qui citent que bon nombre de villes, telles Acre, Beyrouth et autres villes, regorgeaient de commerçants musulmans(15).
A cela s'ajoute le fait que certaines villes sous domination franche étaient, à l'époque, célèbres pour certains produits spécifiques dont les musulmans ne pouvaient se passer. Des sources rappellent, à cet égard, que la ville de Tibériade était depuis toujours, et pendant toute la durée des guerres des croisades, connue pour sa fabrication des nattes de paille, très demandées par les musulmans, tant au Machriq qu'au Maghrib, en particulier les nattes pour la prière et dont le prix unitaire pouvait atteindre par moment jusqu'à cinq dinars en or(16).
Les nobles parmi les Francs recouraient incessamment aux artisans des régions de la Grande Syrie sous domination musulmane pour la fabrication des bijoux dont ils avaient besoin. Sans compter les nombreux objets nécessaires aux églises, tels les vases, argenterie et cristallerie, ornés d'or et d'argent, ou incrustés de pierres précieuses et d'ivoire et qui donnaient aux églises, en réalité, tout leur éclat(17). Plus encore, ils aspiraient tous à décorer leurs maisons et palais de semblables objets. Ils utilisaient, en outre, pour l'éclairage de leurs maisons et palais, les bougies dont certaines villes islamiques, telle Damas, s'étaient rendues célèbres dans leur fabrication. L'explorateur andalou ibn Jubair affirme que le voyage de retour des vaisseaux italiens transportant les voyageurs venus au Levant visiter la Terre Sainte, était financé par les différentes marchandises produites par les pays du Levant(18).
Les Mamelouks et les républiques italiennes :
Le XIII° siècle s'est achevé avec la disparition de principautés créées par les Croisées en Palestine, mais les conséquences de ces événements capitaux ne furent ressenties en Occident qu'au XIV° siècle. Ces conséquences se sont traduites à Rome par les tentatives papales visant à interdire le commerce avec le sultanat des Mamelouks, menaçant d'excommunication tous les commerçants francs qui enfreindraient cet ordre. Le Pape s'efforça d'appliquer cette politique par la force des armes, envoyant des vaisseaux armés pour s'opposer aux navires des commerçants francs qui contrevenaient aux ordres et décisions de l'Eglise. L'Eglise catholique pensait que, stratégiquement, l'interdiction pour les francs de commercer avec le sultanat des Mamelouks conduirait inéluctablement à une pénurie des matières premières indispensables à l'enrichissement et la puissance des Mamelouks, de sorte qu'une fois le sultanat affaibli, il serait facile de le détruire. Il serait dès lors possible pour l'Occident de reprendre sans coup férir Jérusalem, d'autant que le transit des marchandises entre l'Occident et le Levant constituait au Moyen âge la principale source de revenu pour le sultanat Mamelouk, grâce aux droits de douane qu'il prélevait sur les marchandises ainsi qu'aux recettes qu'il générait au titre du courtage commercial.
Position des villes italiennes vis-à-vis de l'ordre pontifical :
La décision du pape était cependant incompatible avec les intérêts des républiques et villes italiennes à vocation maritime. Aussi optèrent-elles pour la poursuite des relations avec l'Orient par toutes les voies possibles, l'appât du gain étant plus fort que la crainte religieuse. Elles profitaient, d'autre part, des efforts déployés par les autorités mamelouks pour faire échouer ce blocus économique, qui réservaient un chaleureux accueil aux commerçants francs et, en particulier, aux commerçants de Venise, de Gênes et de Florence. Ces villes et républiques ont, en effet, conclu des traités avec les Mamelouks qui leur accordaient de nombreux privilèges commerciaux, tout en poursuivant les initiatives auprès du pape pour une reprise des relations commerciales avec l'Egypte, de peur que les villes italiennes ne finissent par s'effondrer. Le pape Clément VI finit par céder, autorisant Venise d'envoyer leurs vaisseaux en Alexandrie et autres ports du sultanat, sous réserve qu'ils ne transportent que les marchandises autorisées (non militaires). Cette autorisation n'aurait pu être obtenue n'était-ce les fortes sommes que Venise avait versées à l'entourage du pape(19).
La chute de Constantinople et ses répercussions :
La prospérité commerciale du sultanat des Mamelouks est redevable à la vitalité des voies maritimes et terrestres qui reliaient l'Est à l'Ouest, en particulier pendant la seconde moitié du XV° siècle. Les Mamelouks servaient en Egypte et à la Grande Syrie de courtiers pour les principales marchandises de l'Orient, notamment les épices, les esclaves, les pierres précieuses, les produits pharmaceutiques, les encens chinois, les bois, etc. L'on peut même dire que la richesse du sultanat, sa puissance et son hégémonie étaient étroitement liées au commerce avec l'Orient.
L'origine des relations commerciales avec les Mamelouks remonte loin dans le temps. L'évolution de la situation politique dans la Méditerranée orientale a de nouveau relancé la voie maritime de la Mer Rouge, qui devint ainsi une voie commerciale principale entre l'Inde et l'Europe méridionale. Il ne fait aucun doute, d'autre part, que la détérioration de la situation sécuritaire en Perse était la cause majeure de cette mutation, bien qu'elle n'en fût pas la seule. En 1434, les Génois avaient en effet occupé Famagouste, contraignant les Vénitiens à abandonner Chypre. En 1375, les Mamelouks avaient envahi le royaume d'Arménie mettant fin au commerce prospère de Lajazzo. Tamerlan avait, pour sa part, détruit à la fin de la dernière décennie du XIV° siècle Astrakhan et les régions prospères situées sur la principale voie commerciale terrestre reliant l'Asie centrale à la Mer Noire(20). A cela s'ajoute l'expansion de l'empire ottoman en Mer Egée et dans les Balkans, et la fermeture de la Mer Noire. Tous ces facteurs réunis ont conduit les Vénitiens, les Génois et les autres Etats commerciaux du Sud européens à intensifier leurs activités commerciales avec le sultanat des Mamelouks. Avec la chute de Constantinople en 1453, le commerce avec l'Egypte et de la Grande Syrie devenait la principale artère du commerce avec l'Orient, d'autant que seuls les commerçants italiens pouvaient, en cette époque, obtenir les épices et autres produits orientaux(21).
C'est ainsi qu'Alexandrie et Beyrouth devenaient d'importants comptoirs commerciaux, poussant les Vénitiens et autres pays européens à conclure des accords avec le sultan et obtenir de multiples privilèges commerciaux favorables à Venise. Dès 1453, le nombre de vaisseaux sillonnant la Méditerranée orientale se multiplia, la République de Venise disposant de trois voies maritimes avec l'Orient, auxquelles était venue s'ajouter, en 1461, une quatrième voie reliant Tunis à Alexandrie, appelée Di Trafego. Quant aux commerçants de Gênes, de Florence, de Naples et d'Ancône, ils ont reçu d'autres privilèges, dirigeant leurs navires et marchandises vers les ports d'Alexandrie, de Beyrouth et autres ports du sultanat des Mamelouks à des fins commerciales(22).
Les échanges commerciaux entre Mamelouks et villes italiennes ont permis à la monnaie italienne de jouer un important rôle sur les marchés mamelouks. Tout traité ou accord d'échange entre les villes italiennes et les autorités mameloukes était basé sur les monnaies italiennes en or, reconnues par les autorités mameloukes comme monnaies internationales, notamment le ducat de Venise(23). Ceci prouve, s'il en est besoin, la supériorité économique des villes italiennes. Les estimations générales indiquent que les investissements des villes italiennes dans le sultanat des Mamelouks se chiffraient, à la fin du XV° siècle, à plus de 800.000 ducats en or, ce qui démontre de la puissance économique de ces villes(24). Mais la découverte du Cap de Bonne Espérance sonna le glas de l'Etat des Mamelouks et de la prospérité économique du monde islamique, en ce sens qu'il constituait une menace à la principale source de revenu de l'Etat Mamelouk, l'une des principales causes de sa chute directe dans les mains des Ottomans. Cette découverte était également le prélude à l'hégémonie occidentale sur le commerce international.
Vasco de Gama a réussi, le 20 mai 1498, là où plusieurs de ses prédécesseurs ont échoué, à savoir découvrir la route de l'Inde et atteindre Calcutta par la voie maritime, et ce, à bord de trois navires portugais. Ce n'est que plus tard cependant que l'impact de cette découverte se fit ressentir, c'est-à-dire après que les Portugais aient réussi à dominer les côtes de l'Océan Indien et faire de cet océan leur territoire réservé. Ils ont ainsi pris le contrôle du commerce de l'Inde tout en faisant mainmise sur la voie commerciale reliant l'Orient à l'Occident(25). De nombreux conflits ont éclaté entre les Mamelouks et les Portugais pendant le règne de Qânsûh al-Ghûrî (906-922H / 1501-1516) pour rompre le blocus imposé à la région et qui les menaçait d'asphyxie.
Le gouverneur de Gujerat, en Inde, Mahmoud Khan Ier (1458-1511) fit appel à al-Ghûrî réclamant une aide urgente contre les injustices et exactions portugaises dans la région. Le sultan mamelouk envoya sa flotte, qui fut vaincue dans la bataille navale de Diu en 1509, sur les côtes indiennes. Il s'agit de la célèbre bataille où le vice-roi des Indes portugaises d'Almeida a détruit la flotte mamelouke après lui avoir infligé de graves pertes. Les Portugais tentèrent de s'attaquer par la suite aux côtes arabes de la Mer Rouge et du Golfe, mais les Ottomans finirent par juguler leur influence et activités dans la région(26).
L'effondrement de l'autorité des Mamelouks sur la voie mondiale du commerce a laissé un impact négatif sur la situation intérieure de l'Egypte. La propagation des injustices et des maladies qui s'en est suivie a facilité la déconfiture de l'Etat devant les Ottomans en 1516-1517. L'on peut dire qu'avec la conquête ottomane de l'Egypte, les relations économiques entre l'Orient et l'Occident entrèrent dans une nouvelle ère. Le monde islamique n'a pas capitulé face à la domination occidentale de l'économie mondiale, mais opposa une vive résistance, aidé en cela par la présence de l'Etat ottoman qui a réussi à unifier ce monde et en faire un immense marché pour les échanges commerciaux. Le Maroc a lutté contre l'hégémonie militaire de l'Occident, attaquant les côtes européennes tant et si durement que certains pays européens se retrouvèrent contraints de conclure des traités d'amitié et de commerce avec le Maroc, dont le Danemark (1757) et la Suède (1763)(27). Le thaler autrichien reflète probablement le mieux la nature des relations économiques existant à cette époque entre le monde islamique et l'Occident.
Le thaler autrichien :
De nombreuses monnaies européennes étaient en circulation dans le monde islamique dans les différentes époques de son éclipse, qui se sont étalées dès le dixième siècle de l'hégire (XVI° siècle), atteignant leur apogée aux treizième et quatorzième siècles de l'hégire (XIX° et XX° siècles). Parmi ces monnaies, connues en arabe du nom de Riyal, qui dérive de l'espagnol Real, signifiant royal. L'on dénombre un grand nombre de monnaies, notamment françaises, espagnoles et hollandaises(28).
Le thaler autrichien passe pour être l'une des monnaies les plus en vue. Les mines d'argent d'Europe centrale avaient, en effet, connu une activité fébrile au cours du XV° siècle, après la découverte de nouvelles méthodes de fusion des métaux permettant de séparer plus facilement l'argent du cuivre(29). L'Empire Romain(30), établi sur les terres germaniques et autrichiennes, a su tirer profit de cette découverte en frappant de monnaies lourdes en argent. Ces monnaies se répandirent dans les pays ottomans, jusqu'en Asie centrale, remplaçant progressivement les piastres hollandais (l'arslani). On appelait la monnaie autrichienne le Riyal ou Kara Kurush, signifiant les piastres noirs, qui est en contraste avec le rouge (kazal), c'est-à-dire qu'elle est en argent de bonne qualité, contrairement aux monnaies en argent mélangé avec du cuivre en fortes proportions, que les Turcs surnommaient le Kazal, signifiant rouge(31).
Cette monnaie en argent, apparue à la fin du Moyen âge, compte parmi les premières monnaies européennes datées. La plus grande pièce était frappée au Tyrol, en Autriche actuellement, avant d'être fabriquée dans différentes régions d'Allemagne et de Bohême (Tchécoslovaquie avant sa séparation aujourd'hui en deux Etats). Deux comtes de Bohême (Joachim et Thaler) ont frappé leur monnaie de l'argent extrait des mines, donnant leur nom à cette monnaie avant que ce nom ne soit abrégé par la suite en Thaler, mot qui désignait désormais bon nombre de monnaies en argent. L'on considère également que le thaler serait le grand-père du dollar que l'on connaît aujourd'hui(32).
En dehors de la Bohême, le Thaler était connu en Allemagne sous le nom de Rixdale, ou Reichsthaler, ou encore le Riyal contractuel, qui est à la base des transactions commerciales. Il était frappé dans différents pays qui l'utilisaient comme moyen d'échange commercial entre nations. Ceci s'applique en particulier au Rixdale autrichien qui a exercé une profonde influence sur de nombreuses monnaies dont l'effigie variait en fonction des régions où il était frappé. Celui qui était le plus en vogue dans les marchés du Levant était frappé à l'effigie de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, morte en 1780, cette date étant inscrite à côté de la valeur nominative du Riyal.
Le Thaler en Egypte :
Le Thaler impérial est apparu en Egypte bien plus tard qu'en Turquie. Il en est fait mention dans les fichiers de Sadate, en 1043 de l'hégire, où il est signalé comme la piastre d'Abu Taqa. Dans les registres officiels, il n'est cité qu'au mois de ramadan 1114 de l'hégire lorsque l'appel fût lancé pour la cotation de la valeur du riyal Abu Taqa(33). Cette appellation, Abu Taqa, vient de l'image figurant sur l'une des faces du Thaler, représentant des armes que suspend un aigle coupé en quatre, ce dessin ressemblant quelque peu aux fenêtres à grilles métalliques, courantes à cette époque en Egypte. D'où provient cette appellation arabe l'apparentant à la fenêtre (signification arabe d'Abu Taqa), dont découle justement le terme Bitâqa (signifiant ticket)(34). Ce n'est qu'à partir de 1165H (1751) que le Thaler commença à circuler dans les marchés de change d'Egypte, détrônant la piastre espagnole en raison des caractéristiques de son alliage, de la perfection de sa circonférence et la résistance de son pourtour à la corrosion(35). L'opération de change favorisait le Thaler bien que la valeur intrinsèque de la piastre espagnole fut légèrement supérieure à celle du Thaler, le calibre de la piastre espagnole étant plus élevée. En résumé, cette différence était due à la nature des relations commerciales et au fait que le Thaler était plus lourd que la piastre et plus parfait(36).
Le café et le Thaler :
Le Thaler domina les relations commerciales en Egypte dès le milieu du XVIII° siècle et jusqu'à l'amorce de la campagne napoléonienne venue du Yémen. Entre-temps, le Thaler était devenu la monnaie de prédilection tant en Mer Rouge que dans l'Océan Indien, en raison surtout de sa relation avec le commerce du café. Au début du XVIII° siècle, il était en circulation au port de Moka, au Yémen, son utilisation devenant courante dès 1760 (1174 de l'hégire). Nipper, lors de sa visite au Yémen, a constaté que les monnaies allemandes étaient très courantes, passant même jusqu'en Inde afin de financer le commerce du café et des épices. En effet, d'énormes quantités de Thaler partaient des différents ports européens vers l'Alexandrie, notamment de Marseille, de Livourne et de Venise, atteignant en 1787 environ 480 mille pièces(37).
Avant la campagne française en Egypte (1798), le Thaler impérial (ou Abu Taqa), était devenue une monnaie financière courante servant à calculer les taxes sur les terres agricoles. Cette situation singulière reflète, en vérité, l'importance que le Thaler avait acquise, puisqu'il était devenu alors le principal mode de paiement en Egypte. Le consul français en Egypte souligne, dans un rapport qu'il adressa à son pays en 1760, que les Egyptiens, voire même les agriculteurs qui avaient naguère refusé le Thaler, le préféraient désormais aux monnaies en or. Le Thaler impérial ne jouissait cependant d'aucune appellation en Egypte, contrairement à Abu Taqa, aucun document ou source historique ne le désignant du Kirsh (Kurush au pluriel), nom adopté en Turquie, et ce, du fait que les monnaies en argent étaient connues à l'époque de la Renaissance en Autriche du nom de Groschen. Il n'était pas non plus désigné en Egypte du nom de Riyal (Abu Shusha) qu'on lui donnait dans les autres marchés d'Orient.
Il existe dans le Musée d'Art islamique au Caire plusieurs modèles du Thaler autrichien. Ils portent tous sur une face l'effigie de Marie-Thérèse et, en dépit des différences dans la conception générale, ils comportent tous le même dessin d'aigle déployant ses ailes avec, au milieu du corps, le dessin d'un bouclier muni de grilles qui lui font ressembler aux fenêtres, dessin qui lui a fait valoir son surnom d'Abu Taqa. Les pièces les plus anciennes conservées au musée remontent à 1757(38). Le Thaler autrichien s'est distingué par l'uniformité de son poids, qui varie entre 27,67 et 27,92 grammes, et son diamètre de 40 mm.
Le Thaler devint une monnaie courante dans bon nombre de pays à travers le monde, allant de la côte Nord-ouest de l'Afrique au Nigeria, de Madagascar à Oman, et jusqu'à la côte turque de la Mer Noire, tous des pays musulmans. L'importance du Riyal et de sa circulation trouvent leur affirmation dans la décision de frapper ces pièces et d'en faire une monnaie royale en Grande Bretagne entre 1945 et 1958.
Le gouvernement autrichien s'est vu contraint, en 1935, sous les pressions exercées par Hitler et Mussolini, de remettre les équipements de fabrication du riyal autrichien au gouvernement italien qui en avait besoin pour financer la guerre de Mussolini contre l'Ethiopie. L'Italie monopolise depuis cette époque la production de ce riyal. Les Britanniques, cependant, ont continué de frapper ce Riyal dans la fabrique royale de la monnaie, et ce, en raison des intérêts commerciaux qu'ils possédaient dans les pays qui leurs étaient soumis de par le monde.
Au cours de la Seconde guerre mondiale, et à la demande du gouvernement britannique, les équipements de frappe de la monnaie ont été transférés à Bombay, en Inde, afin de faire face aux dépenses de transport. La valeur de l'argent, entre-temps, ne cessait de croître. A titre d'exemple, la valeur du Riyal autrichien à Oman est passée, entre 1971 et 1974, d'un demi-riyal omanais à 1,4 riyal. Il serait intéressant de noter que ce même riyal rentre dans la fabrication des chainettes servant à accrocher les amulettes ou talismans que portent les jeunes filles et qu'on appelle al-Madhoud(39). Il convient de noter que le riyal est resté en circulation à Oman jusqu'à une date récente.
(*) Membre du Conseil supérieur égyptien de l'Archéologie, membre de l'Association des archéologues arabes, membre de l'Association égyptienne des études historiques et directeur de la Direction de l'information de la Bibliothèque d'Alexandrie.
(1) Voir plus loin : chapitre sur les "pays en partage".
(2) Fathi Othman, Les frontières islamiques byzantines, Livre III sur les Relations civilisationnelles, éd. Al-Kitab al-Arabi lil Tibaâ wal Nashr, le Caire, p.234.
(3) Archibald Louis, Les forces maritimes et commerciales, traduit par Ahmad Issa, pp. 65, 71 et 103.
(4) Fathi Othman, op. cit. p. 238.
(5) Raafat al-Nabrawi, Histoire de la première monnaie arabe en Islam, pp. 60-61.
(6) Wissam Faraj, L'Etat et le Commerce à l'époque byzantine moyenne, 11, Bulletins annuels de la Faculté des Lettres, Université de Koweït, n° 9, 53ème thèse, 1987-1988.
(7) Aziz Sourial Atiya, Les relations entre l'Orient et l'Occident, traduit par Philippe Seif, rév. Ahmad Fati, Maison de la Culture, 1972, p. 157.
(8) Ibid. p. 156.
(9) Vasiliev, Byzance et l'Islam, traduit par Hussein Muenes et Abdel Hamid Zayed, chapitre sur Byzantium, joint au livre sur l'Empire Byzantin, pp. 271-282 ; Fathi Othman, op. cit. p. 254.
(10) Ali Ghamrawi, Nouvelles lumières sur les relations économiques entre les musulmans et les Francs dans la Grande Syrie à l'époque des Croisades, Revue al-Dâra, premier numéro, 18ème année, 1412H, Riyadh. p. 171.
(11) Baybars Alduwadar, Zubdat al-Fikrah fi Tarikh al-Hijra, authentifié par Zubaida Mohamed Atta, Riyadh, 1394H, pp. 192-195 ; Al-Qalqashandi, Subh al-Aasha fi Sina'at al-Inshâa, Vol. 14, p. 46.
(12) Ali Ghamrawi, op. cit. p. 174.
(13) Al-Qalqashandi, op. cit., Vol. 14, pp. 37-38 ; Baybars Alduwadar, op. cit., p. 194.
(14) Ibn Jubair, Le voyage, Dar Sader, Beyrouth, 1964, pp. 235-245.
(15) Ibn al-Athir, Al-Kamel fil Tarikh, Vol. 8, Dar al-Fikr, Beyrouth, 1978, p. 399 ; Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, in P.P. T.S. Vol. XII, Londres, 1896. p.163 ; Ludolf Van Suchem, A Description of the Holy Land, in P.P. T.S. Vol. XII, Londres, 1896. p.55 ; Ali Ghamrawi, op. cit., p. 185.
(16) Naser Khosrô, Safar Nameh, p. 53.
(17) Ibid., p. 189.
(18) Ibn Jubair, Le voyage, p. 287.
(19) Samir Ali al-Khadim, L'Orient islamique et l'Occident chrétien, Dar al-Rihani éditeur, Beyrouth, 1989, p. 12.
(20) Ibid., p. 329.
(21) Ibid., p. 329.
(22) Ibid., p. 196 ; Raafat Nabrawi, Les ducats en or de Venise, revue al-Dara, 4ème numéro, 17ème année, Ramadan 1412H, Riyadh, pp. 91 et 122.
(23) Samir Ali al-Khadim, op. cit. p. 415.
(24) Naïm Zaki, op. cit, p. 449 ; Ahmad Fouad Mutawalli, Les marines ottomane et portugaise au dixième siècle de l'hégire, revue de la Faculté des sciences sociales, Université islamique de l'imam Mohamed ibn Saoud, n° 4, 1400H/1980, Riyadh, pp. 379-380.
(25) Ahmad Fouad Mutawalli, op. cit., pp. 384-385.
(26) Ahmad ibn al-Mahdi ibn al-Ghazal, Natijat al-Ijtihad fil Al-Muhadanat wa Al-Jihad, authentifié par Ismaël el-Arabi, Diwan al-Matbuat al-Jami'iya, Alger, 1982, pp. 7-8 ; Ahmad al-Sâwi, Les monnaies en circulation en Egypte ottomane, thèse de doctorat, Faculté d'Archéologie de l'Université du Caire, 1991, p. 189.
(27) Abdel Rahman Fahmi, Les monnaies en circulation à l'époque de Jabarti, Etudes et communications de l'ouvrage sur le colloque de Jabarti, Association égyptienne d'études historiques, le Caire, p. 578.
(28) Gibb Har et Harold Bowen, La société islamique et l'Occident, Vol. 2, p. 105.
(29) R. Dotey, Money of the world. p. 138.
(30) Le Saint Empire Romain a joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Europe médiévale. Bien que la date de son émergence soit contestée, on lui impute en général l'année 806 comme date de naissance, lorsque le pape Leo III couronna Charlemagne Empereur des Romains à la Basilique Saint-Pierre à Rome. D'autres estiment que sa naissance remonte à 996 lorsque le pape Jean VII couronna Otton Ier Empereur de l'Etat romain. L'histoire de l'empire s'est distinguée, dès 1273 et jusqu'à Charles V (1519-1556) par la domination des Habsbourg et leur expansion des frontières de l'empire en Autriche et les territoires environnants. L'empire comprenait la plupart de l'Europe occidentale. Il devint par la suite l'Empire germanique qui englobait l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême et les basses terres d'Autriche et la partie septentrionale de l'Est italien. L'Empire dura jusqu'en 1806.
(31) Ruth Holley, Les industries de l'argent à Oman, série Notre Patrimoine, ministère du patrimoine national et de la culture, Muscat, Vol. 2, 1982, p. 26.
(32) Ahmad al-Sâwi, op. cit. p. 191.
(33) Ibid., p. 192.
(34) Ibid., p. 192. ; voir également Wasf Misr, traduit par Zuheir al-Shayeb, Bibliothèque d'al-Khaneji, le Caire, Vol. 6, p. 73.
(35) Ibid., p. 196.
(36) Ibid., p. 196.
(37) Marseille, au Sud de la France, était l'un des principaux ports d'où partait la voie commerciale de Gênes vers l'Orient. Livourne, quant à elle, est un port italien à l'Ouest du pays, à 12 miles de Pise. Au XVI° siècle, le duc Ferdinand décida d'en faire un port principal, de sorte qu'en 1590 il devint l'un des ports du commerce avec l'Orient. Au XVII° siècle, son commerce couvrait le bassin méditerranéen ainsi que les ports de la Mer du Nord et de la Baltique.
(38) Ruth Holley, op. cit., pp. 26 et 28.
(39) Ruth Holley, op. cit., p. 28.
http://www.isesco.org.ma/francais/publications/Islamtoday/27/p7.php








































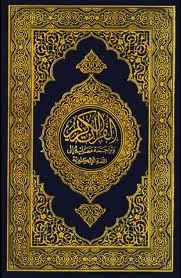


1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité